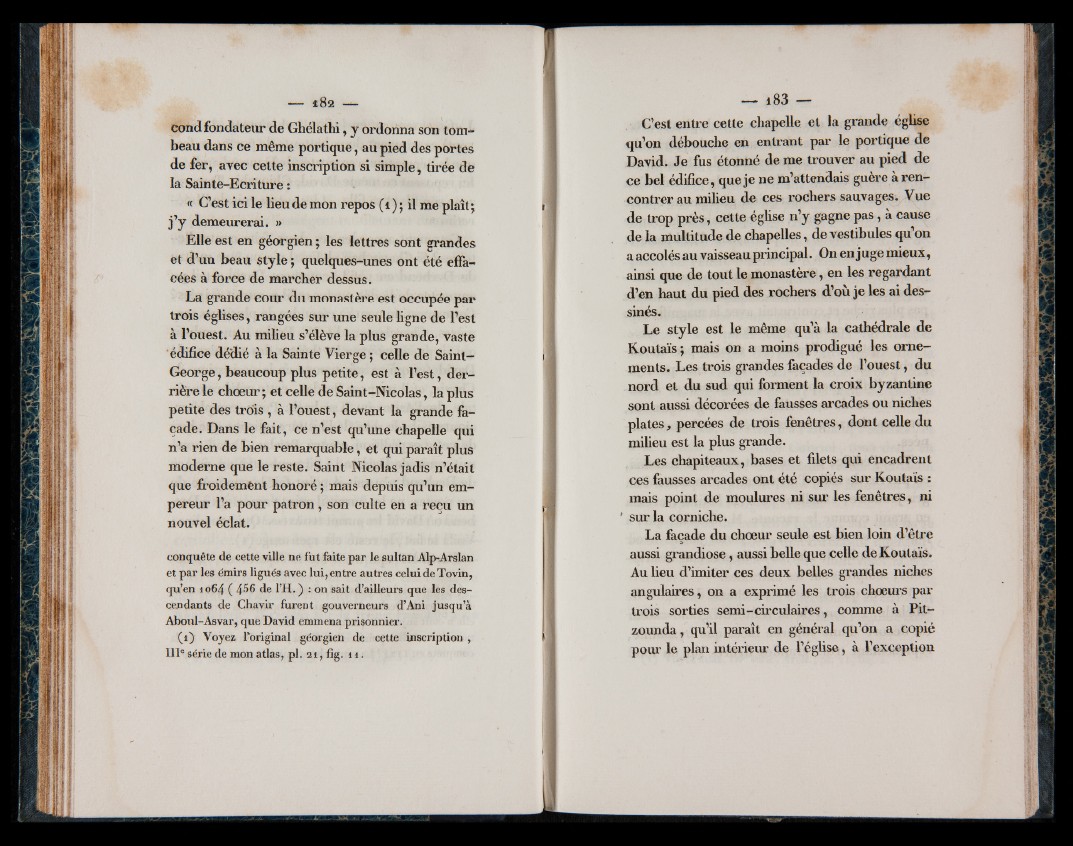
cond fondateur de Ghélathi, y ordonna son tombeau
dans ce même portique, au pied des portes
de fer, avec cette inscription si simple, tirée de
la Sainte-Ecriture :
« C’est ici le lieu de mon repos (1 ) ; il me plaît;
j ’y demeurerai. »
Elle est en géorgien ; les lettres sont grandes
et d’un beau style ; quelques-unes ont été effacées
à force de marcher dessus.
La grande cour du monastère est occupée par
trois églises, rangées sur une seule ligne de l’est
à l’ouest. Au milieu s’élève la plus grande, vaste
édifice dédié à la Sainte Vierge ; celle de Saint-
George , beaucoup plus petite, est à l’est, derrière
le choeur; et celle de Saint-Nicolas, la plus
petite des trois , à l’ouest, devant la grande façade.
Dans le fait, ce n’est qu’une chapelle qui
n’a rien de bien remarquable, et qui paraît plus
moderne que le reste. Saint Nicolas jadis n’était
que froidement honoré ; mais depuis qu’un empereur
l’a pour patron, son culte en a reçu un
nouvel éclat.
conquête de cette ville ne fut faite par le sultan Alp-Arslan
et par les émirs ligués avec lui, entre autres celui de Tovin,
qu’en 1064 ( 456 de l’H .) : on sait d’ailleurs que les descendants
de Chavir furent gouverneurs d’Ani jusqu’à
Aboul-Asvar, que David emmena prisonnier.
(1) Voyez l’original géorgien de cette inscription ,
IIIe série de mon atlas, pl. 21, iîg. n .
C’est entre cette chapelle et la grande église
qu’on débouche en entrant par le portique de
David. Je fus étonné de me trouver au pied de
ce bel édifice, que je ne m’attendais guère a rencontrer
au milieu de ces rochers sauvages. Vue
de trop près, cette église n’y gagne pas, à cause
de la multitude de chapelles, de vestibules qu’on
a accolés au vaisseau principal. On en juge mieux,
ainsi que de tout le monastère, en les regardant
d’en haut du pied des rochers d’où je les ai dessinés.
Le style est le même qu’à la cathédrale de
Routais ; mais on a moins prodigué les ornements.
Les trois grandes façades de l’ouest, du
nord et du sud qui forment la croix byzantine
sont aussi décorées de fausses arcades ou niches
plates, percées de trois fenêtres, dont celle du
milieu est la plus grande.
Les chapiteaux, bases et filets qui encadrent
ces fausses arcades ont été copiés sur Koutaïs :
mais point de moulures ni sur les fenêtres, ni
' sur la corniche.
La façade du choeur seule est bien loin d’être
aussi grandiose, aussi belle que celle de Koutaïs.
Au lieu d’imiter ces deux belles grandes niches
angulaires, on a exprimé les trois choeurs par
trois sorties semi-circulaires, comme à Pit-
zounda, qu’il paraît en général qu’on a copié
pour le plan intérieur de l’église, à l’exception