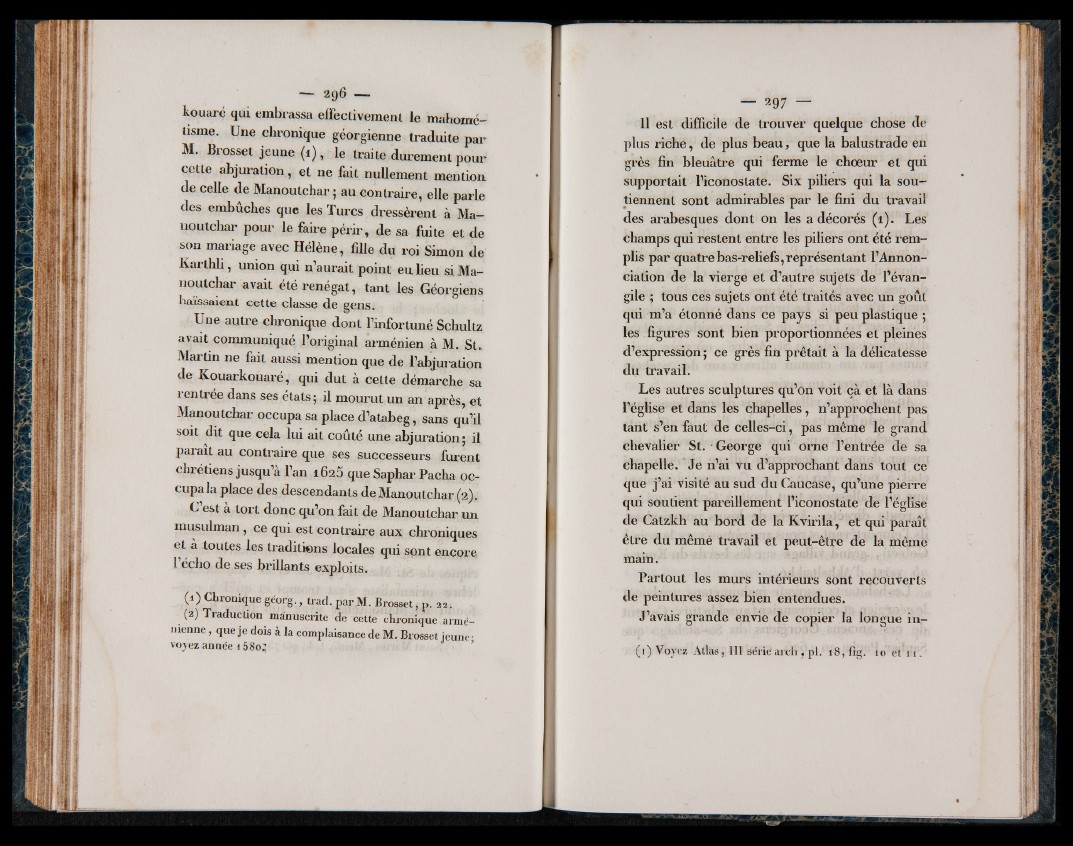
kouaré qui embrassa effectivement le mahométisme.
Une chronique géorgienne traduite par
M. Brosset jeune (i), le traite durement pour
cette abjuration, et ne fait nullement mention
de celle de Manoutchar ; au contraire, elle parle
des embûches que les Turcs dressèrent à Manoutchar
pour le faire périr, de sa fuite et de
son mariage avec Hélène , fille du roi Simon de
Karthli, union qui n’aurait point eu lieu si Manoutchar
avait été renégat, tant les Géorgiens
haïssaient cette classe de gens.
Une autre chronique dont l’infortuné Schultz
avait communiqué l’original arménien à M. St.
Martin ne fait aussi mention que de l’abjuration
de Kouarkouaré, qui dut à cette démarche sa
rentrée dans ses états ; il mourut un an après, et
Manoutchar occupa sa place d’atabeg, sans qu’il
soit dit que cela lui ait coûté une abjuration 5 il
paraît au contraire que ses successeurs furent
chrétiens jusqu’a l’an 1625 que Saphar Pacha occupa
la place des descendants de Manoutchar (2).
C est à tort donc qu’on fait de Manoutchar un
musulman, ce qui est contraire aux chroniques
et à -toutes les traditions locales qui spnt encore
l’écho de ses brillants exploits.
(1 ) Chronique géorg., trad. par M. Brosset, p. 22.
(2) Tiaduction manuscrite de cette chronique arménienne
, que je dois à la complaisance de M. Brosset jeune-
voyez année 158o;
11 est difficile de trouver quelque chose de
plus riche, de plus beau, que la balustrade en
grès fin bleuâtre qui ferme le choeur et qui
supportait l’iconostate. Six piliers qui la soutiennent
sont admirables par le fini du travail
des arabesques dont on les a décorés (1). Les
champs qui restent entre les piliers ont été remplis
par quatre bas-reliefs, représentant l’Annon-
ciation de la vierge et d’autre sujets de l’évangile
; tous ces sujets ont été traités avec un goût
qui m’a étonné dans ce pays si peu plastique ;
les figures sont bien proportionnées et pleines
d’expression ; ce grès fin prêtait à la délicatesse
du travail.
Les autres sculptures qu’on voit çà et là dans
l’église et dans les chapelles, n’approchent pas
tant s’en faut de celles-ci, pas même le grand
chevalier St. George qui orne l’entrée de sa
chapelle. Je n’ai vu d’approchant dans tout ce
que j’ai visité au sud du Caucase, qu’une pierre
qui soutient pareillement l’iconostate de l’église
de Catzkh au bord de la Kvirila, et qui paraît
être du mêmé travail et peut-être de la même
main. ;
Partout les murs intérieurs sont recouverts
de peintures assez bien entendues.
J’avais grande envie de copier la longue in-
(1) Voyez Atlas, III série areh , pl. 18, fîg. 10 et 11.