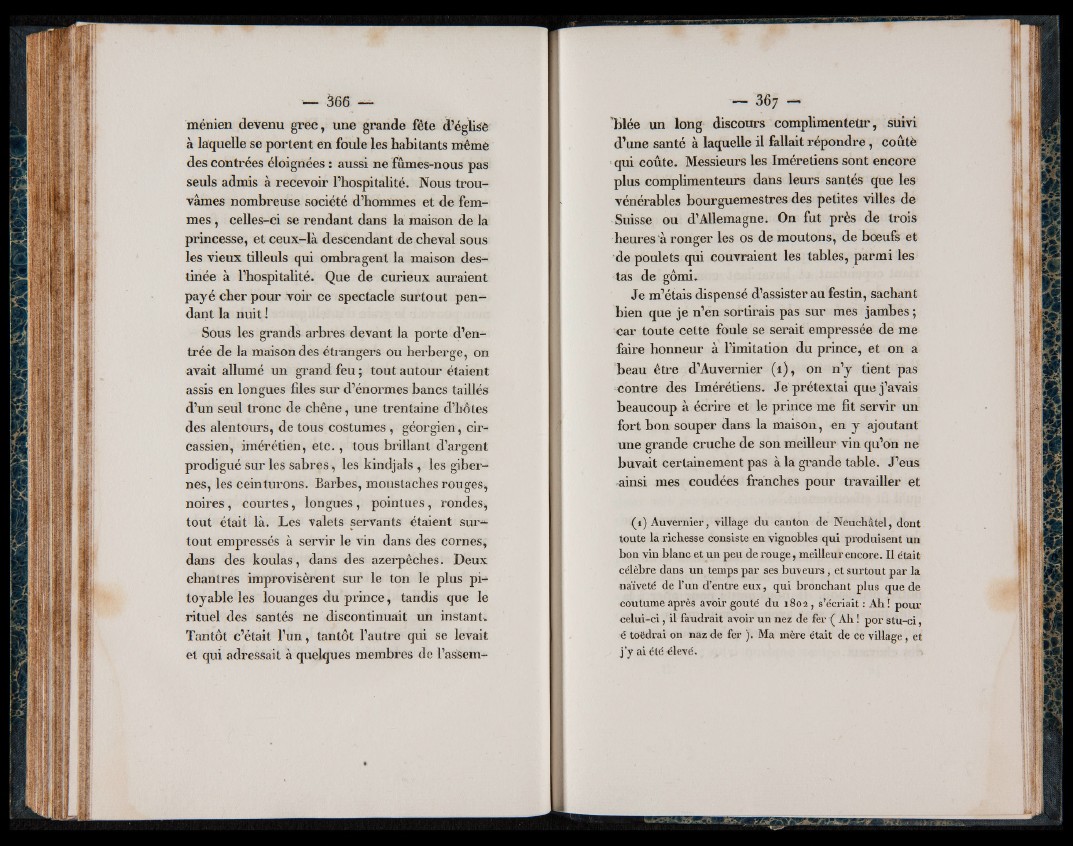
ménien devenu grec, une grande fête d’égliSè
à laquelle se portent en foule les habitants mêmè
des contrées éloignées : aussi ne fûmes-nous pas
seuls admis à recevoir l’hospitalité. Nous trouvâmes
nombreuse société d’hommes et de femmes
, celles-ci se rendant dans la maison de la
princesse, et ceux-là descendant de cheval sous
les vieux tilleuls qui ombragent la maison destinée
à l’hospitalité. Que de curieux auraient
payé cher pour voir ce spectacle surtout pendant
la nuit !
Sous les grands arbres devant la porte d’entrée
de la maison des étrangers ou herberge, on
avait allumé un grand feu ; tout autour étaient
assis en longues files sur d’énormes bancs taillés
d’un seul tronc de chêne, une trentaine d’hôtes
des alentours, de tous costumes , géorgien, cir-
cassien, imérétien, etc., tous brillant d’argent
prodigué sur les sabres , les kindjals , les gibernes,
les ceinturons. Barbes, moustaches rouges*
noires, courtes, longues, pointues, rondes,
tout était là. Les valets servants étaient sur-
tout empressés à servir le vin dans des cornes,
dans des koulas, dans des azerpêches. Deux
chantres improvisèrent sur le ton le plus pitoyable
les louanges du prince, tandis que le
rituel des santés ne discontinuait un instantv
Tantôt c’était l’un, tantôt l’autre qui se levait
et qui adressait à quelques membres de l’assem-
'filée un long discours complimenteur, suivi
d’une santé à laquelle il fallait répondre, coûté
qui coûte. Messieurs les Iméretiens sont encore
plus complimenteurs dans leurs santés que les
vénérables bourguemestres des petites villes de
Suisse ou d’Allemagne. On fut près de trois
heures à ronger les os de moutons, de boeufs et
de poulets qui couvraient les tables, parmi les
tas de gômi.
Je m’étais dispensé d’assister au festin, sachant
bien que je n’en sortirais pas sur mes jambes ;
car toute cette foule se serait empressée de me
faire honneur à l’imitation du prince, et on a
beau être d’Auvernier (1), on n’y tient pas
contre des Imérétiens. Je prétextai que j’avais
beaucoup à écrire et le prince me fit servir un
fort bon souper dans la maison, en y ajoutant
une grande cruche de son meilleur vin qu’on ne
buvait certainement pas à la grande table. J’eus
ainsi mes coudées franches pour travailler et
(1) Auvernier, village du canton de Neuchâtel, dont
toute la richesse consiste en vignobles qui produisent un
bon vin blanc et un peu de rouge, meilleur encore. Il était
célèbre dans un temps par ses buveurs, et surtout par la
naïveté de l’un d’entre eux, qui bronchant plus que de
coutume après avoir goûté du 1802, s’écriait : Ah ! pour
celui-ci, il faudrait avoir un nez de fer { Ah ! por stu-ci,
é toëdrai on naz de fer ). Ma mère était de ce village, et
j ’y ai été élevé.