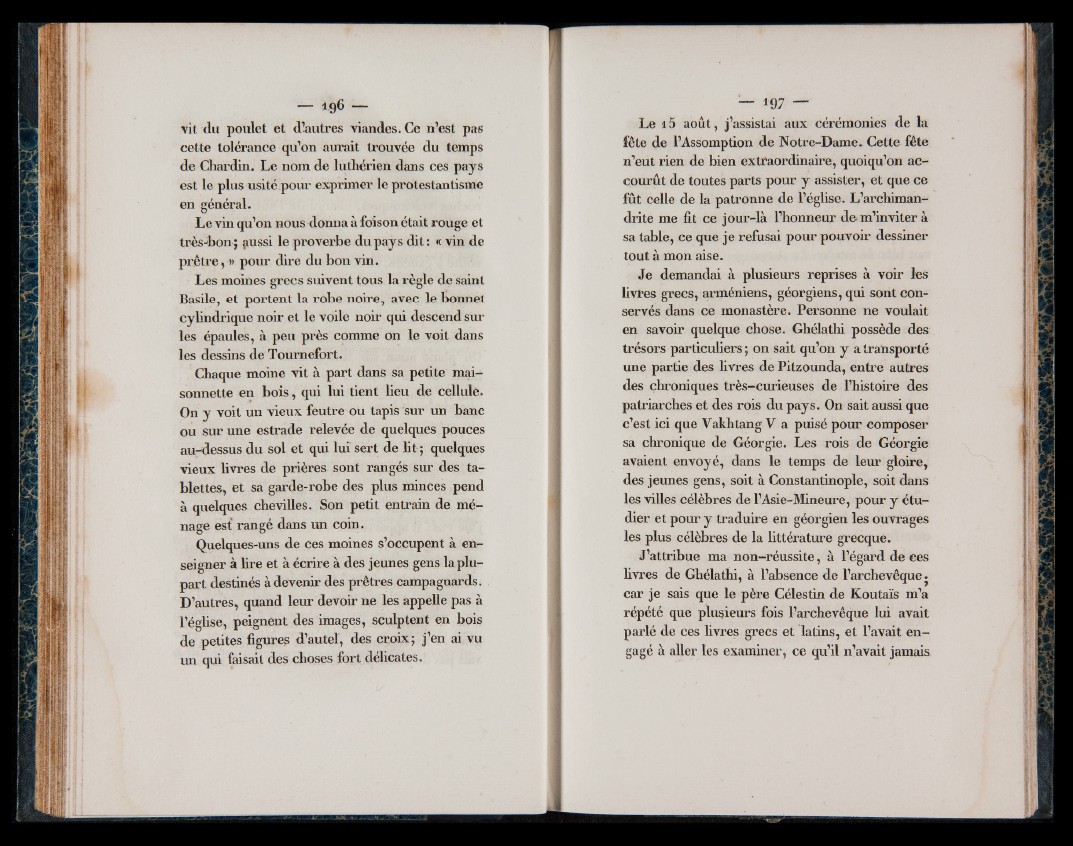
vit du poulet et d’autres viandes. Ce n’est pas
cette tolérance qu’on aurait trouvée du temps
de Chardin. Le nom de luthérien dans ces pays
est le plus usité pour exprimer le protestantisme
en général.
Le vin qu’on nous donna à foison était rouge et
très-bon ; aussi le proverbe du pays dit : « vin de
prêtre , » pour dire du bon vin.
Les moines grecs suivent tous la règle de saint
Basile, et portent la robe noire, avec le bonnet
cylindrique noir et le voile noir qui descend sur
les épaules, à peu près comme on le voit dans
les dessins de Tournefort.
Chaque moine vit à part dans sa petite maisonnette
en bois, qui lui tient lieu de cellule.
On y voit un vieux feutre ou tapis sur un banc
ou sur une estrade relevée de quelques pouces
au-dessus du sol et qui lui sert de lit ; quelques
vieux livres de prières sont rangés sur des tablettes,
et sa garde-robe des plus minces pend
à quelques chevilles. Son petit entrain de ménage
est rangé dans un coin.
Quelques-uns de ces moines s’occupent à enseigner
à lire et à écrire à des jeunes gens la plupart
destinés à devenir des prêtres campagnards.
D’autres, quand leur devoir ne les appelle pas à
l’église, peignent des images, sculptent en bois
de petites figure? d’autel, des croix; j’en ai vu
un qui faisait des choses fort délicates.
Le i 5 août, j’assistai aux cérémonies de la
fête de l’Assomption de Notre-Dame. Cette fête
n’eut rien de bien extraordinaire, quoiqu’on accourût
de toutes parts pour y assister, et que ce
fût celle de la patronne de l’église. L’archimandrite
me fit ce jour-là l’honneur de m’inviter à
sa table, ce que je refusai pour pouvoir dessiner
tout à mon aise.
Je demandai à plusieurs reprises à voir les
livres grecs, arméniens, géorgiens, qui sont conservés
dans ce monastère. Personne ne voulait
en savoir quelque chose. Ghélathi possède des
trésors particuliers ; on sait qu’on y a transporté
une partie des livres de Pitzounda, entre autres
des chroniques très-curieuses de l’histoire des
patriarches et des rois du pays. On sait aussi que
c’est ici que Vakhtang V a puisé pour composer
sa chronique de Géorgie. Les rois de Géorgie
avaient envoyé, dans le temps de leur gloire,
des jeunes gens, soit à Constantinople, soit dans
les villes célèbres de l’Asie-Mineure, pour y étudier
et pour y traduire en géorgien les ouvrages
les plus célèbres de la littérature grecque.
J’attribue ma non-réussite, à l’égard de ces
livres de Ghélathi, à l’absence de l’archevêque.
car je sais que le père Célestin de Koutaïs m’a
répété que plusieurs fois l’archevêque lui avait
parlé de ces livres grecs et latins, et l’avait engagé
à aller les examiner, ce qu’il n’avait jamais