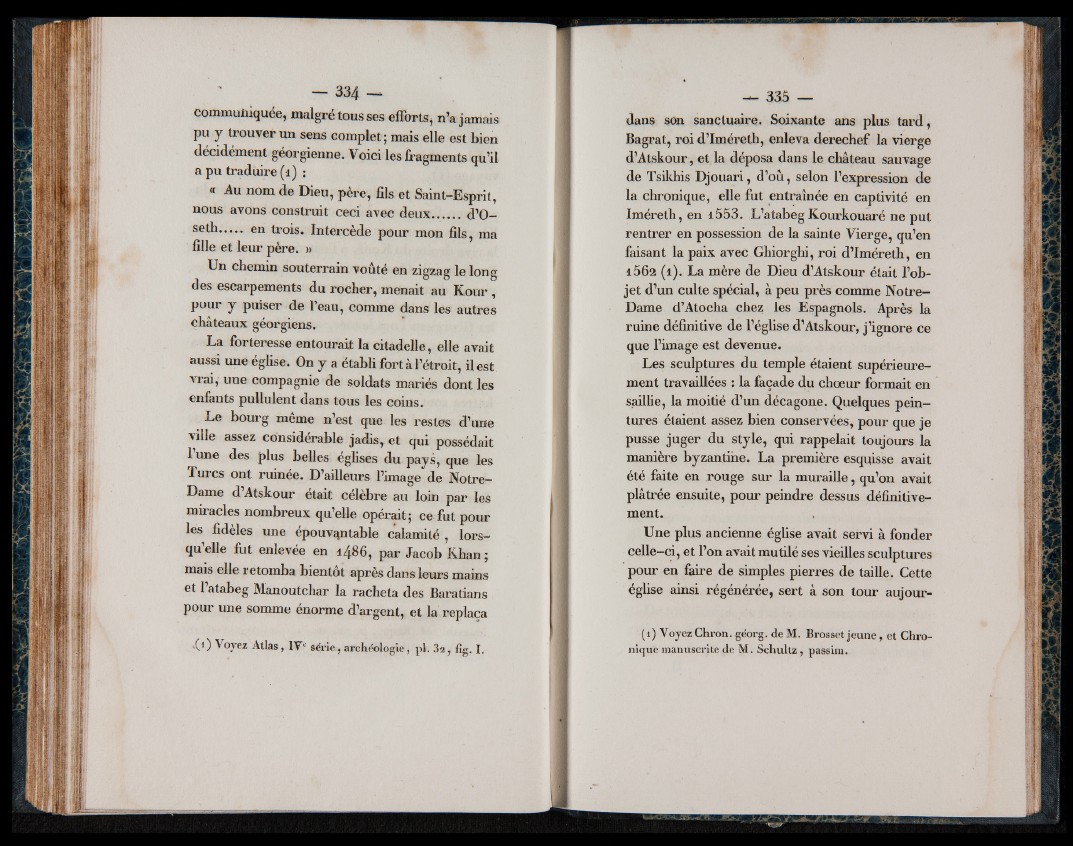
communiquée, malgré tous ses efforts, n’a jamais
pu y trouver un sens complet ; mais elle est bien
décidément géorgienne. Voici les fragments qu’il
a pu traduire (1) :
« Au nom de Dieu, père, fils et Saint-Esprit,
nous avons construit ceci avec deux d’O-
en trois. Intercède pour mon fils, ma
fille et leur père, »
Un chemin souterrain voûté en zigzag le long
des escarpements du rocher, menait au Kour ,
pour y puiser de l’eau, comme dans les autres
châteaux géorgiens.
La forteresse entourait la citadelle, elle avait
aussi une église. On y a établi fort à l’étroit, il est
vrai, une compagnie de soldats mariés dont les
enfants pullulent dans tous les coins.
Le bourg même n’est que les restes d’une
ville assez considérable jadis, et qui possédait
lune des plus belles églises du pays, que les
Turcs ont ruinée. D’ailleurs l’image de Notre-
Dame d’Atskour était célèbre au loin par les
miracles nombreux qu’elle opérait; ce fut pour
les fideles une epouvqntable calamité , lorsqu’elle
fi.it enlevée en i 486, par Jacob Khan;
mais elle retomba bientôt après dans leurs mains
et l’atabeg Manoutchar la racheta des Baratians
pour une somme énorme d’argent, et la replaça
4( i ) Voyez Atlas, IVe série, archéologie, pl. 3a, fig. L
dans son sanctuaire. Soixante ans plus tard,
Bagrat, roi d’Iméreth, enleva derechef la vierge
d’Atskour, et la déposa dans le château sauvage
de Tsikhis Djouari, d’ou, selon l’expression de
la chronique, elle fut entraînée en captivité en
Iméreth, en i 553. L’atabeg Kourkouaré ne put
rentrer en possession de la sainte Vierge, qu’en
faisant la paix avec Ghiorghi, roi d’Iméreth, en
i 56a (î). La mère de Dieu d’Atskour était l’objet
d’un culte spécial, à peu près comme Notre-
Dame d’Atocha chez les Espagnols. Après la
ruine définitive de l’église d’Atskour, j’ignore ce
que l’image est devenue.
Les sculptures du temple étaient supérieurement
travaillées : la façade du choeur formait en
saillie, la moitié d’un décagone. Quelques peintures
étaient assez bien conservées, pour que je
pusse juger du style, qui rappelait toujours la
manière byzantine. La première esquisse avait
été faite en rouge sur la muraille, qu’on avait
plâtrée ensuite, pour peindre dessus définitivement.
Une plus ancienne église avait servi à fonder
celle-ci, et l’on avait mutilé ses vieilles sculptures
pour en faire de simples pierres de taille. Cette
église ainsi régénérée, sert à son tour aujour-
(i) VoyezChron. géorg. de M. Brosset jeune, et Chronique
manuscrite de M. Schultz, passim.