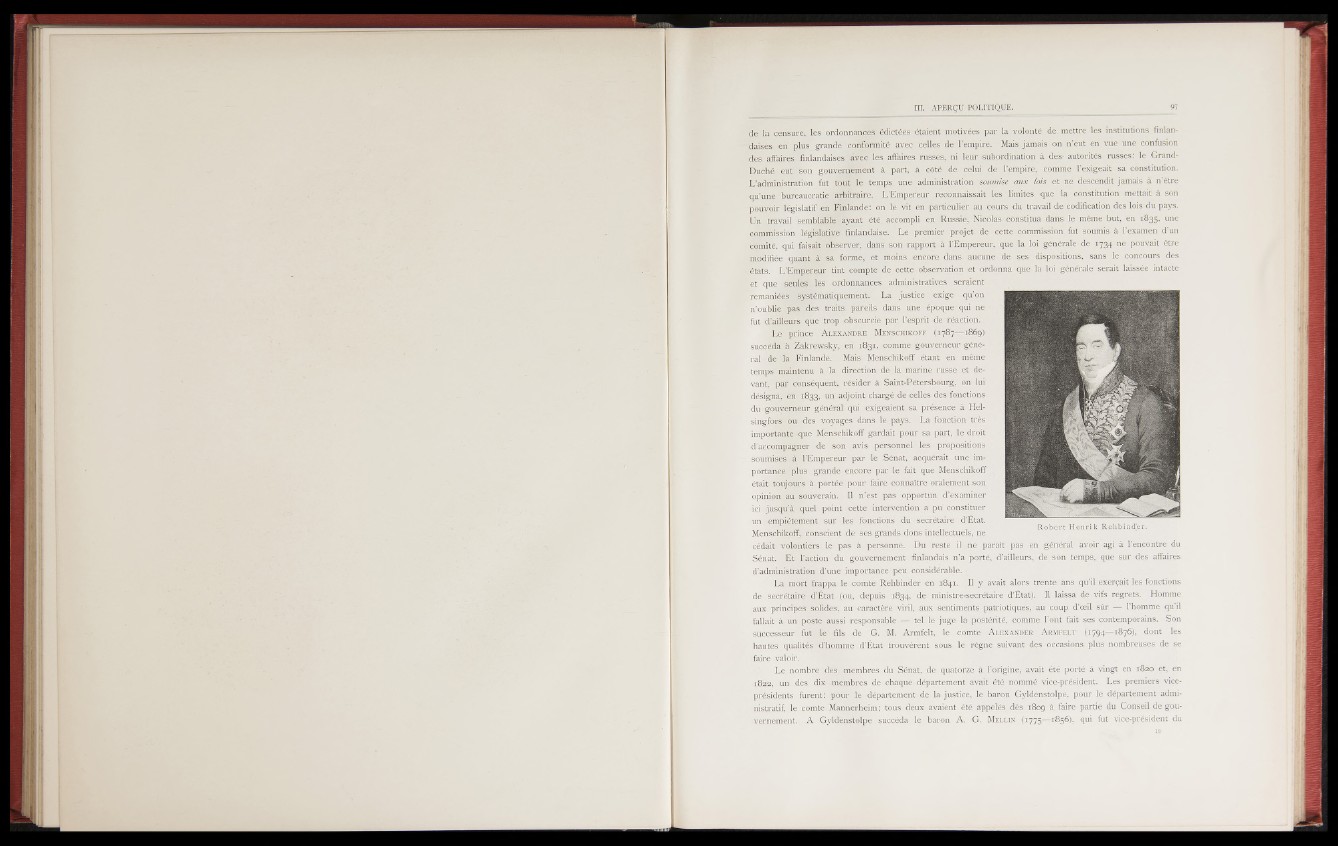
de la censure, les ordonnances édictées étaient motivées par la volonté de. mettre les institutions finlandaises
en plus grande conformité avec celles de l’empire. Mais jamais on n’eut en vue une confusion
des affaires finlandaises avec les affaires russes, ni leur subordination à des- autorités russes: le Grand-
Duché eut son gouvernement à part, à côté de celui de l’empire, comme l’exigeait sa constitution.
L ’administration fut tout le temps une administration soumise aux lois et ne descendit jamais à n’être
qu’une bureaucratie arbitraire. L ’Empereur reconnaissait les limites que la constitution mettait à son
pouvoir législatif en Finlande: on le vit en particulier au cours du travail de codification des lois du pays.
Un travail semblable ayant été. accompli en Russie, Nicolas constitua dans le même but, en 1835, une
commission législative finlandaise. Le premier projet- de cette commission fut soumis à l’examen d’un
comité, qui faisait observer, dans son rapport à l’Empereur, que la loi générale de 1734 ne pouvait être
modifiée quant à sa forme, et moins encore dans. aucune de ses dispositions, sans le concours des
états. L ’Empereur tint compte de cette observation et ordonna que la loi générale serait laissée intacte
et que seules les ordonnances administratives seraient
remaniées; systématiquement. La justice ' exige qu’on
n’oublie pas des traits pareils dans une époque- qui ne
fut d’ailleurs que trop obscurcie par l’esprit de réaction.
Le prince A lexan d re Men schikof f (1787— 1869F
succéda à Zakrewsky, en 1831, .comme gouverneur général
de la Finlande. Mais Menschikoff étant en même
temps maintenu à la direction de la marine russe et devant,
par conséquent, résider à Saint-Pétersbourg, on lui'
désigna, en 1833, un adjoint chargé de celles des fonctions
du gouverneur général qui exigeaient Sa présence à Hel-
singfora -bu- des voyages dans le pays. La fonction très'
importante que Menschikoff gardait pour sa part, le droit
d'accompagner de son avis personnel les propositions;
soumises à l’Empereur par le Sénat, acquérait une importance
plus grande encore par le fait que Menschikoff
était toujours à portée pour faire connaître oralement Son
opinion au souverain. Il n’est pas opportun d’examiner
ici jusqu’à quel: point cette intervention a pu constituer
un empiétement sur les fonctions du secrétaire d’État.
. . . . . . R o b e r t H e n r ik R e h b in d e r .
Menschikoff, conscient de ses grands dons intellectuels, ne
cédait volontiers, le pas à personnè. Du reste il ne paraît pas en général avoir agi à l’encontre du
Sénat. Et l’action du gouvernement -finlandais n’a porté, d’ailleurs, de son temps, que sur des affaires
d’administration d’une importance peu considérable. *
La mort frappa le comte Rehbinder en 1841. Il y avait alors trente ans qu’il exerçait les fonctions
de secrétaire d’État (ou, depuis 1834, de ministre-secrétaire d’État). Il laissa de vifs regrets. Homme
aux principes solides, au caractère viril, aux sentiments patriotiques, au coup d’oeil sûr — l’homme qu’il
fallait à un poste-aussi responsable — tel le juge la postérité, comme l’ont fait ses contemporains. Son
successeur fut le fils de G. ,M. Armfelt, le comte A lexander A rmfe lt - (1794— 1876), dont les
hautes qualités d’homme d’État trouvèrent^- sous le règne suivant des occasions plus nombreuses de se
faire valoir.
Le nombre des membres du Sénat, de quatorze à l’origine, avait été porté à vingt en 1820 et, en
1822, un des dix membres de chaque département avait été nommé vice-président. Les premiers vicé-
présidents furent: pour le département de la justice, le baron Gyldenstolpe, pour le département administratif,
le comte Mannerheim; tous deux avaient été appelés dès 1809 à faire partie du Conseil de gouvernement.
A Gyldenstolpe succéda le baron A. G. Mel lin (1775— 1856), qui fut vice-président du