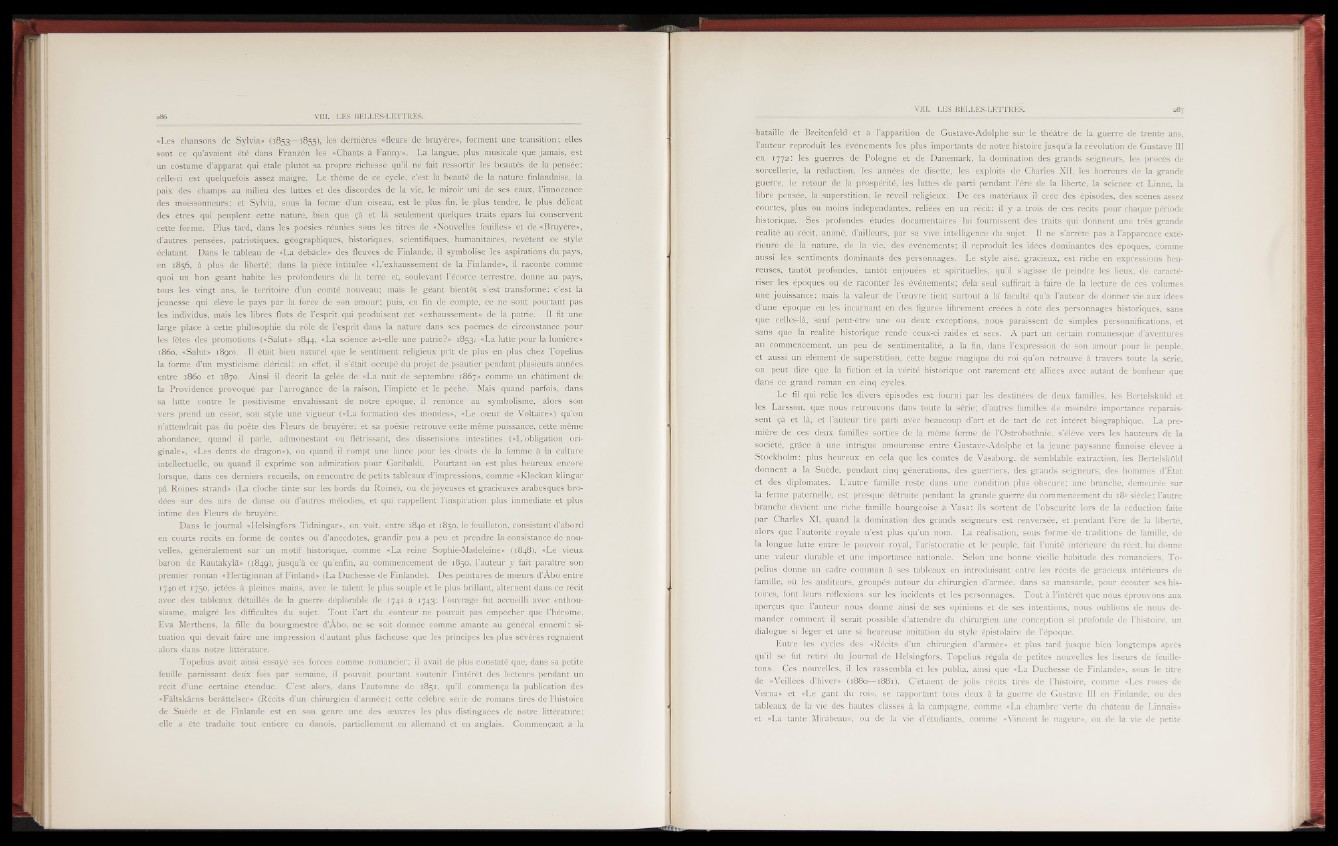
«Les chansons de Sylvia» (1853— 1855), les dernières «fleurs de bruyère», forment une transition; elles
sont ce qu’avaient été dans Franzén les «Chants à Fanny». La langue, plus musicale que jamais, est
un costume d’apparat qui étale plutôt sa propre richesse qu’il ne fait ressortir les beautés de la pensée:
celle-ci est quelquefois assez maigre. Le thème de ce cycle, c’est la beauté de la nature finlandaise, la
paix des champs au milieu des luttes et des discordes de la vie, le miroir uni de ses eaux, l'innocence
des moissonneurs; et Sylvia, sous la forme d’uri oiseau, est le plus fin, le plus tendre, le plus délicat
des êtres qui peuplent cette nature, bien que çà et là seulement quelques traits épars lui conservent
cette forme. Plus tard, dans les poésies réunies sous les titres de «Nouvelles feuilles» et de «Bruyère»,
d’autres pensées, patriotiques, géographiques, historiques, scientifiques, humanitaires, revêtent ce style
éclatant. Dans le tableau de «La débâcle» des fleuveS de Finlande, il Symbolise les aspirations du pays,
en 1856, à plus de liberté; dans la pièce intitulée «L’exhaussement de la Finlande», il raconte comme
quoi un bon géant habite les profondeurs dé la terre et, soulevant l’écorce terrestre, donne au pays,
tous les vingt ans, le territoire d’un comté nouveau; mais le géant bientôt s’est transformé: c’êst la
jeunesse qui élève le pays par la force de son amour; puis, en fin de .compte, ce ne sont pourtant pas
les individus, mais les libres flots de l’esprit qui produisent cet «exhaussement» de la patrie. Il fit une
large place à cette philosophie du rôle de l’esprit dans la nature dans ses poèmes de circonstance pour
les fêtes des promotions («Salut» 1844, «La science a-t-elle une patrie?» 1853,- «La lutte pour la lumière»
1860, «Salut» 1890). Il était bien naturel que le sentiment religieux prît de plus en plus chez Topelius
la forme d’un mysticisme clérical: en effet, il s’était occupé du projet de psautier pendant plusieurs années
entre 1860 et 1870. Ainsi il décrit la gelée de «La nuit de septembre 1867» comme un châtiment de
la Providence provoqué par l’arrogance de la raison, l’impiété et le péché“ Mais quand parfois, dans
sa lutte contre le positivisme envahissant de notre époque, il renonce au symbolisme, alors son
vers prend un essor, son style une vigueur («La formation des mondes». «Le coeur de Voltaire») qu’on
n’attendrait pas du poète des Fleurs de bruyère; et sa poésie retrouve cette même puissance, cette, même
abondance, quand il parle, admonestant ou flétrissant, des dissensions intestines _(«L’obligation originale
», «Les dents de dragon»), ou quand il rompt une lance pour les droits de la femme à la culture
intellectuelle, ou quand il exprime son admiration pour Garibaldi. Pourtant on est plus heureux encore
lorsque, dans ces derniers recueils, on rencontre de petits tableaux d’impressions, comme «Klockan klingar
pâ Roines strand» (La cloche tinte sur les bords du Roine), ou de< joyeuses et gracieuses arabesques brodées
sur des airs de danse ou d’autres mélodies, et qui rappellent l’inspiration plus immédiate et plus
intime des Fleurs de bruyère.
Dans le journal «Helsingfors Tidningar», on voit, entre 1840 et 1850, le feuilleton,'Consistant d’abord
en courts récits en forme de contes ou d’anecdotes, grandir peu à peu et prendre la consistance de nouvelles,
généralement sur un motif historique, comme «La reine Sophie-Madeleine» (1848), «Le vieux
baron de Rautakylâ» (1849), jusqu’à ce qu’enfin, au commencement de 1850, l’auteur y- fait paraître son
premier roman «Hertiginnan af Finland» (La Duchesse de Finlande). Des peintures de moeurs d’Âbo entre
1740 et 1750, jetées à pleines mains, avec le talent le plus souple et le plus brillant, alternent dans ce récit
avec des tableaux détaillés de la guerre déplorable de 1741 à 1743; l’ouvrage fut accueilli avec enthousiasme,
malgré les difficultés du sujet. Tout l’art du conteur ne pouvait pas empêcher que l’héroïne,
Eva Merthens, la fille du bourgmestre d’Àbo, ne se soit donnée comme amante au général ennemi: situation
qui devait faire une impression d’autant plus fâcheuse que les principes les plus sévères régnaient
alors dans notre littérature.
Topelius avait ainsi essayé ses forces comme romancier; il avait de plus constaté que, dans sa petite
feuille paraissant deux fois par semaine, il pouvait pourtant soutenir l’intérêt des lecteurs pendant un
récit d’une certaine étendue. C’est alors, dans l’automne de 1851, qu’il commença la publication des
«Fâltskârns berâttelser» (Récits d’un chirurgien d’armée); cette célèbre série de romans tirés de l’histoire
de Suède et de Finlande est en son genre une des oeuvres les plus distinguées de notre littérature;
elle a été traduite tout entière en danois, partiellement en allemand et en anglais. Commençant à la
-bataille de Breitenfeld et à l’apparition de Gustave-Adolphe sur le théâtre de la guerre de trente ans,
l’auteur reproduit les événements les plus importants de notre histoire jusqu’à la révolution de Gustave III
en 1772: les guerres de Pologne et de Danemark, la domination des grands seigneurs, les procès de
sorcellerie, la réduction, les années de disette, les exploits de Charles XII, les horreurs de la grande
guerre, le retour de la prospérité, les luttes de parti pendant l’ère de la liberté, la science et Linné, la
libre pensée, la superstition, le réveil religieux. De ces matériaux il crée des épisodes, des scènes assez
courtes, plus pu moins indépendantes, reliées en un récit; il y a trois de ces récits pour chaque période
historique. Ses profondes études documentaires lui fournissent des traits qui donnent une très grande
réalité au récit, animé, d’ailleurs, par sa vive intelligence du sujet. Il ne s’arrête pas à l’apparence extérieure
de la nature, de la vie, des événements; il reproduit les idées dominantes des époques, comme
aussi les Sentiments dominants des personnages. Le style aisé, gracieux, est riche en expressions heureuses,
tantôt profondes, tantôt enjouées et spirituelles, qu’il s’agisse de peindre les lieux, de caractériser
les époques ou de raconter les événements; cela seul suffirait à faire de la lecture de ces volumes
une_j puissance"; mais la valeur de l’oeuvre tient surtout à là faculté qu’a l’auteur de donner vie aux idées
d’une époque en les incarnant en des figures librement créées à côté des personnages historiques, sans
que celles-là,- sauf peut-être une ou deux exceptions, nous paraissent de simples personnifications, et
sans que la réalité historique rende ceux-ci raides et secs. A part un certain romanesque d’aventures
au commencemërit, un peu de sentimentalité, à la fin, dans l’expression de son amour pour le peuple,
et aussi un élément de superstition, cette bague magique du roi qu’on retrouve à travers toute la série,
on peut dire que la fiction et la vérité historique ont rarement été alliées avec autant de bonheur que
dans ce grand roman en cinq cycles.
Le fil qui relie les divers épisodes est fourni par les destinées de deux familles, les Bertelskôld et
les Larsson, que nous retrouvons dans toute la série; d’autres familles de moindre importance reparaissent
çà et là, et l’auteur tiré parti avec beaucoup d’art et de tact de cet intérêt biographique. La première
de ces deux familles sorties de la même ferme de l’Ostrobothnie, s’élève vers les hauteurs de la
société, grâce à une intrigue amoureuse entre Gustave-Adolphe et la jeune paysanne finnoise élevée à
Stockholm; plus heureux en cela que les comtes de Vasaborg, de semblable extraction, les Bertelskôld
donnent à la Suède, pendant cinq générations, des guerriers, des grands seigneurs, des hommes d’État
et des diplomates. L ’autre famille reste dans une condition plus obscure; une branche, demeurée sur
la ferme paternelle, est presque détruite pendant la grande guerre du commencement du 18e siècle; l’autre
branche devient une riche famille bourgeoise à Vasa; ils sortent de l’obscurité lors de la réduction faite
par Charles XI, quand la domination des grands seigneurs est renversée, et pendant l’ère de la liberté,
alors que l’autorité royale n’est plus qu’un nom. La réalisation, sous forme de traditions de famille, de
la longue lutte entre le pouvoir royal, l’aristocratie et le peuple, fait l’unité intérieure du récit, lui donne
une valeur durable et une importance nationale. Selon une bonne vieille habitude des romanciers, Topelius
donne un cadre commun à ses tableaux en introduisant entre les récits de gracieux intérieurs de
famille, où les auditeurs, groupés autour du chirurgien d’armée, dans sa mansarde, pour écouter ses histoires,
font leurs réflexions sur les incidents et les personnages. Tout à l’intérêt que nous éprouvons aux
aperçus que l’auteur nous donne ainsi de ses opinions et de ses intentions, nous oublions de nous demander
comment il serait possible d’attendre du chirurgien une conception si profonde de l’histoire, un
dialogue si léger et une si heureuse imitation du style épistolaire de l’époque.
Entre les cycles des «Récits d’un chirurgien d’armée» et plus tard jusque bien longtemps après
qu’il se fut retiré du Journal de Helsingfors, Topelius régala de petites nouvelles les liseurs de feuilletons.
Ces nouvelles, il les rassembla et les publia, ainsi que «La Duchesse de Finlande», sous le titre
de «Veillées d’hiver» (1880— 1881). C’étaient de jolis récits tirés de l’histoire, comme «Les roses de
Verna» et «Le gant du roi», se rapportant tous deux à la guerre de Gustave III en Finlande, ou des
tableaux de la vie des hautes classes à la campagne, comme «La chambre‘verte du château de Linnais»
et «La tante Mirabeau», ou de la vie d’étudiants, comme «Vincent le nageur», ou de la vie de petite