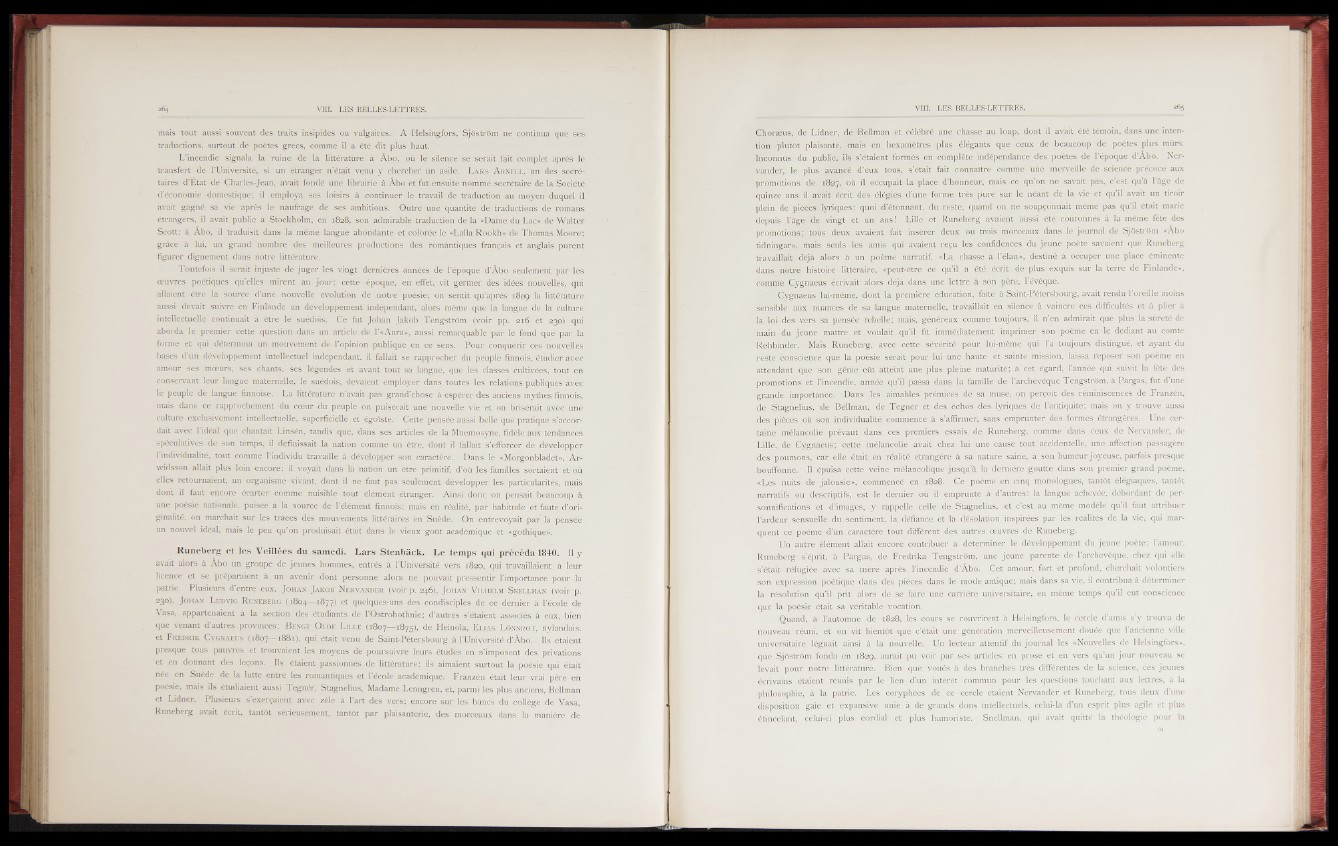
mais tout aussi souvent des traits insipides ou vulgaires. A Helsingfors, Sjôstrôm ne continua que ses
traductions, surtout de poètes grecs, comme il a été dit plus haut.
L’incendie signala la ruine de la littérature à Abo, où le silence se serait fait complet après le
transfert de l’Université, si un étranger n’était venu y chercher un asile. L a r s A r n e l l , un des secrétaires
d’Etat de Charles-Jean, avait fondé une librairie à Âbo et fut ensuite nommé secrétaire de la Société
d’économie domestique: il employa ses loisirs à continuer le travail de traduction au moyen duquel il
avait gagné sa vie après le naufrage de ses ambitions. Outre une quantité de traductions de romans
étrangers, il avait publié à Stockholm, en 1828, son admirable traduction de la «Dame-du Lac» de Walter
Scott; à Âbo, il traduisit dans la même langue abondante et colorée le «Lalla Rookh» de Thomas Moore;
grâce à lui, un grand nombre des meilleures productions des romantiques français et anglais purent
figurer dignement dans notre littérature.
Toutefois il serait injuste de juger les vingt dernières années de l’époque d’Àbo seulement par les
oeuvres poétiques qu’elles mirent au jour; cette époque, en effet, vit germer des idées nouvelles, qui
allaient être la source d’une nouvelle évolution de notre poésie; on 'sentit qu’après 1809 la littérature
aussi devait suivre en Finlande un développement indépendant, alors même que la langue de la culture
intellectuelle continuait à être le suédois. Ce fut Johan Jakob Tengstrôm (voir pp. 216 et 230) qui
aborda le premier cette question dans un article de l'«Aura», aussi remarquable par le fond que par la
forme et qui détermina un mouvement de l’opinion publique en ce sens. Pour conquérir ces nouvelles
bases d’un développement intellectuel indépendant, il fallait se rapprocher du peuple finnois, étudier avec
amour ses moeurs, ses chants, ses légendes et avant tout sa langue, que les classes cultivées, tout en
conservant leur langue maternelle, le suédois, devaient employer dans toutes les relations publiques avec
le peuple de langue finnoise. La littérature n’avait pas grand’chose à espérer des anciens mythes finnois,
mais dans ce rapprochement du coeur du peuple on puiserait une nouvelle vie et on briserait avec une
culture exclusivement intellectuelle, superficielle et égoïste. Cette pensée aussi belle que pratique s’accordait
avec l’idéal que chantait Linsén, tandis que, dans ses articles de la Mnemosyne, fidèle aux tendances
spéculatives de son temps, il définissait la nation comme un être, dont il fallait s’efforcer de développer
1 individualité, tout comme l’individu travaille à développer son caractère. Dans le «Morgonbladet», Arwidsson
allait plus loin encore: il. voyait dans la nation un être primitif, d’où les familles sortaient et où
elles retournaient, un organisme vivant, dont il ne faut pas seulement développer les particularités, mais
dont il faut encore écarter comme nuisible tout élément étranger. Ainsi donc on pensait beaucoup à
une poésie nationale, puisée à la source de l’élément finnois : mais en réalité, par habitude et faute d’originalité,
on marchait sur les traces des mouvements littéraires en Suède. On entrevoyait par la pensée
un nouvel idéal, mais le peu qu’on produisait était dans le vieux goût académique et «gothique».
Runeberg et le s Veillées du samedi. Lars Stenback. Le temps qui précéda 1840. Il y
avait alors à Âbo un groupe de jeunes hommes, entrés à l’Université vers 1820, qui travaillaient à leur
licence et se préparaient à un avenir dont personne alors ne pouvait pressentir l’importance pour la
patrie. Plusieurs d’entre eux, J o h a n Jakob N e r v a n d e r (voir p. 246), Johan V i l h e lm S n e l lm a n (voir p.
23°)> J ° h a n L u d v i g R u n e b e r g (1804— 1877) et quelques-uns des condisciples de ce dernier à l’école de
Vasa, appartenaient à la section des étudiants de l’Ostrobothnie; d’autres s’étaient associés à eux, bien
que venant d autres provinces: B e n g t Olof L i l l e (1807— 1875), de Heinola, E l i a s L ô n n r o t , nylandais,
et F r e d r i k C y g n a e u s (1807— 1881), qui était venu de Saint-Pétersbourg à l’Université d’Âbo. Ils étaient
presque tous pauvres et trouvaient les moyens de poursuivre leurs études en s’imposent des privations
et en donnant des leçons. Ils étaient passionnés de littérature; ils aimaient surtout la poésie qui était
née en Suède de la lutte entre les romantiques et l’école académique. Franzén était leur vrai père en
poésie, mais ils étudiaient aussi Tegnér, Stagnelius, Madame Lenngren, et, parmi les plus anciens, Bellman
et Lidner. Plusieurs s’exerçaient avec zèle à l’art des vers; encore sur les bancs du collège de Vasa,
Runeberg avait écrit, tantôt sérieusement, tantôt par plaisanterie, des morceaux dans la manière de
265
Choræus, de Lidner, de Bellman et célébré une chasse au loup, dont il avait été témoin, dans une intention
plutôt' plaisante, mais en hexamètres plus élégants que ceux de beaucoup de poètes plus mûrs.
Inconnus du publie, ils s’étaient formés en complète indépendance des poètes de l’époque d’Âbo. Nervander,
Je plus avancé d’eux tous,, s’était fait connaître comme une merveille de science précoce aux
promotions de 1827, où il occupait la place d’honneur, mais ce qu’on ne savait pas, c’est qu’à l’âge de
quinze ans il avait' écrit des élégies d’une forme très pure sur le néant de la vie et qu’il avait un tiroir
plein de pièces lyriques : quoi d’ëtonnant, du reste, quand on ne soupçonnait même pas qu’il était marié
depuis l’âge de vingt et un ans! Lille et Runeberg avaient aussi été couronnés à la même fête des
promotions; tous deux avaient fait insérer deux ou trois morceaux dans le journal de Sjôstrôm «Âbo
tidningar», mais seuls - les amis qui avaient reçu les confidences du jeune poète savaient que Runeberg
travaillait -déjà alors à un poème narratif, «La châsse à l’élan», destiné à occuper une place éminente
dans notre histoire littéraire, «peut-être ce qu’il a été écrit de plus exquis sur la terre de Finlande»,
comme Cygnaeus écrivait alors déjà dans une lettre à son père, l’évêque.
- Cygnaeus lui-même, dont la première éducation, faite à Saint-Pétersbourg, avait rendu l’oreille moins
sensible aux nuances de sa langue maternelle, travaillait en silence à vaincre ces difficultés et à plier à
la loi- des vers sa pensée rebelle; mais, généreux comme toujours, il n’en admirait que plus la sûreté de
main du jeune maître et voulait qu’il fit immédiatement imprimer son poème en le dédiant au comte
Rehbinder. Mais Runeberg, avec cette sévérité pour lui-même qui l’a toujours distingué, et ayant du
reste conscience que la poésie serait pour lui une haute et sainte mission, laissa reposer son poème en
attendant que son génie eût atteint une plus pleine maturité; à cet égardpj|année qui suivit la fête des
promotions et l’incendie, année qu’il passa dans la famille de l’archevêque Tengstrôm, à Pargas, fut d’une
grande importance. Dans les aimables prémices de sa muse, on perçoit des réminiscences de Franzén,
de Stagnelius, de Bellman, de Tegnér et des échos des lyriques de l’antiquité; mais on y trouve aussi
des pièces où son individualité commence à s’affirmer, sans emprunter des formes étrangères. Une certaine
mélancolie prévaut dans ces premiers essais de Runeberg, comme dans ceux de Nervander, de
Lille, de Cygnaeus; cette mélancolie avait chez lui une cause tout accidentelle, une affection passagère
dès poumons, car elle était en réalité étrangère à sa nature saine, à son humeur joyeuse, parfois presque
bouffonne. Il épuisa cette veine mélancolique jusqu’à la dernière goutte dans Son premier grand poème,
«Les nuits de jalousie», commencé en 1828. Ce poème en cinq monologues, tantôt élégiaques, tantôt
narratifs ou descriptifs, est le dernier1 où il emprunte à d’autres : la langue achevée, débordant de personnifications
et d’images, y rappelle celle de Stagnelius, et c’est au même modèle qu’il faut attribuer
l’ardeur sensuelle du sentiment, la défiance et la désolation inspirées par les réalités de la vie, qui marquent
ce. poème d’un caractère tout différent des autres oeuvres de Runeberg.
Un autre élément allait encore contribuer à déterminer le développemant du jeune poète: l’amour.
Runeberg s’éprit, à Pargas, de Fredrika Tengstrôm, une jeune parente de l’archevêque, chez qui elle
s’était réfugiée avec sa mère après l’incendie d’Âbo. Cet amour, fort et profond, cherchait volontiers
son expression poétique dans des pièces dans le mode antique; mais dans sa vie, il contribua à déterminer
la résolution qu’il prit alors de se faire une carrière universitaire, en même temps qu’il eut conscience
que la poésie était sa véritable vocation.
Quand, à l’automne de 1828, les cours se rouvrirent à Helsingfors, le cercle d’amis s’y trouva de
nouveau réuni, et on vit bientôt que c'était une génération merveilleusement douée que l’ancienne ville
universitaire léguait ainsi à la nouvelle. Un lecteur attentif du journal les «Nouvelles de Helsingfors».
que Sjôstrôm fonda en 1829, aurait pu voir par ses articles en prose et en vers qu’un jour nouveau se
levait pour notre littérature. Bien que voués à des branches très différentes de la science, ces jeunes
écrivains étaient réunis par le lien d’un intérêt commun pour les questions touchant aux lettres, à la
philosophie, à la patrie. Les coryphées de ce cercle étaient Nervander et Runeberg, tous deux d’une
disposition gaie et expansive unie à de grands dons intellectuels, celui-là d’un esprit plus agile et plus
étincelant, celui-ci plus cordial et plus humoriste. Snellman, qui avait quitté la théologie pour la