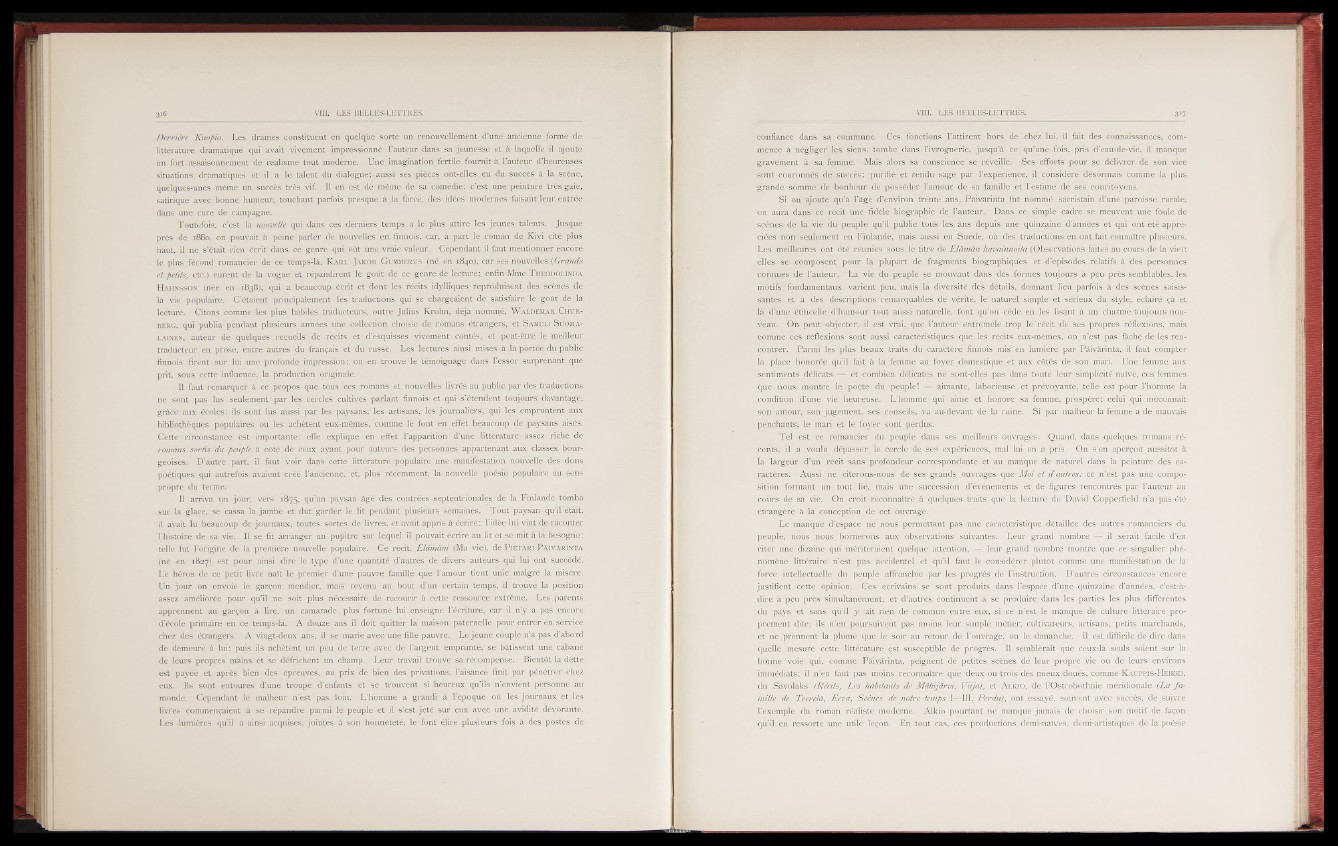
Derrière Kuopio. Les drames constituent en quelque sorte un renouvellement d’une ancienne forme de
littérature dramatique qui avait vivement impressionné l’auteur dans sa jeunesse et à laquelle il ajoute
un fort assaisonnement de réalisme tout moderne. Une imagination fertile fournit à l’auteur d’heureuses
situations dramatiques et il a le talent du dialogue; aussi ses pièces ont-elles,eu du succès à la. scène,
quelques-unes même un succès très vif. Il en est de même de sa comédie: c’est une peinture très gaie,
satirique avec bonne humeur, touchant parfois presque à la farce, des idées modernes faisant leur entrée
dans une cure de campagne.
Toutefois, c’est la nouvelle qui dans ces derniers temps a le plus attiré les jeunes talents. Jusque
près de 1880, on pouvait à peine parler de nouvelles en finnois, car, à part le roman de Kivi cité plus
haut, il ne s’était rien écrit dans ce genre qui eût une vraie valeur. Cependant il faut mentionner encore
le plus fécond romancier de ce temps-là, K a r l Ja ko b G ummerus (né en 1840), car ses nouvelles (Grands
et petits, etc.) eurent de la vogue et répandirent le goût de ce genre de lecture; enfin Mme T heodolinda
Hahnsson (née en 1838), qui a beaucoup écrit et dont les récits idylliques reproduisent des scènes de
la vie populaire. C’étaient principalement les traductions qui se chargeaient de satisfaire le goût de la
lecture. Citons comme les plus habiles traducteurs, outre Julius Krohn, déjà nommé, W a ld em a r C hur-
b e r g , qui publia pendant plusieurs années une collection choisie de romans étrangers, et S amuli S uoma-
lainen, auteur de quelques recueils de récits et d’esquisses vivement contés, et peut-être le meilleur
traducteur en, prose, entre autres du français et du russe. Les lectures ainsi mises à la portée du public
finnois firent sur lui une profonde impression: on en trouve le témoignage dans l’essor surprenant que
prit, sous cette influence, la production originale.
Il faut remarquer à ce propos que tous ces romans et nouvelles livrés au public par des traductions
ne sont pas lus seulement par les cercles cultivés parlant finnois et qui s’étendent toujours davantage,
grâce aux écoles: ils sont lus aussi par les paysans, les-artisans, les journaliers, qui les empruntent aux
bibliothèques populaires ou les achètent eux-mêmes, comme le font en effet beaucoup de paysans aisés..
Cette circonstance est importante: elle expliqué en effet l’apparition d’une littérature assez riche de
romans sortis du peuple à côté de ceux ayant pour auteurs des personnes appartenant aux classes bourgeoises.
D’autre part, il faut voir dans cette littérature • populaire une manifestation nouvelle des dons
poétiques qui autrefois avaient créé l’ancienne, et, plus récemment, la nouvelle poésie populaire au. sens
propre du terme.
Il arriva un jour, vers 1875, qu’un paysan âgé des contrées septentrionales de la Finlande tomba
sur la glace, se cassa la jambe et dut garder le lit pendant plusieurs semaines, Tout paysan qu’il était,
il avait lu beaucoup de journaux, toutes sortes de livres, et avait appris à écrire: l’idée lui vint de raconter
l’histoire de sa vie. Il sè fit arranger un pupitre sur lequel il pouvait écrire au lit et se mit à la besogne :
telle fut l’origine de la première nouvelle populaire. Ce récit, Elâmàni (Ma vie), de P iet a r i P à iv â r in t a
(né en 1827) est pour ainsi dire le type d’une quantité d’autres de divers auteurs qui lui ont succédé.
Le héros de ce petit livre naît le premier d’une pauvre famille que l’amour tient unie malgré la misère.
Un jour on envoie le garçon mendier, mais' revenu au bout d’un certain temps, il trouve la position
assez améliorée pour qu’il ne soit plus nécessaire de recourir à cette ressource extrême. Les parents
apprennent au garçon à lire, un camarade plus fortuné lui enseigne l’écriture, car il n’y a pas encore
d’école primaire en ce temps-là. A douze ans il doit quitter la maison paternelle pour entrer en service
chez des étrangers. A vingt-deux ans, il se marie avec une fille pauvre. Le jeune couple n’a pas d’abord
de demeure à lui; puis ils achètent un peu de terre avec de l’argent emprunté, se bâtissent une cabane
de leurs propres mains et se défrichent un champ. Leur travail trouve sa récompense. Bientôt la dette
est payée et après bien des épreuves, au prix de bien des privations, l’aisance finit par pénétrer chez
eux. Ils sont entourés d’une troupe d’enfants et se trouvent si heureux qu’ils n’envient personne au
monde. Cependant le malheur n’est pas loin. L ’homme a grandi à l’époque où les journaux et les
livres commençaient à se répandre parmi le peuple et il s’est jeté sur eux avec une avidité dévorante.
Les lumières qu’il a ainsi acquises, jointes à son honnêteté, le font élire plusieurs fois à des postes de
confiance dans sa commune. Ces fonctions l’attirent hors de chez lui, il fait des connaissances, commence
à négliger les siens,, tombe dans l’ivrognerie, jusqu’à ce qu’une fois, pris d’eau-de-vie, il manque
gravement à sa femme. Mais alors sa conscience se réveille. Ses efforts pour se délivrer de son vice
sont couronnés de succès: purifié et rendu sage par l’expérience,' il considère désormais comme la plus
grande somme de -bonheur de posséder l’amour de sa famille et l ’estime de ses concitoyens.
Si on ajoute qu’à l’âge d’environ trente ans, Pàivârinta fut nommé sacristain d’une paroisse rurale,
on aura dans' ce récit une fidèle biographie de l’auteur. Dans ce simple cadre se meuvent une foule de
scènes de la vie du peuple qu’il publie tous les ans depuis une quinzaine d’années et qui ont été appréciées
npn seulement en Finlande, mais aussi en Suède, où des traductions en ont fait connaître plusieurs.
Les meilleures ont été réunies sous le titre de Elàmàn havainnoita (Observations faites au cours de la vie) ;
elles se composent pour la plupart de- fragments biographiques et d’épisodes relatifs à des personnes
connues de l’auteur. La vie du peuple se mouvant dans ‘dès formes toujours à peu près semblables, les
motifs fondamentaux varient peu, mais la diversité des détails, donnant-lieu parfois à des scènes saisissantes
et à des descriptions remarquables: de vérité, le naturel simple et sérieux du style, éclairé çà et
là d’une étincelle d’humour tout aussi-naturelle, font qu’on cède en les lisant à un charme toujours nouveau.
On peut objecter, il est vrai, que l’auteur entremêle trop le'récit de ses propres réflexions, mais
comme ces réflexions sont aussi caractéristiques que les récits eux-mêmes,-on n’est pas fâché de les rencontrer.
Parmi les plus beaux traits du caractère finnois mis en lumière par Pàivârinta, il faut compter
la place honorée qu’il fait à la femme au foyer domestique et aux côtés de son mari. Une femme aux
sentiments délicats — /.et combien délicates ne sont-elles pas dans toute leur simplicité naïve, ces femmes
que nous montre le poète du peuple! — aimante, laborieuse et prévoyante, telle est pour l’homme la
condition d’une vie heureuse. L ’homme qui aime et honore sa femme, prospère ; celui qui méconnaît
son amour, son jugement, ses conseils,, va au-devant de la ruine. Si par malheur la femme a de mauvais
penchants, le mari et le foyer sont perdus.
Tel est ce romancier du peuple dans ses meilleurs ouvrages. Quand, dans quelques romans récents,
il a voulu dépasser le cercle de ses expériences, mal lui en a pris. On s’en aperçoit aussitôt à
la largeur d’un récit sans profondeur correspondante et au manque de naturel dans la peinture des caractères.
Aussi ne citerons-nous de ses grands ouvrages que Moi et d’autres: çè n’est pas une composition
formant un tout lié', mais une succession d’événements et de figures rencontrés par l’auteur au
cours de sa vie. On croit reconnaître à quelques traits que la lecture de David Copperfield n’a pas été
étrangère à la conception de cet ouvrage.
Le manque d’espace ne nous permettant pas une caractéristique détaillée des autres romanciers du
peuple, nous nous bornerons aux observations suivantes. Leur grand nombre ^gwl serait facile d’en
citer une dizaine qui mériteraient quelque attention, — leur grand nombre montré que ce singulier phénomène
littéraire n’est pas accidentel et qu’il faut le considérer plutôt comme une manifestation de la
force intellectuelle du peuple affranchie par les progrès de l'instruction. D’autres circonstances encore
justifient cette opinion. Ces écrivains se sont produits dans l’espace d’une quinzaine d’années, c’est-à-
dire à peu près simultanément, et d’autres continuent à sè produire dans les parties lés plus différentes
du pays et sans qu’il y ait rien de commun entre eux, si ce n’est le manque de culture littéraire proprement
dite; ils n’en poursuivent pas moins leur simple métier, cultivateurs, artisans, petits marchands,
et ne prennent la plume que lè soir au retour de l’ouvrage, ou le dimanche. II est difficile de dire dans
quelle mesure cette littérature est susceptible de progrès. Il semblerait que ceux-là seuls soient sur la
bonne voie qui, comme Pàivârinta, peignent de petites scènes de leur propre vie ou de leurs environs
immédiats; il n’en faut pas moins reconnaître que deux ou trois des mieux doués, comme K a u p p is -He ik k i,
du Savolaks (Récits, Les habitants de Màkijàrvi, Viija), et Alkio, de l’Ostrobothnie méridionale (La fa mille
de Teerela, Eeva, Scènes de notre temps I— III, Perdu), ont essayé, souvent avec succès, de suivre
l’exemple du roman réaliste moderne. Alkio pourtant ne manque jamais de choisir son motif de façon
qu’il en ressorte une utile leçon. En tout cas, ces productions demi-naïves, demi-artistiques de la poésie