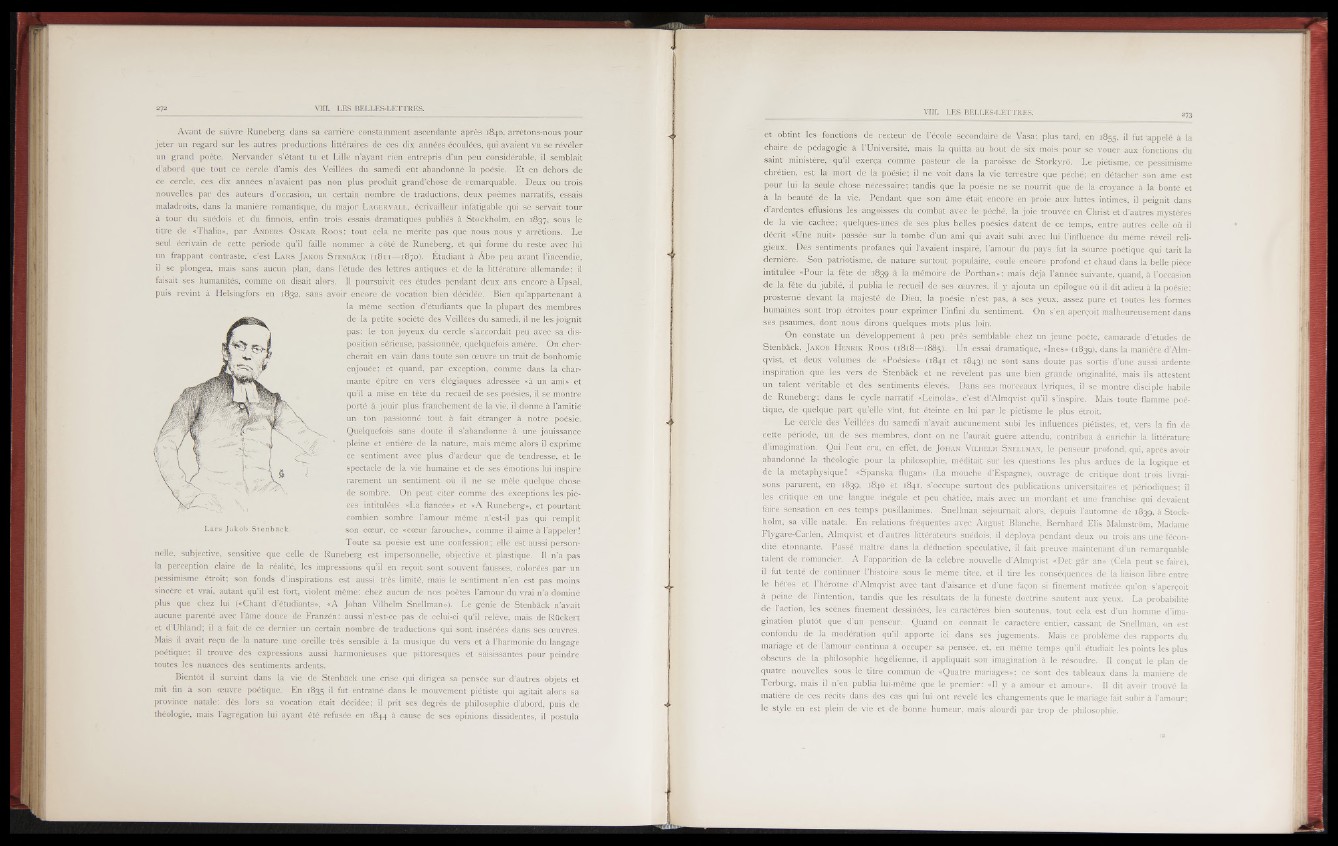
Avant de suivre Runeberg dans sa carrière constamment ascendante après 1840, arrêtons-nous pour
jeter un regard sur les autres productions littéraires de ces dix années écoulées, qui avaient vu se révéler
un grand poète. Nervander s’étant tu et Lille n’ayant rien entrepris d’un peu considérable, il semblait
d’abord que tout ce cercle d’amis des Veillées du samedi eût abandonné la poésie. Et en dehors de
ce cercle, ces dix années n’avaient pas non plus produit grand’chose de remarquable. Deux ou trois
nouvelles par des auteurs d’occasion, un certain nombre de traductions, deux poèmes narratifs, essais
maladroits, dans la manière romantique, du major L a g e r v a l l , écrivailleur infatigable qui se servait tour
à tour du suédois et du finnois, enfin trois essais dramatiques publiés à Stockholm, en 1837, sous le
titre de «Thalia», par A n d e r s O s k a r R o o s : tout cela ne mérite pas que nous nous y arrêtions. Le
seul écrivain de cette période qu’il faille nommer à côté de Runeberg, et qui forme du reste avec lui
un frappant contraste, c’est L a r s Ja k o b S t e n b à c k (181 i— 1870). Étudiant à Àbo peu avant l’incendie,
il se plongea, mais sans aucun plan, dans l’étude des lettres antiques et de la littérature allemande; il
faisait ses humanités, comme on disait alors. Il poursuivit ces études pendant deux ans encore à Upsal,
puis revint à Helsingfors en 1832, sans avoir encore de vocation bien 'décidée. Bien qu’appartenant à
la même section d’étudiants que la plupart des membres
de la petite société des Veillées du samedi, il ne les joignit
pas: le ton joyeux du cercle s’accordait peu avec sa disposition
sérieuse, passionnée, quelquefois amère. On chercherait
en vain dans toute son oeuvre un trait de bonhomie
enjouée; et quand, par exception, comme dans la charmante
épitre en vers élégiaques adressée «à un ami» et
qu’il a mise en tête du recueil de ses poésies, il se montre
porté à jouir plus franchement de la vie, il donne à l’amitié
un ton passionné tout à fait étranger à notre poésie.
Quelquefois sans doute il s’abandonne à une jouissance
pleine et entière de la nature, mais même alors il exprime
cë sentiment avec plus d’ardeur que de tendresse, et le
spectacle de la vie humaine et de ses émotions lui inspire
rarement un sentiment où il ne se mêle quelque chose
de sombre. On peut citer comme des exceptions les pièces
intitulées «La fiancée» et «A Runeberg», et pourtant
combien sombre l’amour même n’est-il pas qui remplit
son coeur, ce «coeur farouche», comme il aime à l’appeler!
Toute sa poésie est une confession; elle est aussi personnelle,
subjective, sensitive que celle de Runeberg est impersonnelle, objective et plastique; Il n’a pas
la perception claire de la réalité, les impressions qu’il en reçoit sont souvent fausses, colorées par un
pessimisme étroit;-son fonds d’inspirations est aussi très limité, mais le sentiment n’en est pas moins
sincère et vrai, autant qu’il est fort, violent même: chez aucun de nos poètes l’amour du vrai n’a dominé
plus que chez lui («Chant d’étudiants», «A Johan Vilhelm Snellman»). Le génie de Stenbàck n’avait
aucune parenté avec l’âme douce de Franzén: aussi n’est-ce pas dé celui-ci qu’il relève, mais de Rückert
et d’Uhland; il a fait de ce dernier un certain nombre de traductions qui sont insérées dans ses oeuvres.
Mais il avait reçu de la nature une oreille très sensible à la musique du vers et à l’harmonie du langage
poétique; il trouve des expressions aussi harmonieuses que pittoresques et saisissantes pour peindre
toutes les nuances des sentiments ardents.
Bientôt il survint dans la vie de Stenbàck une crise qui dirigea sa pensée sur d’autres objets et
mit fin à son oeuvre poétique. En 1835 il fut entraîné dans le mouvement piétiste qui agitait alors sa
province natale: dès lors sa vocation était décidée; il prit ses degrés de philosophie d’abord, puis de
théologie, mais l’agrégation lui ayant été refusée en 1844 à cause de ses opinions dissidentes, il postula
et obtint les fonctions de recteur de l ’é c o le secondaire de Vasa; plus tard, en 1855, il fut 'appelé à la
• chaire de pédagogie à l’Université, mais la quitta au bout de six mois pour se vouer aux fonctions du
saint m in is t è r e , qu’il exerça comme pasteur dé la paroisse de Storkyrô. Le piétisme, ce pessimisme
chrétien, est la mort de la poésie; il ne voit dans la vie terrestre que péché; en détacher son âme est
pour lui la seule chose nécessaire; tandis- que la poésie ne se nourrit que de la croyance à la bonté et
à la beauté de la vie. Pendant que son âme était encore en proie aux luttes intimes, il peignit dans
d’ardentes effusions les angoisses du combat avec le péché, la joie trouvée en Christ et d’autres mystères
de la vie cachée; quelques-unes de ses plus belles poésies datent de ce temps, entre autres celle où il
d é c r i t «Une nuit» passée sur la tombe d’un ami qui avait subi avec lui l’influence du même réveil reli^
gieux. Des sentiments profanes qui l’avaient inspiré, l’amour du pays fut la source poétique qui tarit la
dernière. Son patriotisme, de nature surtout populaire, coule encore profond et chaud dans la belle pièce
intitulée «Pour la fête de 1839 à la mémoire de Porthan»; mais déjà l’année suivante, quand, à l’occasion
de l a fête du jubilé, il publia le recueil de ses oeuvres, il y ajouta un épilogue où il dit adieu à la poésie:
prosterné devant la majesté de Dieu, la poésie n’est pas, à ses yeux, assez pure et toutes les formes
humaines, sont trop étroites pour exprimer l’infini .du sentiment. On s’en aperçoit malheureusement dans
■ ses- psaumes, dont nous dirons quelques mots plus loin.
O n constate un développement à peu près semblable chez un jeune poète, camarade d’études de
Stenbàck, Ja k o b H e n r ik R o o s (1818— 1885). Un essai dramatique, «Inès» (1839), dans la manière d’Alm-
qvist, et deux volumes de «Poésies» (1841 et 1843) nê sont sans doute pas sortis d’une aussi ardente
inspiration que les vers de Stenbàck et ne révèlent pas une bien grande originalité, mais ils attestent
In talent véritable et des sentiments élevés. Dans ses morceaux lyriques, il se montre disciple habile
de Runeberg; dans le cycle narratif «Leinola», c’est d’Almqvist qu’il s’inspire. Mais toute flamme poétique,
de quelque part qu’elle vînt, fut éteinte en lui par le piétisme le plus étroit.
Le c e r c l e des Veillées du samedi n’avait aucunement subi les influences piétistes, et, vers la fin de
cette période, un de ses membres, dont on ne l’aurait guère attendu, contribua à enrichir la littérature
d’imagination. Qui l’eût cru, en effet, de Jo h a n V ilh e lm S n e l lm a n , le penseur profond, qui, après avoir
abandonné la théologie pour la philosophie, méditait sur les questions les plus ardues de la logique et
de la métaphysique ! «Spanska flugan» (La mouche d’Espagne), ouvrage de critique dont trois livraisons
parurent, en 1839, 1840 et 1841, s’occupe surtout des publications universitaires et périodiques; il
les critique en une langue inégale et peu châtiée, mais avec un mordant et une franchise qui devaient
faire sensation en ces temps pusillanimes. Snellman séjournait alors, depuis l’automne de 1839. à Stockholm,
sa ville natale. En relations fréquentes avec August Blanche, Bernhard Elis Malmstrôm, Madame
Flygare-Carlén, Almqvist et d’autres littérateurs suédois, il déploya pendant deux ou trois ans une fécondité
étonnante. Passé maître dans la déduction spéculative, il fait preuve maintenant d’un remarquable
talent de romancier. A l’apparition de la célèbre nouvelle d’Almqvist «Det gâr an» (Cela peut se faire),
il fut tenté de continuer l’histoire .sous le même titre, et il tire les conséquences de la liaison libre entre
le héros et l’héroïne d’Almqvist avec tant d’aisance et d’une façon si finement motivée qu’on s’aperçoit
à peine de l’intention, tandis que les résultats de la funeste doctrine sautent aux yeux. La probabilité
de l’action, les scènes finement dessinées, les caractères bien soutenus, tout cela est d’un homme d’imagination
plutôt que d’un penseur. Quand on connaît le caractère entier, cassant de Snellman, on est
confondu de la modération qu’il apporte ici dans ses jugements. Mais ce problème des rapports du
mariage et de l’amour continua à occuper sa pensée, et, en même temps qu’il étudiait les points les plus
obscurs de la philosophie hégélienne, il appliquait- son imagination à le résoudre. Il conçut le plan de
quatre nouvelles sous le titre commun de «Quatre mariages»; ce sont des tableaux dans la manière de
Terburg, mais il n’en publia lui-même que le premier: «Il y a amour et amour». Il dit avoir trouvé la
matière de ces récits dans des cas qui lui ont révélé les changements que le mariage fait subir à l’amour;
le style en est plein de vie et de bonne humeur, mais alourdi par trop de philosophie.