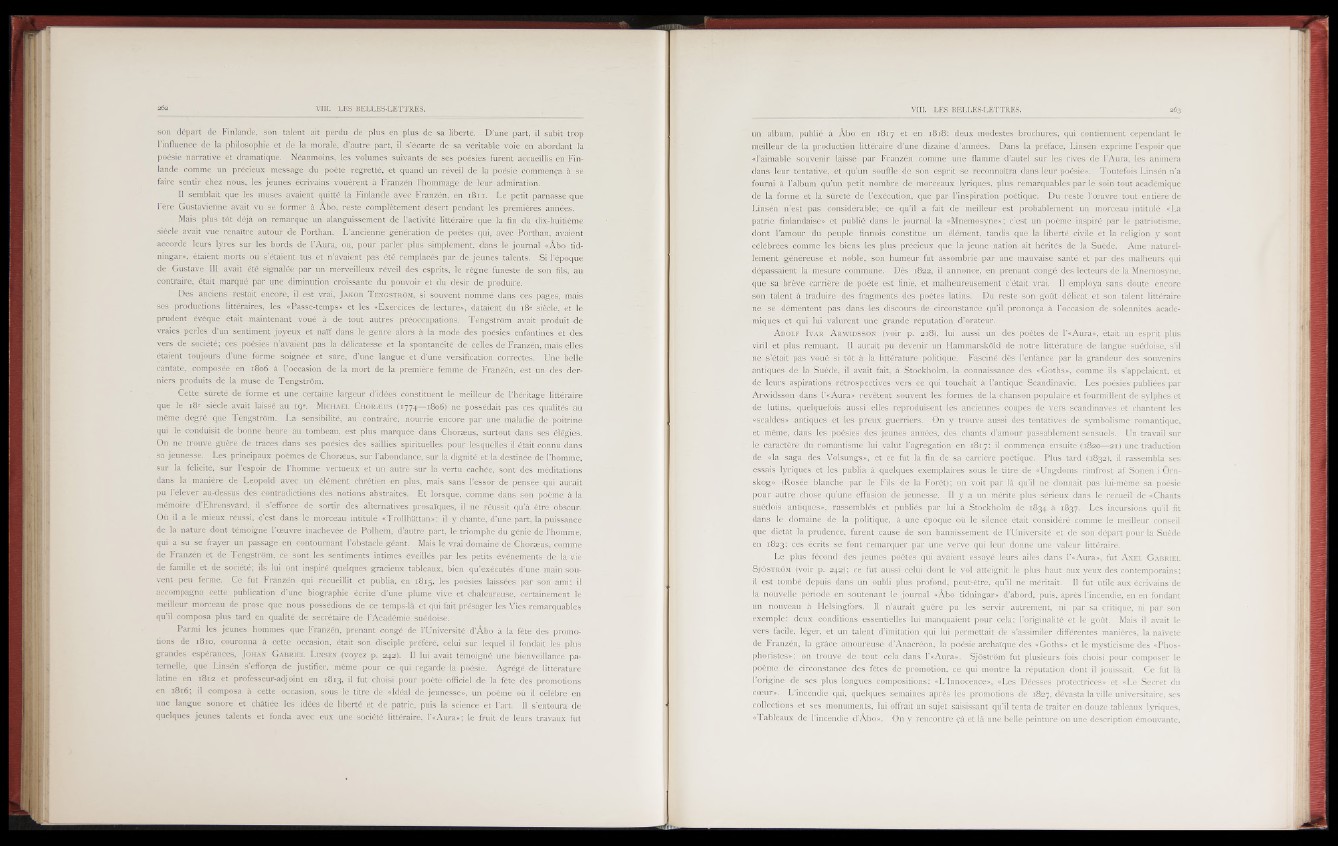
son départ de Finlande, son talent ait perdu de plus en plus de sa liberté. D’une part, il subit trop
l’influence de la philosophie et de la morale, d’autre part, il s’écarte de sa véritable voie en abordant la
poésie narrative et dramatique. Néanmoins, les volumes suivants de ses poésies furent accueillis en Finlande
comme un précieux message du poète regretté, et quand un réveil de la poésie commença à se
faire sentir chez nous, les jeunes écrivains vouèrent à Franzén l’hommage de leur admiration.
Il semblait que les muses avaient quitté la Finlande avec Franzén, en 1811. Le petit parnasse que
l’ère Gustavienne avait vu se former à Âbo, reste complètement désert pendant les premières années.
Mais plus tôt déjà on remarque un alanguissement de l’activité littéraire que la fin du dix-huitième
siècle avait vue renaître autour de Porthan. L ’ancienne génération de poètes qui, avec Porthan, avaient
accordé leurs lyres sur les bords de PAura, ou, pour parler plus simplement, dans le'journal «Âbo tid-
ningar», étaient morts ou s’étaient tus et n’avaient pas été remplacés par de jeunes talents. Si l’époque
de Gustave III avait été signalée par un merveilleux réveil dès esprits, le règne funeste de son fils, au
contraire, était marqué par une diminution croissante du pouvoir et du désir de produire.
Des anciens restait encore, il est vrai, Ja k o b T engstrôm, si souvent nommé dans ces pages, mais
ses productions littéraires, les «Passe-temps» et les «Exercices de lecture», dataient du 18« siècle, et le
prudent évêque était- maintenant voué à de tout autres préoccupations, Tengstrôm avait produit de
vraies perles d’un sentiment joyeux et naïf dans le genre alors à la mode des poésies enfantines et des
vers de société; ces poésies n’avaient pas la délicatesse et la spontanéité de celles de Franzén, mais elles
étaient toujours d’une forme soignée et sûre, d’une langue et d’une versification correctes. Une belle
cantate, composée en 1806 à l’occasion de la mort de la première femme de Franzén, est un des derniers
produits de la muse de Tengstrôm.
Cette sûreté de forme et une certaine largeur d’idées constituent le meilleur de l’héritage littéraire
que le 18« siècle avait laissé au 19e. M ic h a e l C h o ræ u s (17 74— 1806) ne possédait pas ces qualités au
même degré que Tengstrôm. La sensibilité, au contraire, nourrie encore par une maladie de poitrine
qui le conduisit de bonne heure au tombeau, est plus marquée dans Choræus, surtout dans ses élégies.
On ne trouve guère de traces dans ses poésies des saillies spirituelles pour lesquelles il était connu dans
sa jeunesse. Les principaux poèmes de Choræus, sur l’abondance, sur la dignité et la destinée de l’homme,
sur la félicité, sur l’espoir de l’homme vertueux et un autre sur la vertu cachée, sont des méditations
dans la manière de Leopold avec un élément chrétien en plus, mais sans l’essor de pensée qui aurait
pu l’élever au-dessus des contradictions des notions abstraites. Et lorsque, comme dans son poème à la
mémoire d’Ehrensvârd, il s’efforce de sortir des alternatives prosaïques, il ne réussit qu’à être obscur.
Où il a le mieux réussi, c’est dans le monceau intitulé «Trollhàttan»: il y chante, d’une part, la puissance
de la nature dont témoigne l’oeuvre inachevée de Polhem, d’autre part, le triomphe du génie de l’homme,
qui a su se frayer un passage en contournant l’obstacle géant. Mais le vrai domaine de Choræus, comme
de Franzén et de Tengstrôm, ce sont les sentiments intimes éveillés par les petits événements de la vie
de famille et de société; ils lui ont inspiré quelques gracieux tableaux, bien qu’exéeutés d’une main soiL
vent peu ferme. Ce fut Franzén qui rëcueillit et publia, en 1815, les poésies laissées par son ami; il
accompagna cette publication d’une biographie écrite d’une plume vive et chaleureuse, certainement le
meilleur morceau de prose que nous possédions de ce temps-là et qui fait présager les Vies remarquables
qu’il composa plus tard en qualité de secrétaire de l’Académie suédoise. '
Parmi les jeunes hommes que Franzén, prenant congé de l’Université d’Âbo à la fête des promotions
de 1810, couronna à cette occasion, était son disciple préféré, celui sur lequel il fondait les plus
grandes espérances, Johan G a br ie l L insén (voyez p. 242). Il lui avait témoigné une bienveillance paternelle,
que Linsén s’efforça de justifier, même pour ce qui regarde la poésie. Agrégé de littérature
latine en 1812 et professeur-adjoint en 1813, il fut choisi pour poète officiel de la fête des promotions
en 1816; il composa à cette occasion, sous le titre de «Idéal de jeunesse», un poème où il célèbre en
une langue sonore et châtiée les idées de liberté et de patrie, puis la science et l’art. Il s’entoura de
quelques jeunes talents et fonda avec eux une société littéraire, l’«Aura»; le fruit de leurs travaux fut
VIII. LES BELLES-LETTRES. 263
un albüm, publié à Âbo en 1817 et -en 1818: deux modestes brochures, qui contiennent cependant le
meilleur de la production littéraire d’une dizaine d’années. Dans la préface, Linsén exprime l’espoir que
«l’aimable souvenir laissé par Franzén comme une flamme d’autel sur les rives de l’Aura, les animera
dans leur tentative, et qu’un souffle de son esprit se reconnaîtra dans leur poésie». Toutefois Linsén n’a
fourni à l’album qu’un petit nombre de morceaux lyriques, plus remarquables par le soin tout académique
de la forme et la sûreté de l’exécution, que par l’inspiration poétique. Du reste l’oeuvre tout entière de
Linsén n’est pas considérable; ce qu’il' a fait de meilleur est probablement un morceau intitulé «La
patrie finlandaise» et publié dans le. journal la «Mnemosyne»; c’est un poème inspiré par le patriotisme,
dont l’amour du peuple finriois constitue un élément, tandis que la liberté civile et la religion y sont
célébrées comme les biens les plus précieux que la jeune nation ait hérités de la Suède. Ame naturellement
généreuse et noble, son humeur fut assombrie par une mauvaise santé et par des malheurs qui
dépassaient la mesure commune. Dès 1822, il annonce, en prenant congé des lecteurs de la Mnemosyne,
que sa brève carrière de poète est finie, et malheureusement c’était vrai. Il employa sans doute encore
son talent à traduire des fragments des poètes latins. Du reste son goût délicat et son talent littéraire
ne se démentent pas dans les discours de circonstance qu’il prononça à l’occasion de solennités académiques
et qui lui valurent une grande réputation d’orateur.
A d o l f I v a r A rw id s s o n (voir p. 218), lui aussi un des poètes de l’«Aura», était un esprit plus
viril et plus remuant. Il aurait pu devenir un Hammarskôld de notre littérature de langue suédoise, s’il
ne s’était pas voué si tôt à la littérature politique. Fasciné dès l’enfance par la grandeur des souvenirs
antiques de la- Suède, il avait fait, à Stockholm, la connaissance des «Goths», comme ils s’appelaient, et
de leurs aspirations rétrospectives vers ce qui touchait à l’antique Scandinavie. Les poésies publiées par
Arwidsson dans 1’«Aura» revêtent souvent les formes de la chanson populaire et fourmillent de sylphes et
de lutins, quelquefois aussi elles reproduisent les anciennes coupes de vers Scandinaves et chantent les
«scaldes» antiques et les preux guerriers. On y trouve aussi des tentatives de symbolisme romantique,
et même, dans les poésies des jeunes années, des chants d’amour passablement sensuels. Un travail sur
le caractère du romantisme lui valut l’agrégation en 1817; il commença ensuite (1820—-21) une traduction
de «la saga des Volsungs», et ce fut la fin de sa carrière poétique. Plus tard (1832), il rassembla ses
essais lyriques et les publia à quelques exemplaires sou® le titre de «Ungdoms rimfrost af Sonen i Ôrn-
skog» (Rosée blanche par le Fils de la Forêt); on voit par là qu’il ne donnait pas lui-même sa poésie
pour autre chose qu’une effusion de jeunesse. Il y a un mérite plus sérieux dans le recueil de «Chants
suédois antiques», rassemblés et publiés par lui à Stockholm de 1834 à 1837. Les incursions qu’il fit
dans le domaine de la politique, à une époque où le silence était considéré comme le meilleur conseil
que dictât la prudence, furent cause de son bannissement de l’Université et de son départ pour la Suède
en 1823; ces écrits se font remarquer par une verve qui leur donne une valeur littéraire.
Le plus fécond des jeunes poètes qui avaient essayé leurs ailes dans l’«Aura», fut A xel G abriel
S jô s t r ôm (voir p. 242); ce fut aussi celui dont le vol atteignit le plus haut aux yeux des contemporains;
il est tombé depuis dans un oubli plus profond, peut-être, qu’il ne méritait. Il fut utile aux écrivains de
la nouvelle période en soutenant le journal «Âbo tidningar» d’abord, puis, après l’incendie, en en fondant
un nouveau à Helsingfors. Il n’aurait guère pu les servir autrement, ni par sa critique, ni par son
exemple: deux conditions essentielles lui manquaient pour cela: l’originalité et le goût. Mais il avait le
vers facile, léger, et un talent d’imitation qui lui permettait de s’assimiler différentes manières, la naïveté
de Franzén, la grâce amoureuse d’Anacréon, la poésie archaïque des «Goths» et le mysticisme des «Phos-
phoristes»: on trouve de tout cela dans F «Aura». Sjôstrôm fut plusieurs fois choisi pour composer le
poème de circonstance des fêtes dé promotion, ce qui montre la réputation dont il jouissait. Ce fut là
l’origine de ses plus longues compositions : «L’Innocence», «Les Déesses protectrices» et «Le Secret du
coeur». L ’incendie qui, quelques semaines après les promotions de 1827, dévasta la ville universitaire, ses
collections et ses monuments, lui offrait un sujet saisissant qu’il tenta de traiter en douze tableaux lyriques,
«Tableaux de l’incendie d’Àbo». On y rencontre çà et là une belle peinture ou une description émouvante.
W m