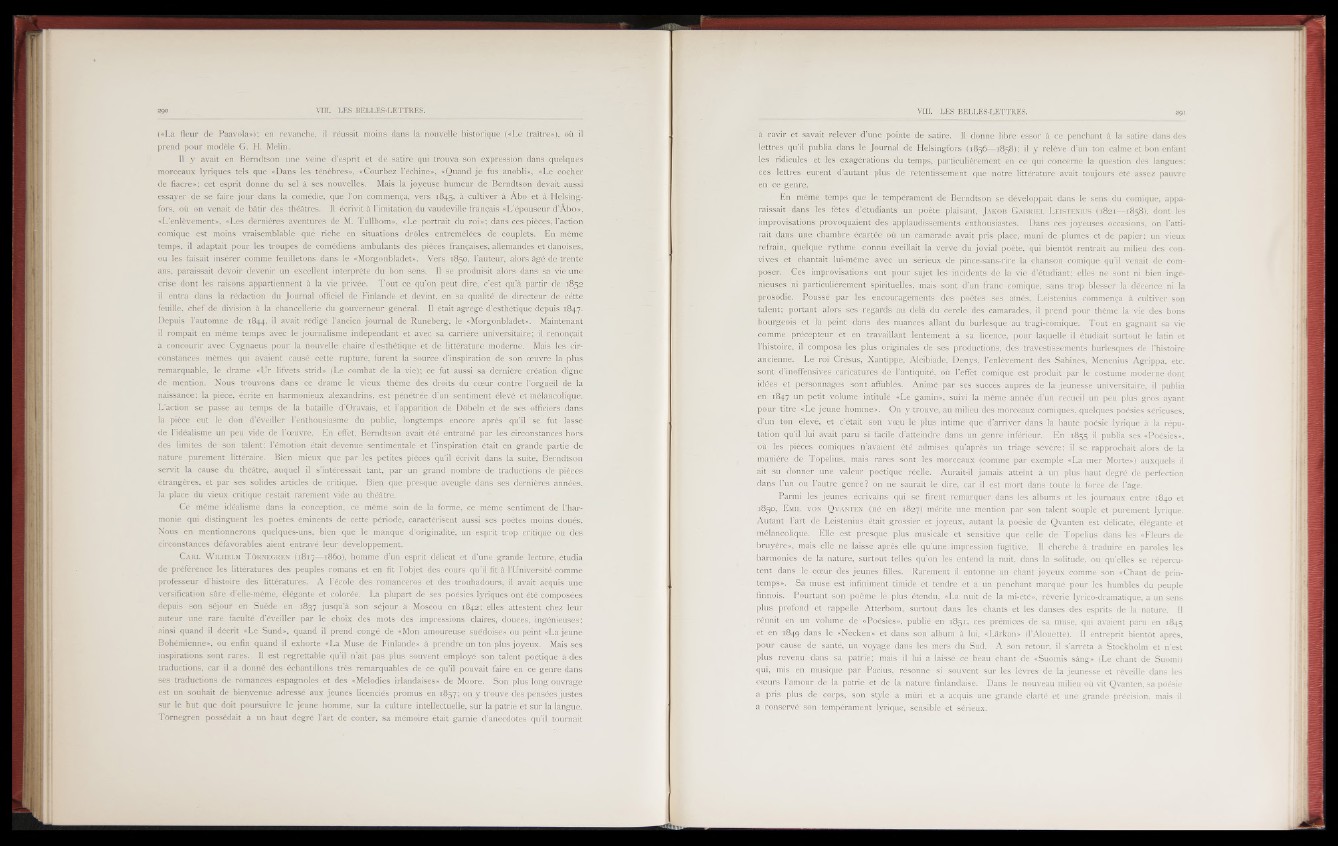
(«La fleur de Paavola») ; en revanche, il réussit moins dans la nouvelle historique («Le traître»), où il
prend pour modèle G. H. Melin.
Il y avait en Berndtson une veine d’esprit et de satire qui trouva son expression dans quelques
morceaux lyriques tels que «Dans les ténèbres», «Courbez I’échine», «Quand je fus anobli», «Le cocher
de fiacre»; cet esprit donne du sel à ses nouvelles. Mais la joyeuse humeur de Berndtson devait aussi
essayer de se faire jour dans la comédie, que l’on commença, vers 1845, à cultiver à Âbo et à Helsing-
fors, où on venait de bâtir des théâtres. Il écrivit à l’imitation du vaudeville français «L’épouseur d’Âbo»,
«L’enlèvement», «Les dernières aventures de M. Tullbom», «Le portrait du roi»; dans ces pièces, l’action
comique est moins vraisemblable que riche en situations drôles entremêlées de couplets. En même
temps, il adaptait pour les troupes de comédiens ambulants des pièces françaises, allemandes et danoises,
ou les faisait insérer comme feuilletons dans le «Morgonbladet». Vers 1850, l’auteur, alors âgé de trente
ans, paraissait devoir devenir un excellent interprète du bon sens. Il se produisit alors dans sa vié une
crise dont les raisons appartiennent à la vie privée. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’à partir de 1852
il entra dans la rédaction du Journal officiel de Finlande et devint, en sa qualité de directeur de cette
feuille, chef de division à la chancellerie du gouverneur général. Il était agrégé d’esthétique depuis 1847.
Depuis l’automne de 1844, il avait rédigé l’ancien journal de Runeberg, le «Morgonbladet». Maintenant
il rompait en même temps avec le journalisme indépendant et avec sa carrière universitaire; il renonçait
à concourir avec Cygnaeus pour la nouvelle chaire d’esthétique et de littérature moderne. Mais les circonstances
mêmes qui avaient causé cette rupture, furent la source d’inspiration de son oeuvre la plus
remarquable, le drame «Ur lifvets strid» (Le combat de la vie); ce fut aussi sa dernière création digne
de mention. Nous trouvons dans ce drame le vieux thème des droits du coeur contre l’orgueil de la
naissance; la pièce, écrite en harmonieux alexandrins, est pénétrée d’un sentiment élevé et mélancolique.
L ’action se passe au temps de la bataille d’Oravais, et l’apparition de Dôbeln et de ses officiers dans
la pièce eut le don d’éveiller l’enthousiasme du publi^longtemps encore après qu’il se fut lassé
de l’idéalisme un peu vide de l’oeuvre. En effet, Berndtson avait été entraîné par les circonstances hors
des limites de son talent: l’émotion était devenue sentimentale et l’inspiration était en grande partie de
nature purement littéraire. Bien mieux que par les petites pièces qu’il écrivit dans la suite, Berndtson
servit la cause du théâtre, auquel il s’intéressait tant, par un grand nombre de traductions de pièces*
étrangères, et par ses solides articles de critique. Bien que presque aveugle dans ses dernières années,
la place du vieux critique restait rarement vide au théâtre.
Ce même idéalisme dans la conception, ce même soin de la forme, ce même sentiment de l’harmonie
qui distinguent les poètes éminents de cette période, caractérisent aussi ses poètes moins doués.
Nous en mentionnerons quelques-uns, bien que le manque d’originalité, un esprit trop critique ou des
circonstances défavorables aient entravé leur développement.
C a r l W ilh e lm T ô r n e g r e n (1817— 1860), homme d’un esprit délicat et d’une grande lecture, étudia
de préférence les littératures des peuples romans et en fit l’objet des cours qu’il fit à l’Université comme
professeur d’histoire des littératures. A l’école des romanceros et des troubadours, il avait acquis une
versification sûre d’elle-même, élégante et colorée. La plupart de ses poésies lyriques ont été composées
depuis son séjour en Suède en 1837 jusqu’à son séjour à Moscou en 1842; elles attestent chez leur
auteur une rare faculté d’éveiller par le choix des mots des impressions claires, douces, ingénieuses;
ainsi quand il décrit «Le Sund», quand il prend congé de «Mon amoureuse Suédoise» ou peint «La jeune
Bohémienne», ou enfin quand il exhorte «La Muse de Finlande» à prendre un ton plus joyeux. Mais ses
inspirations sont rares. Il est regrettable qu’il n’ait pas plus souvent employé son talent poétique à des
traductions, car il a donné des échantillons très remarquables de ce qu’il pouvait faire en ce genre dans
ses traductions de romances espagnoles et des «Mélodies irlandaises» de Moore. Son plus long ouvrage
est un souhait de bienvenue adressé aux jeunes licenciés promus en 1857 ; on y trouve des pensées justes
sur le but que doit poursuivre le jeune homme, sur la culture intellectuelle, sur la patrie et sur la langue.
Tôrnegren possédait à un haut degré l’art de conter, sa mémoire était garnie d’anecdotes qu’il tournait
à ravir et savait relever d’une pointe de satire. Il donne libre essor à ce penchant à la satire dans des
lettres qu’il publia dans le Journal de Helsingfors (1856— 18 5 8 ); il y relève d’un ton calme et bon enfant
les ridicules et les exagérations du temps, particulièrement en ce qui concerne la question des langues:
ces lettres eurent d’autant plus de retentissement que notre littérature avait toujours été assez pauvre
en ce genre.
En même temps que le tempérament de Berndtson se développait dans le sens du comique, apparaissait
dans lés fêtes d’étudiants un poète plaisant, Ja k o b G a b r i e l L e i s t e n iu s (1821— 1858), dont les
improvisations provoquaient dés applaudissements enthousiastes. pË)ans ces joyeuses occasions, on l'attirait
dans une chambre écartée o ù u n camarade avait pris place, muni de plumes et de papier; un vieux
refrain, quelque rythme connu éveillait la verve du jovial poète, qui bientôt rentrait au milieu des convives
et chantait lui-même avec un sérieux de pince-sans-rire la chanson comique qu’il venait de composer.
C e s im p r o v i s a t io n s o n t pour sujet les incidents de la vie d’étudiant; elles ne sont ni bien ingénieuses
ni particulièrement spirituelles, mais sont d’un franc comique, sans trop blesser la décence ni la
p r o s o d ie . Poussé par les encouragements d e s poètes ses aînés, Leistenius commença à cultiver son
talent; portant alors ses regards au delà du cercle des camarades, il prend pour thème la vie des bons
b o u r g e o i s et la peint dans des nuances allant du burlesque au tragi-comique. Tout en gagnant sa vie
comme précepteur et en travaillant lentement à sa licence, pour laquelle il étudiait surtout le latin et
l’histoire, il c om p o s a les plus originales de ses productions, des travestissements burlesques de l’histoire
ancienne. Le roi Crésus, Xantippe, Aleibiade, Denys, l’enlèvement des Sabines, Menenius Agrippa, etc.
Sont d’inoffensiVes caricatures de l’antiquité, où l’effet comique est produit par le costume moderne dont
idées et personnages sont affublés. Animé par ses succès auprès de la jeunesse universitaire, il publia
en 1847 un petit volume intitulé «Le gamin», suivi la même année d’un recueil un peu plus gros ayant
pour titre «Le jeune homme». On y trouve, au milieu des morceaux comiques, quelques poésies sérieuses,
d ’u n to n élevé, et c’était son voeu le plus intime que d’arriver dans la haute poésie lyrique à la réputation
qu’il lui avait paru si facile d’atteindre dans un genre inférieur. En 1855 il publia ses «Poésies»,
où les pièces comiques n’avaient été admises qu’après un triage sévère; il se rapprochait alors de la
manière dé. Topelius, mais rares sont les morceaux (comme par exemple «La mer Morte») auxquels il
ait su donner une valeûr poétique réelle. Aurait-il jamais atteint à un plus haut degré de perfection
dans l’un ou l ’a u t r e genre? on ne saurait le dire, car il est mort dans toute la force de l’âge.
Parmi les jeunes écrivains qui se firent remarquer dans les albums et les journaux entre ' 1840 et
1850, E m il v o n Q v a n t e n (né en 1827) mérite une mention par son talent souple et purement lyrique.
Autant l’art de Leistenius était grossier et joyeux, autant la poésie de Qvanten est délicate, élégante et
mélancolique. Elle est presque plus musicale et sensitive que celle de Topelius dans les «Fleurs de
bruyère», mais elle ne laisse après elle qu’une, impression fugitive. Il cherche à traduire en paroles les
harmonies de la nature, sürtout telles qu’on les entend la nuit, dans la solitude, ou qu’elles se répercutent
dans le coeur des jeunes filles. Rarement il entonne un chant joyeux comme son «Chant de printemps
». Sa muse est infiniment timide et tendre et a un penchant marqué pour les humbles du peuple
finnois. Pourtant son poème le plus étendu, «La nuit de la mi-été», rêverie lyrico-dramatique. a un sens
plus profond et rappelle Atterbom, surtout dans les chants et les danses des esprits de la nature. Il
réunit en un volume de «Poésies», publié en 1851, ces prémices de sa muse, qui avaient paru en 1845
et en 1849 dans le «Necken» et dans son album à lui, «Lârkan» (l’Alouette). Il entreprit bientôt après,
pour cause de santé, un voyage dans les mers du Sud. A son retour, il s’arrêta à Stockholm et n’est
plus revenu dans sa patrie; mais il lui a laissé ce beau chant de «Suomis sâng» (Le chant de Suomi)
qui, mis en musique par Pacius, résonne si souvent sur les lèvres de la jeunesse et réveille dans les
coeurs l'amour de la patrie et de la nature finlandaise. Dans le nouveau milieu où vit Qvanten, sa poésie
a pris plus de corps, son style a mûri et a acquis une grande clarté et une grande précision, mais il
à conservé son tempérament lyrique, sensible et sérieux.