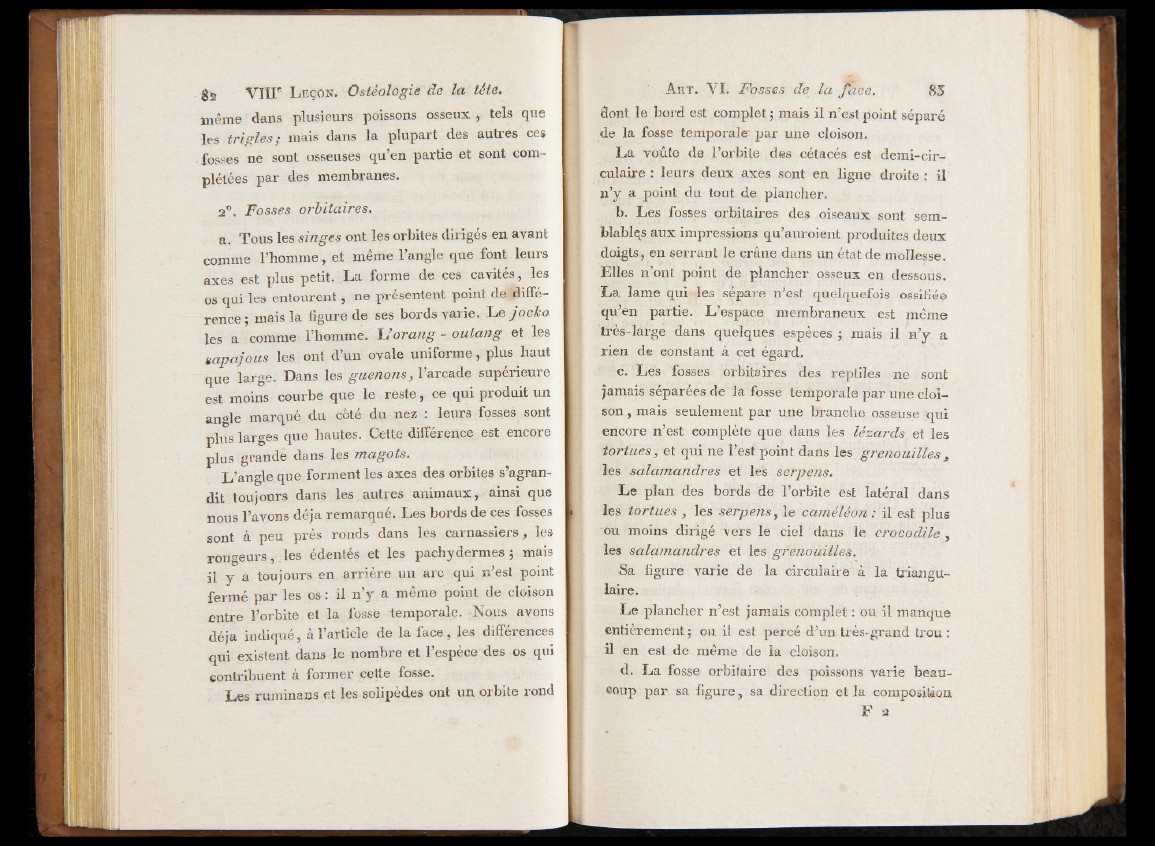
même dans plusieurs poissons osseux > tels que
les trigles ; mais dans la plupart des autres ces
fosses ne sont osseuses qu’en partie et sont complétées
par des membranes.
2°, Fosses orbitaires.
a. Tous les singes ont les orbites dirigés en avant
comme l’homme, et même l’angle que font leurs
axes est plus petit. L a forme de ces cavités, les
os qui les entourent, ne présentent point de différence
; mais la figure de ses bords varie. L e jo ch o
les a comme l ’homme. U o ran g - outang et les
sapajous les ont d’un ovale uniforme, plus haut
que large. Dans les guenons, l’arcade supérieure
est moins courbe que le reste, ce qui produit un
angle marqué du cote du nez : leurs fosses sont
plus larges que hautes. Cette différence est encore
plus grande dans les magots.
L ’angle que forment les axes des orbites s’agrandit
toujours dans les autres animaux, ainsi que
nous l’avons déjà remarqué. Les bords de ces fosses
sont à peu près ronds dans les carnassiers, les
rongeurs, les édentés et les pachydermes ; mais
il y a toujours en arrière un arc qui n’est point
fermé par les os : il n’y a même point de cloison
entre l’orbite et la fosse temporale. Nous avons
déjà indiqué, à l ’article de la face, les différences
qui existent dans le nombre et l’espèce des os qui
contribuent à former cette fosse.
Les ruminans et les solipedes ont un orbite rond
dont le bord est complet ; mais il n’est point séparé
de la fosse temporale- par une cloison.
L a voûte de l ’orbite des cétacés est demi-circulaire
: leurs deux axes sont en ligne droite : il
n’y a point du tout de plancher.
b. Les fosses orbitaires des oiseaux sont semblables
aux impressions qu’auroient produites deux
doigts, en serrant le crâne dans un état de mollesse.
Elles n’ont point de plancher osseux en dessous.
La, lame qui les sépare n’est quelquefois ossifiée
qu’en partie. L ’espace membraneux est même
très-large dans quelques espèces ; mais il n’y a
rien de constant à cet égard.
c. Les fosses orbitaires des reptiles ne sont
jamais séparées de la fosse teriiporale par une cloison
, mais seulement par une branche osseuse qui
encore n’est complète que dans les lézards et les
tortues, et qui ne l’est point dans les grenouilles ,
les salamandres et les serpens.
L e p lan des bords de l ’orbite est la té ra l dan s
le s tortues , le s serpens, le caméléon : i l est p lu s
Ou moins d ir ig é Vers le ciel dans le crocodile ,
les salamandres et les grenouilles.
Sa figure varie de la circulaire à la triangulaire.
Le plancher n’est jamais complet : ou il manque
entièrement; ou il est percé d’un très-grand trou :
il en est de même de la cloison.
d. L a fosse orbitaire des poissons varie beau-
coup par sa figure, sa direction et la composition
F a