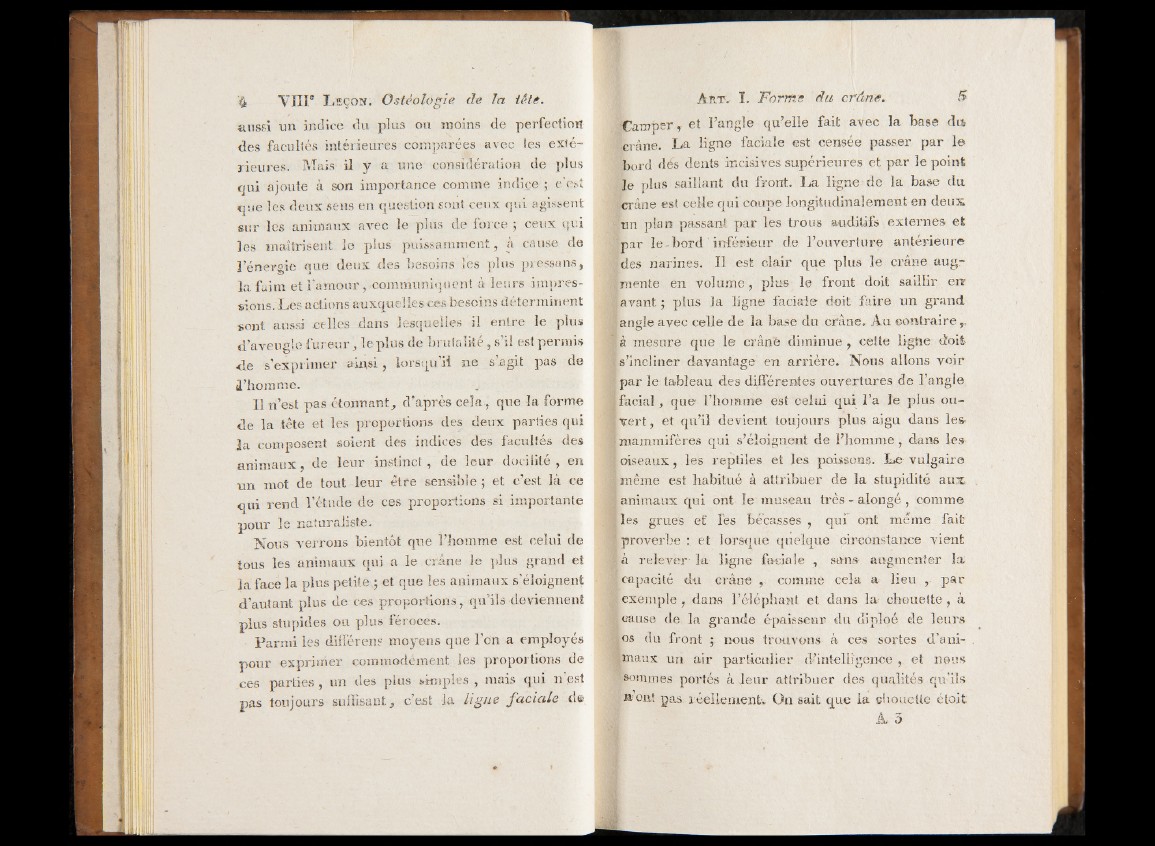
4 V IIIe L eçon. Ostêologie de In tête.
aussi un indice du plus ou moins de perfection
des facultés intérieures comparées avec les exté-
Heures. Mais il y a une considération de plus
qui ajoute à son importance comme indice ; e'est
que les deux sens en question sont ceux qui agissent
sur les animaux avec le plus de force 5 ceux qui
les maîtrisent le plus puissamment, à cause de
l ’énergie que deux des besoins' Tes plus pressa ns,
la faim et l’amour, »fâommuniqlient à leurs impressions.'
Les acLions auxquelles ces besoins déterminent
sont aussi celles dans lesquelles il entre le plus
d’aveugle fureur, le plus de brutalité., s’il est permis
de s’exprimer ainsi, lorsqu’il ne s’agit pas de
l ’homme. j
Il n’est pas étonnant, d’après cela, que la forme
de la tête et les proportions des deux parties qui
la composent soient des indices des facultés des
animaux, de leur instinct, de leur docilité, en
un mot de tout leur être sensible ; et c’est là ce
qui rend l ’étude de ces proportions si importante
pour le naturaliste.
Nous verrons bientôt que l’homme est celui de
tous les animaux qui a le crâne le plus grand et
la face la plus petite 5 et que les animaux s’éloignent
d’autant plus de ces proportions, qu’ils deviennent
plus stupides ou plus féroces.
Parmi les différens moyens que l ’on a employés
pour exprimer commodément les proportions de
ces parties , un des plus simples , mais qui n est
pas toujours suffisant, c’est la ligue jcicictle de
Camper, et l’angle qu’elle fait avec la base du
crâne. L a ligne faciale est censée passer par le
bord des dents incisives supérieures et par le point
le plus saillant du front. L a ligne de la base du
crâne est celle qui coupe longitudinalement en deux
un plan passant par les trous auditifs externes et
Ipar le bord inférieur de l’ouverture antérieure
des narines. Il est clair que plus le crâne augr
mente en volume, plus le front doit saillir en
avant 5 plus la ligne faciale doit faire un grand
angle avec celle de la base du crâne. Au contraire,,
à mesure que le crâné diminue , cette ligne doit
s’incliner davantage en arrière. Nous allons voir
par le tableau des différentes ouvertures de l ’angle
facial, que l ’homme est celui qui l ’a le plus ouvert
, et qu’il devient toujours plus aigu dans les-
mammifères qui s’éloignent de l’homme, dam iea
oiseaux, les reptiles et les poissons. Le vulgaire
même est habitué à attribuer de la stupidité aux
animaux qui ont le museau très - alongé , comme
les grues et Tes bécasses , qui ont même fait
proverbe : et lorsque quelque circonstance vient
à relever la ligne faciale , sans- augmenter la
I capacité du crâne comme cela a lieu , par
[ exemple , dam l ’éléphant et dans lar chouette , à
[cause de la grande épaisseur tin diploé de leurs
ios du front ; nous trouvons à ces sortes d'animaux
un air particulier & intelligence , et nous
'sommes portés à Jeur attribuer des qualités qu’ils
n/ont pas. réellement.. On sait que la chouette étoit
A, 5