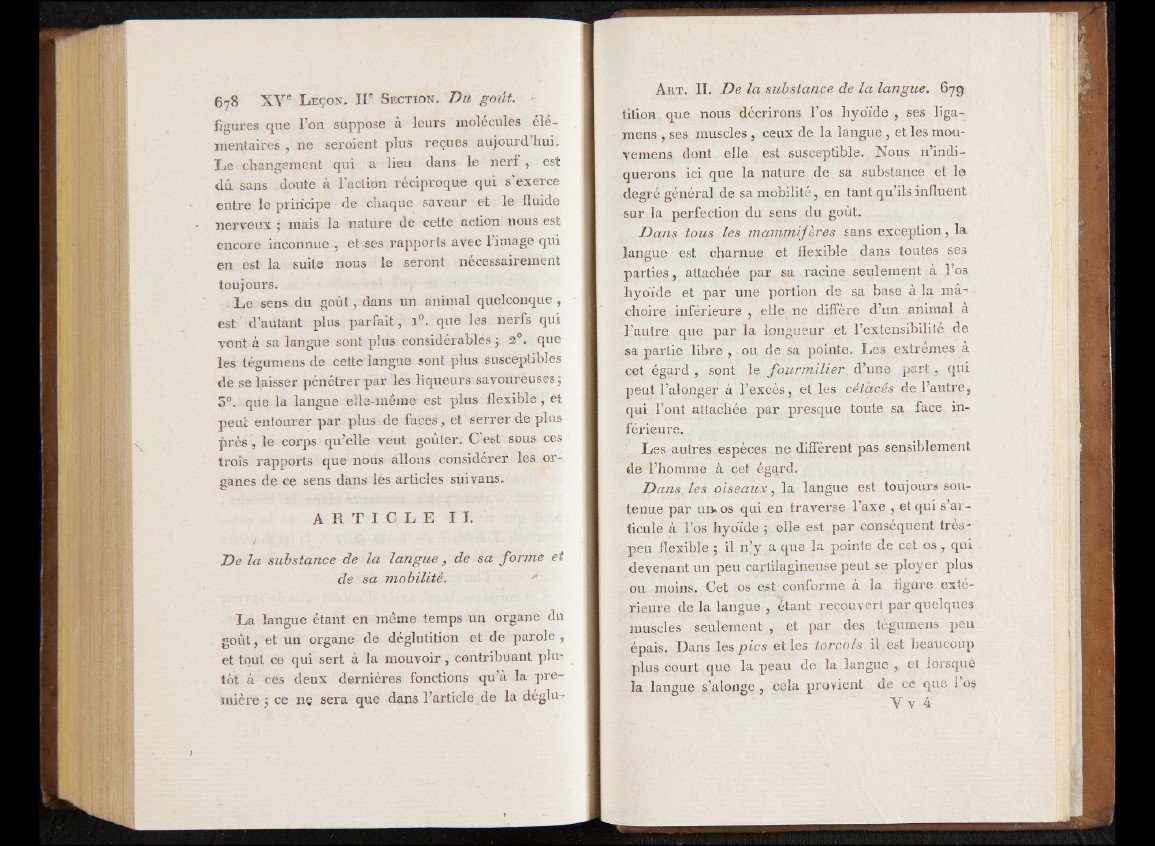
678 X V e L eçon. IIe Section. Du goût. >
figures que l ’on suppose à leurs molécules élémentaires
, ne seraient plus reçues aujourd’hui.
L e changement qui a lieu dans le nerf , est
dû sans doute à l ’action réciproque qui s’exerce
entre le principe de chaque saveur et le fluide
nerveux ; mais la nature de cette action nous est
encore inconnue , et ses rapports avec l’image qui
en est la suite nous le seront nécessairement
toujours.
L e sens du goût , dans un animal quelconque ,
est d’autant plus parfait, 1°. que les nerfs qui
vont à sa langue sont plus considérables ; 2°. que
les tégumens de cette langue sont plus susceptibles
de se laisser pénétrer par les liqueurs savoureuses;
5°. que la langue elle-même est plus flexible, et
peut entourer par plus de faces, et serrer de plus
près , le corps qu’elle veut goûter. C’est sous ces
trois rapports que nous allons considérer les organes
de ce sens dans les articles suivans.
A R T I C L E I I .
De la substance de la langue, de sa forme et
de sa mobilité.
L a langue étant en même temps un organe du
goût, et un organe de déglutition et de parole ,
et tout ce qui sert à la mouvoir, contribuant plutôt
à ces deux dernières fonctions qu’à la première
; ce ne sera que dans l’article de la déglutition
que nous décrirons l ’os hyoïde , ses liga-
mens , ses muscles , ceux de la langue , et les mou-
veinens dont elle est susceptible. Nous n’indiquerons
ici que la nature de sa substance et le
degré général de sa mobilité, en tant qu’ils influent
sur la perfection du sens du goût.
Dans tous les mammifères sans exception, la
langue est charnue et flexible dans toutes ses
parties, attachée par sa racine seulement à l ’os,
hyoïde et par une portion de sa base à la mâ- -
choire inférieure , elle ne diffère d’un animal à
l ’autre que par la longueur et l’extensibilité de
sa partie libre , ou de sa pointe. Les extrêmes à
cet égard , sont le fo u rm ilie r d’une part , qui
peut l ’alonger à l’excès, et les cétacés de l’autre,
qui l ’ont attachée par presque toute sa face inférieure.
Les autres espèces ne diffèrent pas sensiblement
de l ’homme à cet égard.
Dans les oiseaux, la langue est toujours soutenue
par un» os qui en traverse l ’axe , et qui s’articule
à l ’os hyoïde ; elle est par conséquent très-
peu flexible ; il n’y a que la pointe de cet os , qui
devenant un peu cartilagineuse peut se ployer plus
ou moins. Cet os est conforme a la figure extérieure
de la langue , étant recouvert par quelques
muscles seulement , et par des tégumens peu
épais. Dans les pics et les torcols il est beaucoup
plus court que la peau de la langue ,. et lorsquè
la langue s’alonge , cela provient de ce que 1 os
y v 4