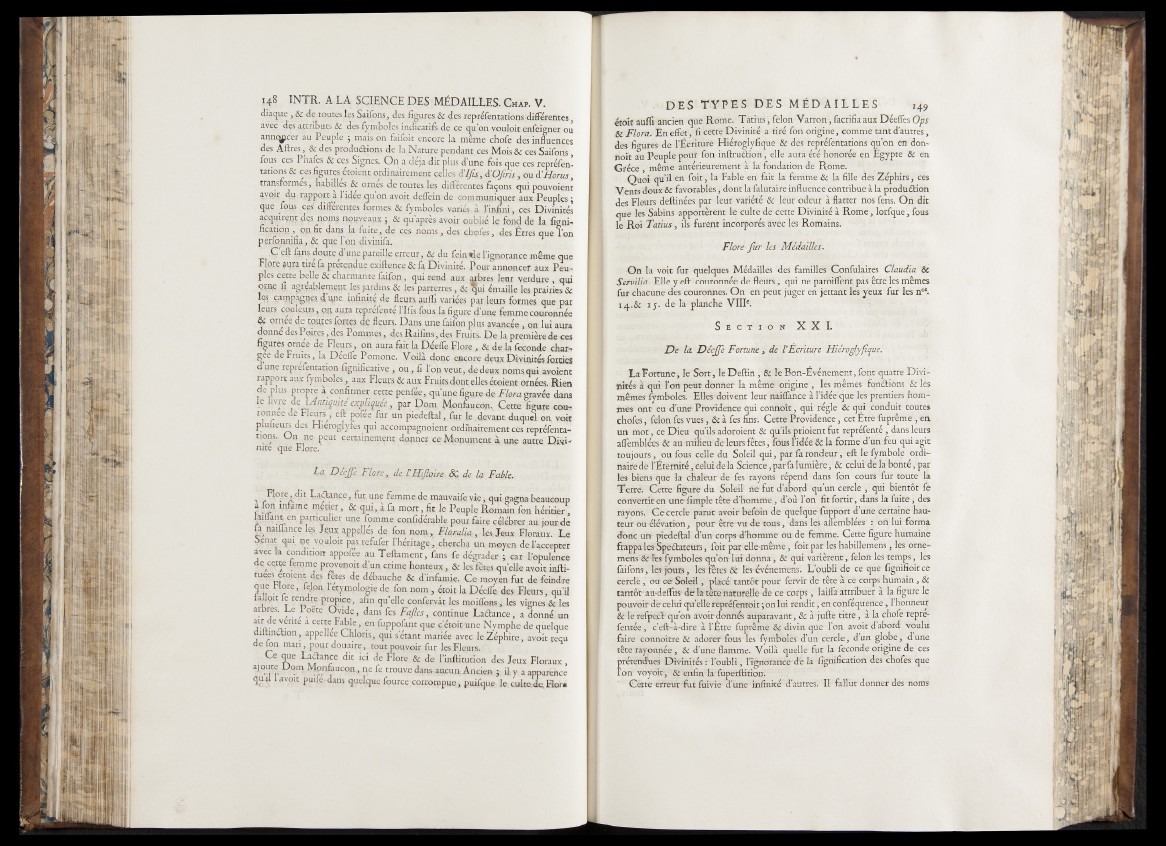
i48 IN T R . A L A S C IE N C E D E S M É D A IL L E S . C hap. V.
diaque , & de toutes.fes Saifons, des figures & des repréfentations différentes
avec des attributs & des fymboles indicatifs de ce qu on vouloit enfeigner ou
annqjjcer au Peuple ; mais.on faifoit encore la meme cbofe des influences
des Affres, & des productions de la Nature pendant ces Mois & ces Saifons ,
fous ces Phafes & ces Signes. O n a déjà dit plus d une fois que ces repréfentations
& ces figures, étoient ordinairement celles d'Ifîs, d'O fris, ou d’Horus,
transformes, babilles & ornés de toutes les différentes façons qui pouvoient
?vQÎ.t d~ rapport a J idée qu on avoit deffein de communiquer aux Peuples ;
que fous ces’ differentes formes & fymboles variés à l’infini, ces Divinités
acquirent des noms nouveaux ; & qu’après avoir oublié le fond de la figni-
fiçanon , on fit dans la fuite, de ces noms, des çhofes, des Êtres que l'on
perfonnjfi.a, & que l’on divinifa.
■ Ç? sft fen§ doute d une pareille etreur, & du fein (de l’ignorance même que
Elore jura tire fa prétendue exiffence & fa Divinité. Pour annoncer aux Peuples
cette belle & charmante faifon, qui rend aux mbres leur verdure , qui
Çtne fi agiçablement les jardins & les parterres, qui émaillé les prairies &
m d’une infinité, de fleurs aufli variées par leurs formes que par
leurs couleurs, qn. aji.ra reprefente 1 Ifis fous la figure d’une femme couronnée
& ornee de tontes fortes de fleurs. Dans une faifon plus avancée , on lui aura
donne des Poires, des Pommes, des Raifins, des Fruits. D e la première de ces
figures ornée de Fleurs, on aura fait la Déeffe Flore, & de la fécondé chargée
de Fruits, la Deeffe Pomone. Voilà donc encore deux Divinités forties
d’une repréfentation fignificative, o u , fi l’on veut, de deux noms qui avoient
rapport aux fymboles, aux Fleurs & aux Fruits dont elles étoient ornées. Rien
de plus propre a confirmer cette penfée, qu’une figure de Flora gravée dans
le livre de ^Antiquité explique., par Dom ftlonfaucon, Cette figure eau»
ronnee de rieurs^,- eft pofee fur un piedeftal, fur le devant duquel on. voit
plulxeurs des Hieroglyfes qui accompagnoient ordinairement ces repréfentations.
O n ne peut certainement donner ce Monument à une autre D iv inité
que Flore. '
La Déejfe Flore x de. [Hiftoire SC de la Fable..
, r^ 0r A dlt ■ La&mç.e, fut une femme de mauvaife v ie, qui gagna beaucoup
a fon infâme métier, fc qui, à fa mort, fit le Peuple Romain fon héritier,
fai fiant en particulier une fomme confidérable pour faire célébrer au jouxde
fa naiflanceles Jerux.appel]és de fon nom , F lomlia , les Jeux Floraux. Le
5ena£ qui nq vouloit pas.refufer l’héritage,, chercha un. moyen de l’accepter
avec k condition appofée au Teftament, fans fe dégrader ; car l ’opulence
de^cette femme provenoit d’un crime honteux, & les fêtes quelle avoit. infti-
tuees etoient des fetçs de débauché & d infamie. C e moyen fut de feindre
que More, leipn l’etymologie de fon nom, étoit la Déefle des Fleurs, qu’il
ialloit le rendre propico, afin quelle confervât les mpillbns, les vignes & les
arbres. L e Poete O v id e , dans fes Fafîes, continue Laftance, a donné un
- de: erlCe a cet':ie/Fable, en fuppofant que ç'étoitune Nymphe de quelque
diftmChon, appellee Chions, qui s’étant mariée avec le Zéphire, avoit reçu
de Ion mari, pour douaire, tout pouvoir fur les Fleurs.
■ C e LA ?anr e dk ici de Flore & de l’mftitution des Jeux Floraux
ajoute Dom Monfaucon, ne fe trouve dans aucun. Ancien ; fl, y a apparence
qufl lavoir puife dans quelque fource corrompue, pufiqup le culte.de.Flora
étoit aufli ancien que Rome. Tatius, félon Var ron, facrifia aux Déeffes Ops
& Flora. En effet fi cette Divinité a tiré fon origine, comme tant d’autres,
des figures de l’Écriture Hiéroglyfique & des repréfenrations qu’on en don-
noit au Peuple pour fon inftruétion, elle aura été honorée en Égypte & en
Grèce même antérieurement a la fondation de Rome.
Qu o i qu’il en fo it, la Fable en fait la femme &c la fille des Zéphirs, ces
Vents doux & favorables, dont la falutaire influence contribue à la production
des Fleurs deftinées par leur variété & leur odeur à flatter nos fens. O n dit
que les Sabins apportèrent le culte de cette Divinité à Rom e , lorfque, fous
le Ro i Tatius, ils furent incorporés avec les Romains.
Flore fu r les Médailles.
O n la voie fur quelques Médailles des familles Confulaires Claudia &
Servilia. Elle y eft couronnée de fleurs, qui ne paroiffent pas être les mêmes
fur chacune des couronnes. O n en peut juger en jettant les yeux fur les n°‘-
1 4 .& i j . de là planche V IIIe.
S e c t i o n X X I .
D e la Déejfe Fortune , de l ’Écriture Fliéroglyjîque.
L a Fortune, le Sort, le D e ffin , & le Bon-Événement, font quatre Div inités
a qui l’on peut donner la même origine , les mêmes fondrions & les
mêmes fymboles. Elles doivent leur naiffance à l’idée que les premiers hommes
ont eu d’une Providence qui connoît, qui régie & qui conduit toutes
chofes, félon fes vues, & à fes fins. Cette Providence, cet Être fuprême , en
un mot, ce Dieu qu’ils adoroient & qu’ils prioient fut repréfenté, dans leurs
affemblées & au milieu de leurs fêtes, fous l’idée & la forme d un feu qui agit
toujours, ou fous celle du Soleil qui, par fa rondeur, eft le fymbole ordi-
nairede l’Éternité, celui de la Science, par fa lumière, & celui de la bonté, par
les biens que la chaleur de fes rayons répend dans fon cours fur toute la
Terre. Cette figure du Soleil ne fut d’abord quun cercle , qui bientôt fe
convertit en une {impie tête d’homme., d’où l’on fit forcir, dans la fuite, des
rayons. C e cerclé parut avoir befoin de quelque {upport dune certaine hauteur
ou élévation, pour être vu de tous, dans les affemblées : on lui forma
donc un piedeftal d’un corps d’homme ou de femme. Cette figure humaine
frappa les Spectateurs, foit par elle-même, foit par les habillemens| les orne-
mens & fes fymboles qu’on lui donna, & qui varièrent, félon les temps, les
faifons, les jours, les fêtes & les événemens. L ’oubli de ce que fignifioitee
cerclé , ou ce S o leil, placé tantôt pour fervir de tête à ce corps humain , &
tantôt au-deflus de la tete naturelle de ce corps, laiffa-attribuer a la figure le
pouvoir de celui qu’elle repréfencoit ; on lui rendit, en confequence, 1 honneur
& le refpeét qu’on avoir donnés auparavant, & à jufte titre, à la chofe repre-
fentée, c’eft-à-dire à l'Être, fuprême & divin que l’on avoit d abord voulu
faire connoître & adorer fous les fymboles d’un cercle, d’un globe, dune
tête rayonnée, & d’une flamme. Voilà quelle fut la fécondé origine de ces
prétendues Divinités : l’oubli, l’ignotance dé la lignification des chofes que
ton' voyoir, & enfin la fuperftirion.
Cette erreur fut fuivie d’une infinité d’autres. Il fallut donner des noms