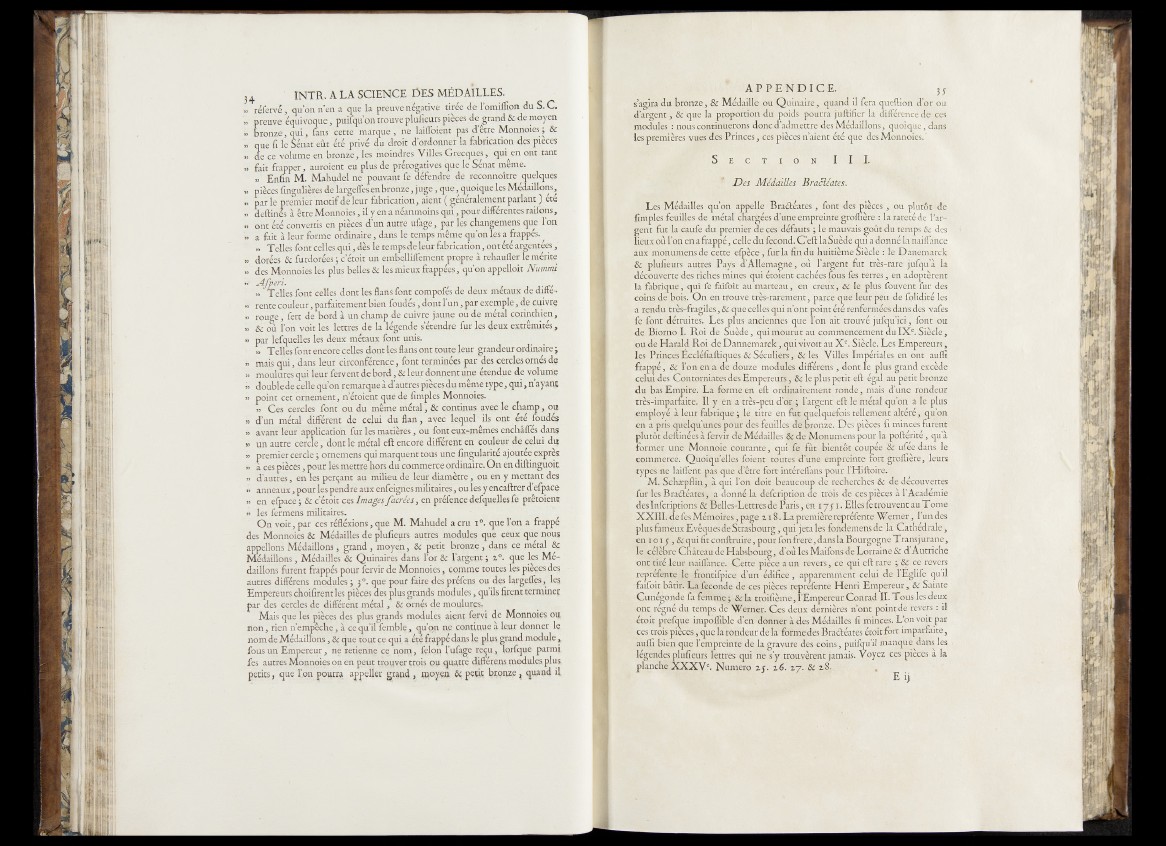
« réfervé, qu'on n’en a que la preuve négative tirée de l’omilTion du S .C .
„ preuve équivoque, puifqu on trouve plufieurs pièces deegrand 8c de moyen
„ bronze, qui, fans cette marque , ne laiffoient pas d etre Monnoies ; 8c
„ que fi le Sénat eût été privé du droit d'ordonner la fabrication des pièces
,, de ce volume en bronze, les moindres Villes Grecques, qui en ont tant
» fait frapper, auraient eu plus de prérogatives que le Sénat même.
.. Enfin M. Mahudel ne pouvant fe défendre de reconnoître quelques
» pièces fingulières de largeffesen bronze, juge, que, quoique les Médaillons,
» par le premier motif de leur fabrication, aient ( generalement parlant ) ete
» deftines à être Monnoies, il y en a néanmoins qui, pour différentes raifons ,
» ont été convertis en pièces d’un autre ufage, par les changemens que l’on
». a fait à leur forme ordinaire, dans le temps même qu’on les a frappés.
Telles font celles qui, dès le temps de leur fabrication, ont été argentées,
». dorées & furdorées ; c’éroit un embelliflèment propre à rehaufler le mérite
». des Monnoies les plus belles 8c les mieux frappées, qu’on appelloit Nummi
». Afperi.
». Telles font celles dont les flans font compofés de deux métaux de diffe-
.. rente couleur, parfaitement bien foudés, dont l’u n, par exemple, de cuivre
.. rouge, fert de bord à un champ de cuivre jaune ou de métal corinthien,
„ sc mi l’on voit les lettres de la légende s’étendre fur les deux extrémités,
». par lefquelles les deux métaux font unis.
». Telles font encore celles dont les flans ont toute leur grandeur ordinaire 3
». mais qui, dans leur circonférence, font terminées par des cercles ornés de
=> moulures qui leur fervent de bord, & leur donnent une étendue de volume
»» doublede celle qu’on remarque à d’autres pièces du même type, qui , n’ayant
»> point cet ornement, n’étoient que de {impies Monnoies.
.» Ces cercles font ou du même métal, & continus avec le champ, oit
»» d’un métal différent de celui du flan, avec lequel ils ont ete foudes
»> avant leur application fur les matières , ou font eux-mêmes enchaffes dan?
>» un autre cercle, dont le métal efl encore différent en couleur de celui dit
»» premier cercle 3 ornemens qui marquent tous une fingulatite ajoutée expres
». a ces pièces, pour les mettre hors du commerce ordinaire. O n en diftinguoit
.» d’autres, en les perçant au milieu de leur diamètre, ou en y mettant des
.» anneaux, pour les pendre aux enfeignes militaires, ou les y encaftrer d efpace
»» en efpace 3 & c’étoit ces Images focrées, en préfence defquelles fe prêtoienc
» les fermens militaires.
O n voit, par ces réfléxions, que M. Mahudel a cru x °. que 1 on a frappé
des Monnoies 8c Médailles de plufieurs autres modules que ceux que nous
appelions Médaillons , grand, moyen, & petit bronze , dans ce métal 8c
Médaillons , Médailles 8c Quinaires dans l’or 8c l’argent 5 z°. que les Médaillons
furent frappés pour fervir de Monnoies, comme toutes les pièces des
autres différens modules 3 J0- que pour faire des préfens ou des largeffes, les
Empereurs choifirentles pièces des plus grands modules, qu ils firent terminer
par des cercles de différent métal, 8c ornés de moulures-
Mais que les pièces des plus grands modules, aient fervi de Monnoies, ou
non, rien n’empêche, à ce qu’il femble, qu’on ne continue a leur donner le
nom de Médaillons, & que tout ce qui a été frappé dans le plus grand module,
fous un Empereur, ne retienne ce nom, félon l’ufage reçu, lorfque parmi
fes autres Monnoies on en peut trouver trois ou quatre différens modules plus
petits, que l’on pourra appeller grand, moyen 6c petit bronze, quand il
s’agira du bronze, & Médaille ou Quinaire, quand il fera queftion d’or ou
d’argent, 8c que la proportion du poids pourra juftifier la différence de ces
modules : nous continuerons donc d’admettre des Médaillons, quoique, dans
les premières vues des Princes, ces pièces n’aient été que des Monnoies. '
S e c t i o n I I I .
' Des Médailles Bracléates.
L e s M éd a ille s q u ’o n ap p elle Brad téates , fo n t des pièces , o u p lu tô t d e
{impies .feuilles d e m é ta l chargé es d ’un e em p re in te g roffière : la rareté d e l ’arg
e n t fu t la cau fe d u p rem ie r d e ces d éfau ts 3 le mau va is g o û t d u temps 8c des
lie u x o ù l’o n en a fr a p p é , c e lle d u fé co n d . C ’e ft la S u èd e q u i a d o n n é la n aiffance
a u x m on um en s d e c e t te e fp è c e , fu r la fin d u h u itièm e S iè c le : le D a n em a r c k
& p lu fieurs autres P a y s d ’A l l em a g n e , où l ’a rg en t fu t très-rare- ju fq u a la
d é co u v e r te des riches mines q u i é to ien t cachées fou s fes te r re s , en ad op tè ren t
la fa b r iq u e , q u i fe fa ifo it au m a r te a u , en c r e u x , 8c le plus fo u v en t fu r des
co in s de b ois. O n en t ro u v e trè s -rarem en t, parce q u e le u r p eu d e fo lid ité les
a ren d u t rè s - fra g ile s , 6c q u e celles q u i n ’o n t p o in t é té ren fermées dans d es vafes
fe fo n t détruites . L e s plus an c ien n es q u e l ’o n a it t ro u v é ju fq u ’i c i , fo n t o u
d e B îo r n o I. R o i d e S u è d e , q u i m o u ru t au c om m en c em en t d u IX e. S iè c le ,
o u de H a r a ld R o i d e D a n n em a r c k , q u i v iv o it a u X e. S iè c le . L e s Em p e reu r s ,
le s Pr in c e s É c c lé fia ft iq u e s 8c S é c u lie r s , 8c les V i lle s Impériales en o n t au ffi
f r a p p é , 6c l’o n en a d e d o u z e m od u le s d ifférens , d o n t le plus g ran d e x cèd e
c e lu i des C o n to rn ia te s des E m p e r e u r s , & le p lus p e t it eft égal, au p e t it b ro n z e
d u bas Em p ire . L a fo rm e en e ft o rd in a irem en t r o n d e , mais d ’un e ro n d eu r
trè s -im p a r fa ite . I l y en a très-peu d ’o r 3 l ’arg en t e ft le m é ta l q u ’o n a le plu s
em p lo y é à le u r fa b r iq u e 3 le titre en fu t q u e lq u e fo is te llem en t a lt é r é , q u ’o n
e n a pris q u e lq u ’unes p o u r des feuille s d e Bronze. D e s pièces f i minces fu r en t
p lu tô t deftinées à fe rv ir d e M éd a ille s 6c d e M o n um e n s p o u r la p o f té r ite , q u ’a
fo rm e r un e M o n n o ie c o u r a n te , q u i fe fû t b ien tô t cou pé e 8c u feê dans le
c om m e r c é . Q u o iq u ’elles fo ien t toutes d ’u n e emp re in te fo r t g ro ffie re , leurs
typ es ne la iffent pas q u e d ’être fo r t intéreffans p ou r l’H if to ire .
M. Schæpflin, à qui l’on doit beaucoup de recherches 8z de découvertes
fur les Braétéates, a donné la defcription de trois de ces pièces à l’Académie
deslnfcriptions 8c Belles-Lettres de Paris, en 1 y y 1. Elles fe trouven t au T orne
X X II I . de fes Mémoires, page z 18. L a première repréfente Wcrner, l ’un des
plus fameux Evêques de Strasbourg, qui jeta les fondemensde là Cathédrale,
en 1 o 1 y , 8c qui fit conftruire, pour fon frere, dans la Bourgogne Transj urane ,
le célèbre Château de Habsbourg, d’où les Maifons de Lorraine 8c d Autriche
ont tiré leur naiffance. Cette pièce a un revers, ce qui eft rare 3 8c ce revers
repréfente le frontifpice d’un édifice, apparemment celui de l’Eglife qu il
faifoit bâtir. La fecon.de de ces pièces repréfente Henri Empereur, 8c Sainte
Cunégonde fa femme 3 6c la troifième, l’Empereur Conrad II. Tous les deux
ont régné du temps de Werner. Ces deux dernières n’ont point de revers : il
étoit prefque impoffible d’en donner à des Médailles fi minces. L ’on voit par
ces trois pièces, que la rondeur de la forme des Braétéates étoit fort imparfaite,
auffi bien que l’empreinte de la gravure des coins, puifqu’il manque dans les
légendes plufieurs lettres qui ne s’y trouvèrent jamais. Voyez ces pièces a la
planche X X X V e. Numéro zy . z 6. z 7. 6c z8.