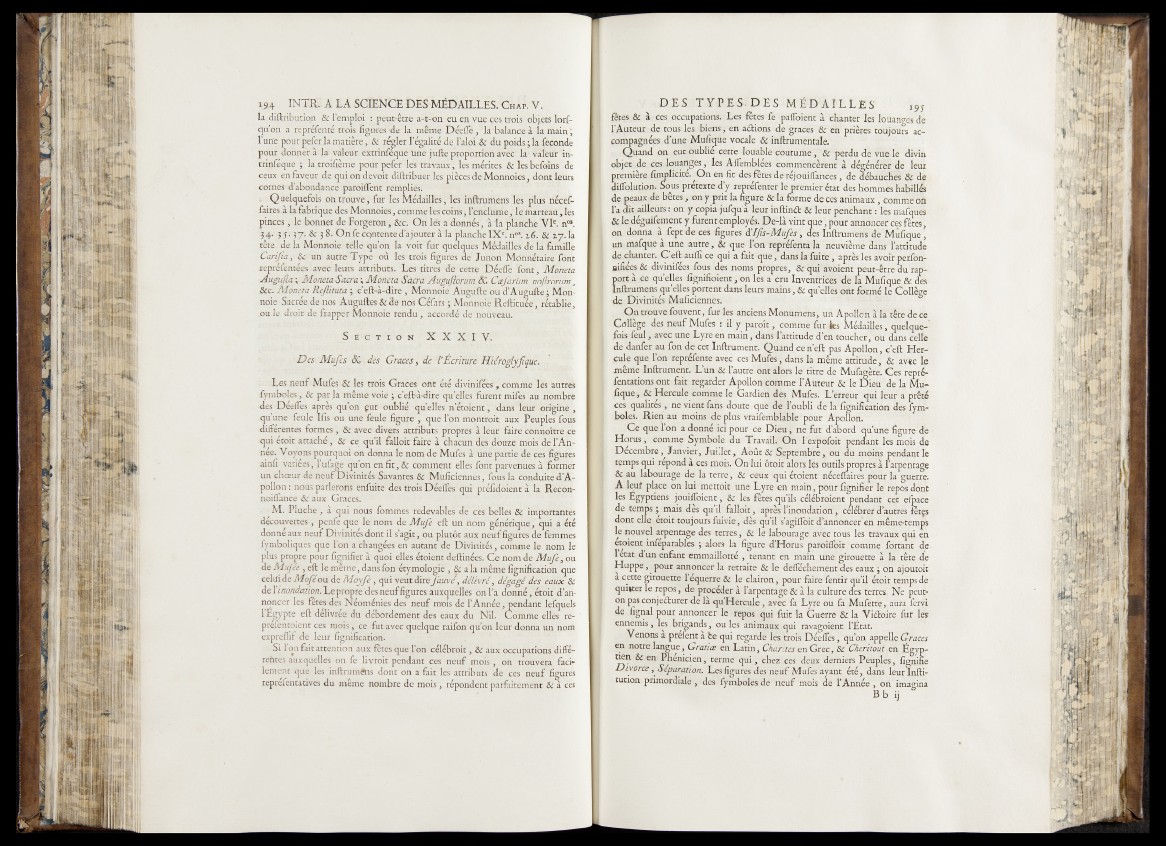
la diftnbution & l’emploi : peut-être a-t-on eu en vue ces trois objets lorf-
qu’on a repréfenté trois figu-res de la même Déefle, la balance à la main ;
l’un'e pour pefer la matière , & régler l ’égalité de l’aloi & du poids ; la fécondé
pour donner à la valeur extrinfeque Une jufte proportion avec la valeur in-
trinféque ; la troifième pour pefer les travaux, les mérites 6c lesbefoins de
ceux en faveur de quiondevoit diftribuer les pièces de Monnoies, dont leurs
cornes d’abondance paroifTent remplies.
Quelquefois on trouve, fur les Médailles, les inftrumens les plus nécef-
faires a la fabrique des Monnoies, comme les coins, l’enclume, le marteau, les
pinces , le bonnet de Forgeron, &c. O n les a donnés, a la planche VI*. n°*.
34. 3 ƒ. 37. & 3 8. O n fe cqntente d’ajouter à la planche IX e. nos. z6. & 17 . la
tête de la Monnoie telle qu’on la voit fur quelques Médailles de la famille
Cari fia > & un autre Type où les trois figures de Junon Monnétaire font
repréfentées avec leurs attributs. Les titres de cette Déelfe font, Moneta
Augufia ; Moneta Sacra 3 Moneta Sacra Augufiorum SC Coefarùm nojlrorum,
& c . Moneta Refiituta ; c’eft-à-dire , Monnoie Augufte ou d’A ugufte; Monnoie
Sacrée de nos Auguftes & de nos Céfars 3 Monnoie Reftituée, rétablie,
ou le droit de frapper Monnoie rendu , accordé de nouveau.
S e c t i o n X X X I V .
D es Mufes ëC des Grâces, de l’Écriture Hiéroglyfique.
Les neuf Mufes 6c les trois Grâces ont été divinifées , comme les autres
fymboles, & par la même voie 3 c’eft-à-dire quelles furent mifes au nombre
des Déeffes après qu’on çut oublié qu’elles n’étoient, dans leur origine ,
qu une feule Ifis ou une feule figure ,■ que l’on montroit aux Peuples fous
differentes formes , 6c avec divers attributs propres à leur faire connoître ce
qui etoic attaché, 6c ce qu’il falloit faire à chacun des douze mois de l’A n née.
Voyons pourquoi on donna le nom de Mufes à une partie de ces figures
ainfi variées, 1 ufage qii on en fit, & comment elles font parvenues à former
un choeur de neuf Divinités Savantes & Muficiennes, fous la conduite d’A pollon
: nous parlerons enfuite des trois Déelfes qui préfidoient à la Recon-
noiflance 6c aux Grâces.
M. Pluche, a qui nous fommes redevables de ces belles 6c importantes
decouvertes , penfe que le nom de Muje eft un nom générique, qui a été
donne aux neuf Divinités dont il s agit, ou plutôt aux neuf figures de femmes
fymboliques que l ’on a changées en autant de Divinités, comme le nom le
plus propre pour lignifier à quoi elles étoient deftinées. C e nom de Mufe, ou
de MuJée , eft le même, dans fon étymologie , & a la même lignification que
celui de Moje ou de Moyfe , qui veut dire fauve, délivré, dégagé des eaux 6c
de X inondation. Le propre des neuf figures auxquelles on l’a donné, étoit d’annoncer
les fêtes des Néoménies des neuf mois de l’Année, pendant lefquels
I Egypte eft délivrée du débordement des eaux du Nil. Comme elles re-
prefentoient ces mois, ce fut avec quelque raifon qu’on leur donna un nom
expreflïf de leur lignification.
Si 1 on fait attention aux fêtes que 1 on célébroit, & aux occupations diffé-
rehtes auxquelles on fe livrait pendant ces neuf mois , on trouvera facilement
que les inftruméns dont on a fait les attributs de ces neuf figures
reprefentatives du même nombre de mois , répondent parfaitement 6c a ces
fêtes & à ces occupations. Les fêtes fe pafloient à chanter les louantes de
l’Auteur de tous les biens, en a étions de grâces & en prières toujours accompagnées
d’une Mulîque vocale & inftrumentale.
Quand on eut oublié cette louable coutume, & perdu de vue le divin
objet de ces louanges, les Aflemblées commencèrent à dégénérer de leur
première lîmplicité. O n en fit des fêtes de réjouiflances, de débauches & de
diflolution. Sous prétexte d’y repréfenter le premier état des hommes habillés
de peaux de bêtes , on y prit la figure 6c la forme de ces animaux , comme oû
l’a dit ailleurs : on y copia jufqu'à leur inftinéb 6c leur penchant : les mafques
6c le déguifement y furent employés. De-là vint que, pour annoncer ces fêtes,
on donna à fept de ces figures d'Ifis-Mufes, des Inftrumens de Mufique ’
un mafque à une autre, & que l’on repréfenta la neuvième dans l’atritude
de chanter. C eft aufli ce qui a fait que, dans la fuite, après les avoir perfon-
nifiées & divinifées fous des noms propres, & qui avoient peut-être du rapport
a ce qu elles fignifioient, on les a cru Inventrices de la Mufique 6c des
Inftrumens quelles portent dans leurs mains, & quelles ont formé le Collège
de Divinités Muficiennes.
, O n trouve fouvent, fur les anciens Monumens, un Apollcn à la tête de ce
College des neuf Mufes : il y parait, comme fur èes Médailles, quelquefois
feul, avec une Lyre en main, dans 1 attitude d en toucher, ou dans celle
de danfer au fon de cet Inftrument. Quand cen’eft pas Apollon, c’eft Hercule
que l’on repréfente avec ces Mufes, dans la même attitude, & avec le
même Inftrument. L ’un 6c l’autre ont alors le titre de Mufagète. Ces repré-
fentations ont fait regarder Apollon comme l’Auteur & le Dieu de la Mufique
, 6c Hercule comme le Gardien des Mufes. L ’erreur qui leur a prêté
ces qualités , ne vient fans doute que de 1 oubli de la lignification des fymboles.
Rien au moins de plus vraifemblable pour Apollon.
C e que 1 on a donne ici pour ce D ieu , ne fut d’abord qu’une figure de
Horus, comme Symbole du Travail. O n 1 expofoit pendant les mois de
Décembre, Janvier, JuLlet, Août & Septembre, ou du moins pendant le
temps qui répond a ces mois. On lui ôtoit alors les outils propres à l’arpentage
& au labourage de la terre, & ceux qui étoient néceflaires pour la guerre.
A leuf place on lui mettoit une Lyre en main, pour lignifier le repos dont
les Égyptiens jouifloient, & les fêtes qu’ils célébraient pendant cet eipace
de temps ; mais des qu il falloit, après 1 inondation , célébrer d’autres fêtes
dont elle etoit toujours fuivie, dès qu’il s’agiflbit d’annoncer en même-temps
le nouvel arpentage des terres, & le labourage avec tous les travaux qui en
étoient infeparables 3 alors la figure d’Horus paroifloit comme fortant de
1 état d un enfant emmaillotté , tenant en main une girouette à la tête de
Huppe, pour annoncer la retraite 6c le defléchement des eaux 3 on ajoutoit
a cette girouette 1 équerre & le clairon, pour faire fentir qu’il étoit temps de
quitter le repos, de procéder à l’arpentage & à la culture des terres. Ne peut-
on pas conjecturer de la qu Hercule, avec fa Lyre ou fa Mufette, aura fervi
de lignai pour annoncer le repos qui fuit la Guerre 6c la Viétoire fur les
ennemis, les brigands, ou les animaux qui ravagoient l’État.
Venons a préfent a te qui regarde les trais Déefles , qu’on appelle Grâces
en notre langue, Gratta en Latin, Charités en Grec, & Cheritout en Égyp-
tien 6c en Phénicien, terme q u i, chez ces deux derniers Peuples, lignifie
Divorce, Séparation. Les figures des neuf Mufes ayant été, dans leurlnfti-
tution primordiale, des fymboles de neuf mois de l’Année , on imagina
B b ij