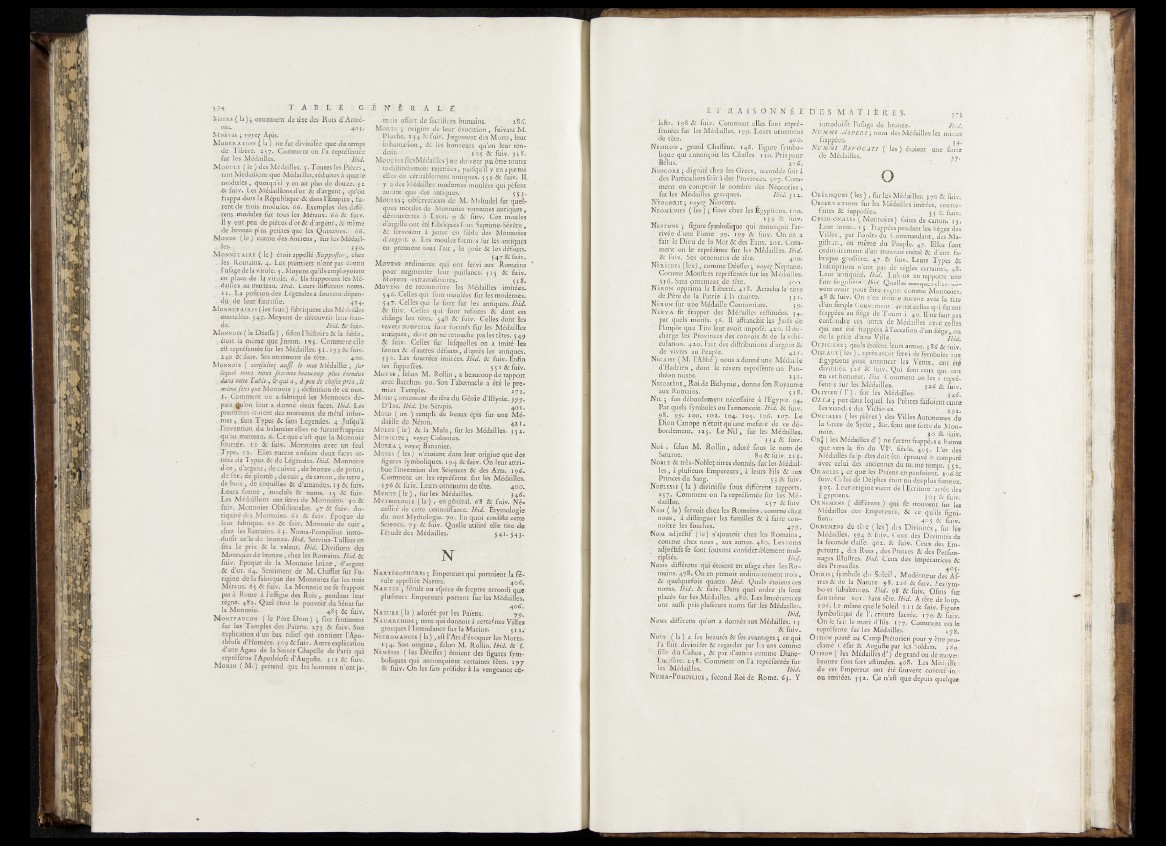
574 T A B L E . : G à N Ê R A L E
Mitrjî{ la).; ornement de tête des Rois d’Arménie.
4o3.
M ne v is j Apis.
M odération ( la ) ne fut divinifée que du temps
de Tibère. 257. Comment on l’a repréfentee
fur les Médailles. Ibid.
M odule .( le ) des Médailles. 5, Toutes les Pièces,
ïant Médaillons que Médailles, réduites à quatre
modules , quoiqu’il y en ait plus de douze. 3 2
& fuiv. Les Médaillons dor & d’argent, qu’on
frappa dans la République 3c dans l’Empire, furent
de trois modules. 6 6 . Exemples des différons
modules fur tous les Métaux. 6 6 8c fuiv.
Il y eut peu de pièces d’or& d’argent, 3c même
de bronze plus petites que les Quinaires. ' 6 6 .
M onde ( Je ) connu des Anciens , fur les Médaill
e s . , . , . ,330.
M onnétairf. ( le) étoitappellé S u p p o j ïo r , chez
_ les Romains. 4. Les premiers, n’ont pas connu
: l’ufage de la virole. 5. Moyens qu’ils employoient
. en place, de la virole. 6 , Ils frappoient les Mé-
- dailles au marteau. Ib id . Leurs différens noms,
i l., La pofition des Légendes a fouvent dépendu
| de leur- fantaifie. 414.
M o n n é ta ir e s (les faux) fabriquent des Médailles
martelées. 54p. Moyens de découvrir leur fraude.
. . . 1 I b id . 3c fuiv.
M onnoie ( la Déefle ) , félon l’hiftoire 3c la fable,
. étoir la même que Junon. 193. Comment elle
eft repréfentée fur les Médailles. 31.193 & fuiv.
Z40 & fuiv. Ses ornemens de tête. 400.
M onnoie ( confuite.1 a u jji le m ot Médaille , fur
leq u e l n o u s n o u s fornm es beaucoup p lu s éten d u s
da n s cette T a b le , 6* qu i a , à p eu d e chofes p r è s , le
même f e n s que Monnoie ) ; définition de ce mot.
J. Comment on ^fabriqué les Monnaies de-
puis _g.u’on leur a donné deux faces. Ib id . Lés
premières étoient.des morceaux de métal informes
fans Types & fans Légendes. 4 Jufqua
l’invention .du balancier elles ne furent frappées
qu’au marteau. 6 . Ce que c eft que la Monnoie
fourrée. 11 & fuiv. Monnoies avec un feul
Type. 12. Elles eurenc enfuite deux faces ornées
de Types, & de Légendes. Ib id . Monnoies
d or, d argent, de' cuivre , de bronze , de potin,
de fer, de plomb, de cuir , de carton 4 de terre,
de -bois , de coquilles & d’amandes. 13 & fuiv.
Leurs forme , module & noms. 15 & fuiv.
Les Médaillons ont fervi de Monnoies. 30 &
fuiv. Monnoies Qbûdionaies. 47 & fuiv. Antiquité
dés Monnoies. 6 1 & fuiv. Époque de
leur fabrique. 6 1 & fuiv. Monnoie de cuir ,
chez les Romains. 63. Numa-Pompilius introduit
«: celle de bronze. Ib id . Servius-Tullius en
fixa le prix 8c la valeur. Ib id . Divi fions des
Monnoies de bronze, chez les Romains. Ib id . 3c
fuiv. Époque de la Monnoie latine, d’argent
& d’or. 64. Sentiment de M. Chifflet fur l’origine
de la fabrique des Monnoies fur les trois
Métaux. 6$ &c fuiv. La Monnoie ne fe frappoit
pas a Rome à l’effigie des Rois , pendant leur
régné. 482. Quel étoit le pouvoir du Sénat fur
la Monnoie. 485 & fuiv.
M ontfaucon ( le Père Dom) ; fon fendment
fur les Temples des Païens. 2.75 3c fuiv. Son
explication d’un bas relief qui confient l’Apo-
theofe d’Homère. 309 & fuiv. Autre explication
d’une Agate de la Sainte Chapelle de Paris qui
repréfente l’Apothéofe d’Augufte. 3 12 & fuiv.
M o r in ( M.) prétend que les hommes n’ontjamais
offert de facrificés humains. 28 6.
M orts ■ origine de leur évocation, fuivantM.
Pluche. 154 & fuiv. Jugement des Morts, leur
inhumation a & les honneurs qu’on leur renvoie.
V , 205 & fuiv. 318.
M oulées (lesMédailles1) ne doivent pas être toutes
indiftinctemenc rejettées, puifqu’il y en a parmi
elles.de véritablement antiques. 552 & fuiv. Il
y a des Médailles modernes moulées qui pèfenc
autant que des antiques. 553*
M o u l es ; obfervatiorts de M. Mahudel fur quelques
moules de Monnoies romaines antiques,
découvértes à Lyon.' 9 & fuiv; Ces moules
d’argille ont été fabriqués fous Septime-Sévère „
& lervoient à jetter en fable des Monnoies
d’argent. 9. Les moules formés fur les antiques
en prennent tout-l’air le goût & les défauts.
• • ' 547 & fuiv.
M oyens ordinaires qui ont fervi aux Romains *
pour augmenter leur puillance. 515 3c fuiv.
Moyens extraordinaires. 5 18.
M oyens de reconnoître les Médailles imitées.
546. Celles qui font moulées fur les modernes.
547. Celles qui le font fur les antiques. I b id .
3c fuiv. Celles qui font refaites 3c dont on
change les têtes. 548 & fuiv. Celles dont les
revers nouveaux font formés fur les Médailles
antiques, dont on ne retouche pas les têtes. 549
&c fuiv. Celles fur lefquelles on a imité les
fentes 3c d’autres défauts, d’après les antiques.
550. Les fourrées imitées. Ib id . 3c fuiv. Enfin
les fuppofées. 551 & fuiv.
M oyse , félon M . Rollin, a beaucoup de rapport
avec Bacchus. 90. Son Tabernacle a été le pre-
. mier Temple. 272.
M uid ; ornement de tête du Génie d’Illyrie. 399.
D’Ilis. Ib id . De Sérapis. 401.
M uid ( un ) rempli de beaux épis fur une Médaille
de Néron. 421«
M ulet (le) 3c la Mule, fur les Médailles. 352.
Mu ni c i pe ; voyer Co lo nie s.
Musé a ; voye^ Bananier.
M uses ( les) n’étoient dans leur origine que des
figures fymboliques. 194. &fuiv. On leur attribue
l’invention des Sciences 8c des Arts. 196.
Gomment on les repréfente fur le's Médailles.
19 6 3c fuiv. Leurs ornemens de tête. 40p.
M yr t e ( le) , furies Médailles. 34<S’*
M y tho lo gie ( la ) , en général. <>8 & fuiv. Né-
celfiré de cette connoilïànce. Ib id . Étymologie
du mot Mythologie. 70. En quoi confifte cette
Science. 73. & fuiv. Quelle utilité elle tire de
l’étude des Médailles. 541.343.
N
N arteco pho res ; Empereurs qui porcoient la férule
appellée Narte'x. - 406'.
N a r te x ; férule ou efpèce de feeptre arrondi que
plufieurs Empereurs portent lur les Médailles.
-4©êv
N a tur e ( la ) adorée par les Païens. ^ 79.
N au ar ch id e ; titre qui donnoit à certafnés Villes
grecques l’Intendance fur la Marine. 511;
N é cromancie ( la ) , eft l’Art d’évoquer les'Morts.
154. Son origine, félon M. Rollin. Ib id . 8c f.
N éméses ( les Déelfes ) étoient des figures fymboliques
qui annonçoient certaines fêtes. 197
3c fuiv. On les fais préfider à la vengeance ce-
ET R A I S O N N É E
lefte. 198 & fuiv. Comment elles font repré-
fentées fur les Médailles. 199. Leurs ornemens
dé tête. 400.
N emrod , grand Chafteur. 146. Figure fymbo-
lique qui annonçoit les ChalTes- 120. Pris pour
Bélus. 27 6.
N eocore ; dignité chez les Grecs, accordée foie à
des Particuliers foit à des Provinces. 507. Comment
on comptoir le nombre des -Néocories ,
fur les Médailles grecques. Ib id . 512.
NÉocorie ; voye^ Néocore.
N eoménies. (les) ; fêtes chez les Égyptiens. 100. ■ H & fuiv.
N eptune ; figure fymbolique qui annonçoit l’arrivée
d’une Flotte. 99. 199 & fuiv. On en a
fait le Dieu de la Mer & des Eaux. 201. Comment
on le repréfente fur les Médailles. Ib id .
3c fuiv. Ses ornemens de tête. 400.
N éréides (les), comme Déelfes; voye^ Neptune.
Comme Monftres repréfentés fur les Médailles.
3 5 6. Sans ornement de tête. 400.
N éron opprima la Liberté. 418. Arracha le titre
de Père de la Patrie à la crainte. 531.
N éron fur une Médaille Contôrniate. 39.
Nerva fit frapper des Médailles reftituées. 54.
par quels motifs. 5 6 . Il affranchit les Juifs de
l’Impôt que Tite leur avoit impofé. 420. il décharge
les Provinces des convois & de la vchi-
•' culanon. 420. Fait des diftributions d’argent &
de vivres au Peuple. 421.
N icaise (M . l’Abbe) nous a donné une Médaille
d’Hadrien , dont le revers repréfente un Panthéon
mixte. ' ' 231.
N icoméde , Roi de Bithynie, donne fon Royaume
aux Romains. 518.
Nil ; fon débordement néceflaire à l’Egypte. 94.
Par quels fymboles on l’annoncoit. Ib id . 3c fuiv.
9^. 99, 100. 102. 104. 105. 106 . 107. Le
Dieu Canope n’étoit qu’une mefure de ce débordement.
125. Le N il, fur les Médailles.
3 3 4 3c fuiv.
Noé , félon M. Rollin, adoré fous le nom de
Saturne. 8 9 & fuiy. 213.
N oble 3c très-Noble; titres donnés, fur les Médailles
, à plufieurs Empereurs, à leurs Fils 3c aux
Princes du Sang. 5 3 & fuiv.
N oblesse ( la ) divinifée fous différens rapports.
257. Comment on l’a repréfentée fur les Médailles.
257 & fuiv
N om ( le ) fervoit chez les Romains, comme chez
nous, à diftinguer les familles & à faire con-
noître les fouches. 479.
Nom adjeéfcif (le) s’ajoutoit chez les Romains,
comme chez nous , aux autres. 480. Les noms
k adjeétifs fe font fouvent confidérablement multipliés.
... Ibid.
N oms différens qui étoient en ufage chez les Romains.
478. On en prenoit ordinairement trois,
& quelquefois quatre. Ib id . Quels étoiens ces
noms. Ib id . 3c fuiv/ Dans quel ordre ils font
placés fur les Médailles. 480. Les Impératrices
ont auflî pris plufieurs noms fur les Médailles,
f \ Ibid.
N oms différens qu’on a donnés aux Médailles. 15
8c fuiv.
Nuit ( la ) a fes beautés 3c fes avantages ; ce qui
l’a fait divinifer & regarder par les uns comme
fille du Cahos , & par d’aut res comme Diane-
Lucifere. 258. Comment on l’a repréfeùtée fur
les Médailles. Ib id .
Numa-Pompilivs , fécond Roi de Rome. 63. Y
D E S M A T I È R E S. 57S
introduifit l’ufage du bronze. Ib id .
N u m m i s i s p é r i ; nom des Médailles les mieux
frappées. 54.
N u m m i R e v o c a t i ( les) étoient une forte
de Médailles.
O bélisques ( les ) , fur les Médailles. 370 & fuiv.
O bserv a t ion s fur les Médailles imitées, contrefaites
& fuppofées. . 5 5 3c fuiv.
O bsidionales ( Monnoies) faites de carton. 13.
Leur forme. 13. Frappées pendant les fiègex'des
Villes, par l’ordre du Commandant, des Ma-
giftrats, ou même du Peuple. 47. Elles font
ordinairement d’un mauvais métal & d’une fabrique
groffière. 47 & fuiv. Leurs Types 3c
lnfcripuons n’ont pas de règles certaines. 48.
Leur antiquité. Ib id . Lukius en rapporte une
fort finguliere. Ib id . Quelles marques elles doivent
avoir pour erre reçues comme Monnoies.
48 3c fuiv. On n’en trouve aucune avéc la tête
d’un fimple Gouverneur, avimr celles qui furent
frappées au fiege de Tourn .i. 49. Il ne faut pas
confondre ces lottes de Médailles avec celles
qui ont ete frappées, à loccafion d’un liège., ou
de la prile d’une Ville. . ., ,, Ib id t
O fficiers ; quels étoient leurs armes. 3 SS & fuiy.
O iseaux ( les ),, après avoir fervi de fymboles aux
Egyptiens pour annoncer les Vents, ont été
divinifes. 326 3c fuiv., Qui font ceux qui ont
eu cet honueur. Ib id Comment on les a repré-
fentes fur les Médailles. 326 3c fuiv.
O l iv ie r ( 1’ ) , fur les Médailles. \
O l l a ; pot dans lequel les Prêtres fàifoient cuire
les viandes des Vidimes. 292.
O nciales ( les pièces ) des Villes Autonomes de
la Grèce de Syrie, &c. font une forte de Mon-
noie- ; 30 & fuiv.
OrJ ( les Médailles d’ ) ne furent frappées a Rome
que vers la fin du VIe. fiècle. 495. L’or des
Médaillés fu’"p des doit être éprouvé 6c comparé
avec celui des anciennes du meme temps. 352.
O r a c les ; ce que les Païens en penfôienc. 2963c
fuiv.. Celui de Delphes étoit un des plus fameux.
3 05. Leur origine vient de l'Ecriture facrée des'
Égyptiens. ^ 305 & fuiv.
O rnemens ( differens ) qui fe trouvent fur les
Médailles des Empereurs, & ce quils figni-
fient- 4:: J & Æiv.
O rnemens de tête ( les ) des Divinités , for les
Médaillés. 354 & fuiv. C eux des Divinités de
la fécondé clalfe. 402. & fuiv. Ceux des Empereurs
, des Rois , des Princes & des Perfon-
11 âges Illuftres. Ibid. Ceux des Impératrices 3c
des Princelfes. 405.
O siris ; fymbole du Soleil , Modérateur des Af-
tres 3c de la Nature 98. 216 3c fuiv. Ses /ym-
bo es fubalcernes. Ibid. 98 & fuiv. Ofiris fur
fon trône 101. Sans tête. Ib id . A tête de loup.
106 . Le même que le Soleil 111 & fifiv. Figure
fymbolique de l’écriture facrée. 170 8c foiv.
On le fair le mari d’ïfis. 177. Comment on le
repréfente fur les Médailles. 17 8.
O thon porté au Camp Prétorien pour y être proclamé
Céfar & Augufte par les Soldats. 389.
O thon ( les Médailles d’ ) degrand ou de moyen
bronze font fore eftimées. 408. Les Médsille ;
de cet Empereur ont été fouvent contrefaites
ou imitées. 5 52. Ce n’eft que depuis quelque
I