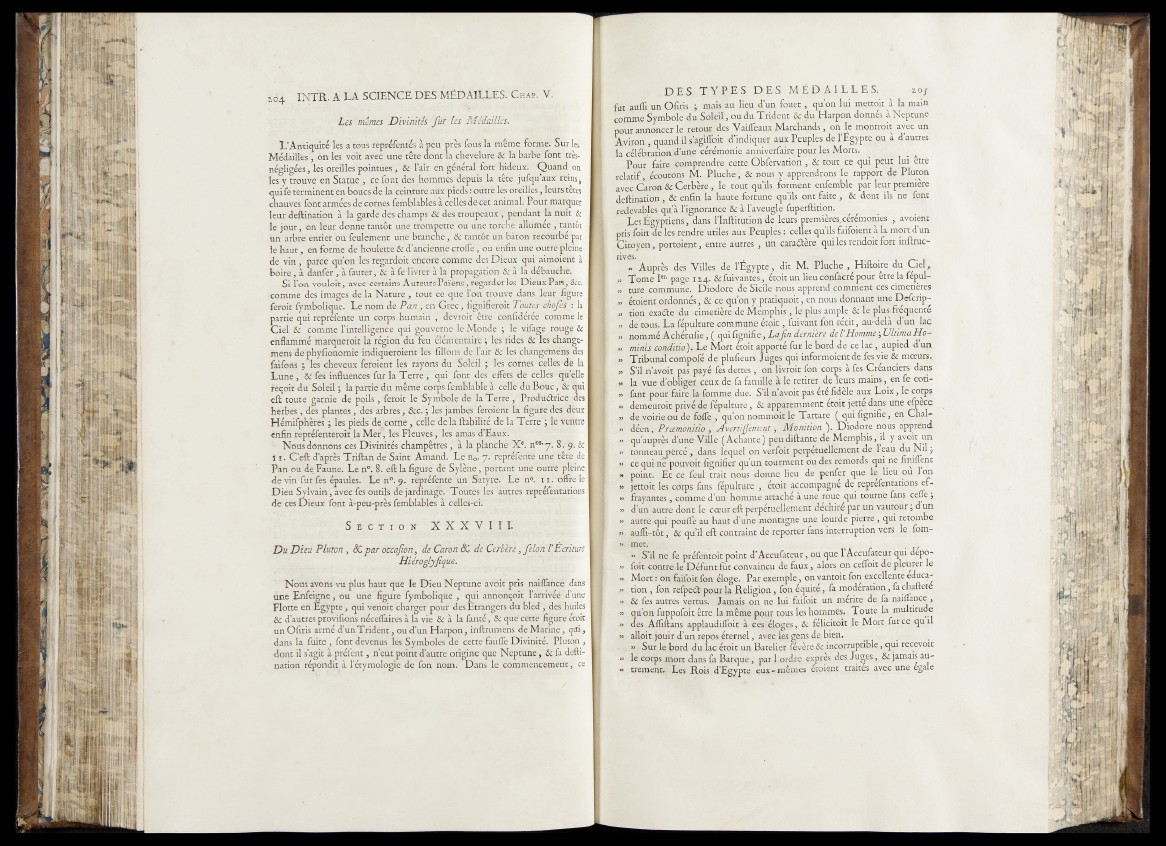
Les mêmes Divinités fu r les Médailles.
L ’Antiquité les a tous repréfentés à peu près fous la même forme. Sur les
Médailles, on les voit avec une tête dont la chevelure & la barbe font très-
négligées, les oreilles pointues, & l’air en général fort hideux. Quand on
les y trouve en Statue , ce font des hommes depuis la tete jufquaux reins,
quife terminent en boucs de la ceinture aux pieds : outre les oreilles, leurs tetes
chauves font armées de cornes femblables à celles de cet animal. Pour marquer
leur deftination à la garde des champs & des troupeaux , pendant la nuit &
le jour, on leur donne tantôt une trompette ou une torche allumée , tantôt
iin arbre entier ou feulement une branche, & tantôt un bâton recourbe par
le haut, en forme de houlette & d’ancienne croffe, ou enfin une outre pleine
de v in , parce qu’on les regardoit encore comme des Dieux qui aimoient à
boire , à danfer , à fauter, & à fe livrer à la propagation & à la débauche.
Si l’on vouloir, avec certains Auteurs Païens, regarderies Dieux Pan, &c.
comme des images de la Nature , tout ce que l’on trouve dans leur figure
feroit fymbolique. Le nom de Pan , en Grec , fignifieroit Toutes chofes : la
partie qui reprefente un corps humain , devrait être confidérée comme le
C ie l & comme l’intelligence qui gouverne le Monde ; le vifage rouge &
enflammé marquerait la région du feu élémentaire ; les rides & les change-
mens de phyfionomie indiqueraient les filions de l ’air & les changeméns des
faifons ; les cheveux feraient les rayons du Soleil ; les cornés ' celles de la
L u n e , & fes influences fur la T e r r e , qui font des effets de celles quelle
reçoit du Soleil ; la partie du même corps femblable à celle du Botic, & qui
eft toute garnie de poils, feroit le Symbole de la T e r r e , Productrice des
herbes , des plantes , des arbres, &c. ; les jambes feraient la figure des deux
Hémifphères ; les pieds de corne, celle de la Habilité de la Terre le ventre
enfin repréfenteroit la M e r , les Fleuves, les amas d’Eaux.
■ Nous donnons ces Divinités champêtres, à la planche X e. n°5- ~j. 8. 9. &
1 1. C ’eft d’après Triftan de Saint Amand. Le n0. 7. repréfente une tête de
Pan ou de.Faune. Le n°. 8. eft la figure de Sylène, portant une outre pleine
devin fur fes épaules. Le n°. 9. repréfente un Satyre. Le n°. 1 1 . offre le
Dieu Sylvain, avec fes outils de jardinage. Toutes les autres repréfentations
de ces Dieux font à-peu-près femblables à celles-ci.
S e c t i o n X X X V I I I .
D u Dieu Pluton, êC par occafon, de Caron SC de Cerbère, félon l’Ecriture
Hiéroglyfaue.
Nous avons vu plus haut que le Dieu Neptune avoit pris naifTance dans
fine Enfeigne, ou une figure fymbolique , qui annonçoit l’arrivee d’une
Flotte en Egypte , qui venoit charger pour des Étrangers du bled, des huiles
8c d’autres provifions néceffaires à la vie & à la fanté, & que cette figure étoit
un Ofiris armé d’un T rident, ou d’un Harpon, inftrumens de Marine, qui,
dans la fuite , font devenus les Symboles de cette fauffe Divinité. Plutqn ,
dont il s’agit à préfent, n’eut point d’autre origine que Neptune, & fadéfti-
nation répondit à l’étymologie de fon nom. Dans le commencement, ce
fut aulfi un Ofiris ; mais au lieu d’un fo u e t, qu’on lui mettoit à la main
comme Symbole du Soleil, ou du Trident & du Harpon donnés à Neptune
pour annoncer le retour des Vaiffeaux Marchands, on le montrait avec un
Aviron , quand il s’agifToit d’indiquer aux Peuples de l’Égypte ou à d autres
la célébration d’une cérémonie anniverfaire pour les Morts.
Pour faire comprendre cette Obfervation, & tout ce qui peut lui être
relatif, écoutons M. Pluche, & nous y apprendrons le rapport de Pluton
avec Caron & Cerbère , le tout qu’ils forment enfemble par leur première
deftination, & enfin la haute fortune qu’ils ont faite , & dont ils ne font
redevables qu’à l’ignorance & à l’aveugle fuperftition. ^
Les Égyptiens, dans l’Inftitution de leurs premières..cerémonies , avoient
pris foin de les rendre utiles aux Peuples : celles qu ils faifoient a la mort d un
Citoyen, portoient, entre autres , un caractère qui les rendoit fort inftruc-
tivés. ,
» Auprès des Villes de 1 É gypte, dit M. Pluche , Hiftoira du C ie l,
» Tome Ier’ page 12.4.. &fuivantes, étoit un lieu confacre pour erre la fepul-
» rare commune. Diodore de Sicile nous apprend comment ces cimetières
» étoient ordonnés, & ce qu’on y pratiquoit , en nous donnant une Defcrip-
» tion exaéte du cimetière de Memphis , le plus ample & le plus fréquenté
„ de tous. La fépulture commune éto it, fuivant fon récit, au-dela dun lac
„ nommé A chérufie, ( qui lignifie, Lafin dernière de l’Hommê ; UltimaHo-
„ minis conditio). Le Mort etoit apporté fur le bord de ce lac, aupied d un
» Tribunal compofé de plufieurs Juges qui informoieiit de fes vie & moeurs,
» S’il n’avoit pas payé fes dettes , on livrait fon corps a fes Créanciers dans
« la vue d’obliger ceux de fa famille à le retirer de leurs mains, en fe coti-
» fant pour faire la fomme due. S’il n’avoit pas ete fidele aux L o ix , le corps
» demeurait privé de fépulture , & apparemment etoit jette dans une efpece
» de voirie ou de foffe , qu’on nommoit le Tartare ( qui fignifie, en Chal-
. »• déen, Prcemonttio , dvertifjement, Momtion ). Diodore nous apprend
» qu’auprès d’une Ville (Achante) peudiftante de Memphis, il y avoit un
» tonneau percé , dans lequel on verfoit perpétuellement de 1 eau du N il £
« ce qui ne pouvoit fignifier qu’un tourment ou des remords qui ne finilfent
» point. E t ce feul trait nous donne lieu de perifer que le lieu ou 1 on
» jettoit les corps fans fépulture , étoit accompagne de reprefentations ef-
•> frayantes , comme d’un homme attaché a une roue qui tourne fans celle ,
» d’un autre dont le coeur eft perpétuellement déchiré par un vautour j d un
» autre qui poulfe au haut d’une montagne une lourde pierre, qui retombe
« aulfi-tôt, & qu’il eft contraint de reporter fans interruption vers le fom-
•> S’il ne fe préfentoit point d’A ccufateur, ou que 1 Accufateur qui dépoli
foit contre le Défunt fût convaincu de faux, alors on celfoit de pleurer le
« Mort : on faifoit fon éloge. Par exemple, on vantoit fon excellente educa-
» tion , fon refpedt pour la Religion , fon équité, fa modération, fa chafteté
>? & fes autres vertus. Jamais on ne lui faifoit un mérité de fa nailfance,
» qu’on fuppofoit être la même pour tous les hommes. Toute la multitude
i> des Alfiftans applaudilfoit à ces éloges, & félicitoit le Mort fur ce qu il
11 alloit jouir d’un repos éternel, avec les gens de bien.
>1 Sur le bord du lac étoit un Batelier févère & incorruptible, qui recevoir
« le corps mort dans fa Barque, par 1 ordre exprès des Ju^es, & jamais au-
» trament. Les Rois d’Égypte eux-mûmes étoient traités avec une égalé