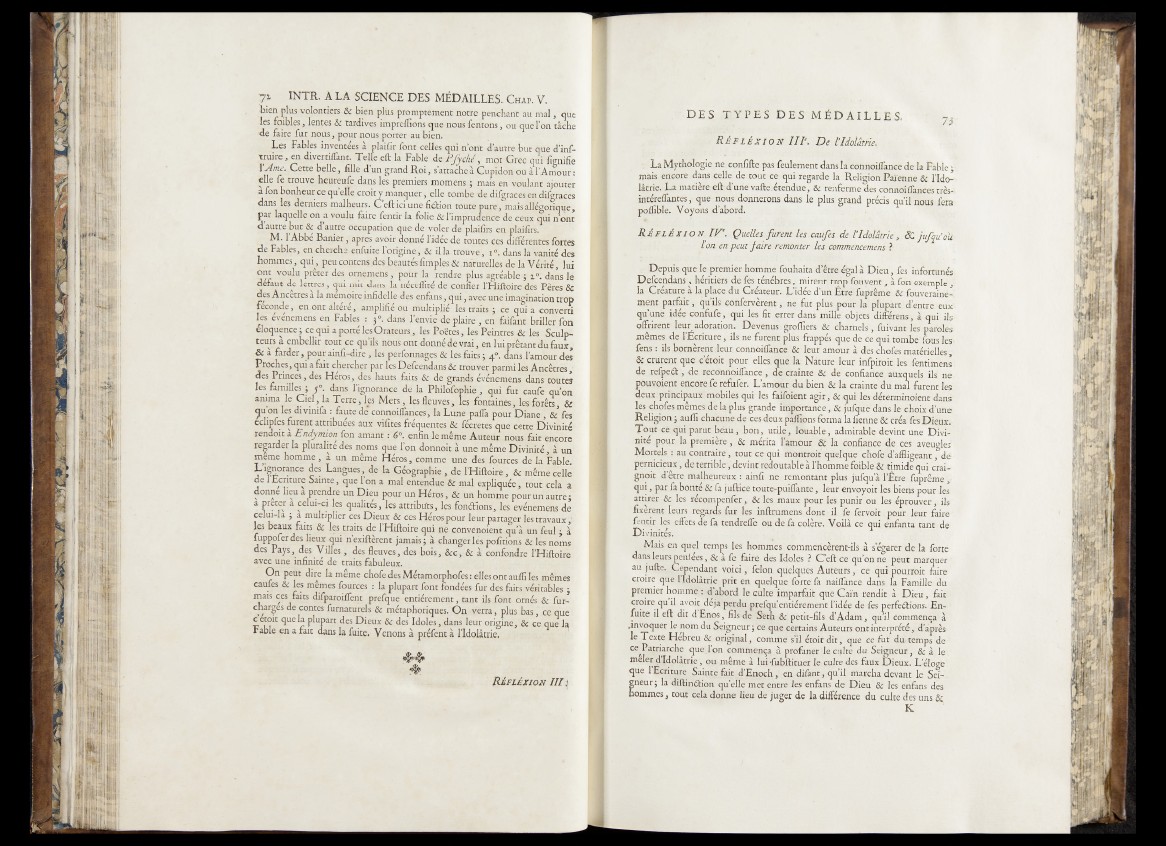
•bien plus volontiers & bien plus promptement notre penchant au m a l, que
les foibles, lentes & tardives impreflions que nous Tentons, ou que l’on tâche
■ de faire fur nous, pour nous porter au bien.
Les Fables inventées a plaifir font celles qui n’ont d’autre but que d’inf-
truire, en divertiffant. Telle eft la Fable de Pfyche, mot Grec qui fignifie
l'Ame. Cette belle, fille d’un grand R o i , s’attache à Cupidon ou à l ’Amour :
elle fe trouve heureufe dans les premiers momens ; mais en voulant ajouter
a fon bonheur ce qu elle croit y manquer, elle tombe de difgraces en difgraces
dans les derniers malheurs. C eft ici une fiction toute pure, mais allégorique,
par laquelle on a voulu faire fentir la folie & l’imprudence de ceux qui n’ont
d autre but &c d autre occupation que de voler de plaifirs en plaifirs.
M. 1 Abbe Baruer, apres avoir donné 1 idée de toutes ces différentes fortes
de Fables, en cherche enfuite l ’origine, & ilia trouve, i°. dans la vanité des
hommes, qui, peu contens des beautés fimples & naturelles de la V érité, lui
ont voulu prêter des ornemens, pour la rendre plus agréable ; i° . dans le
défaut de lettres, cjui mit dans la néceffité de confier l’Hiftoire des Pères &
des Ancêtres a la mémoire mfidelle des enfans, qui, avec une imagination trop
fécondé, en ont altéré, amplifie ou multiplié les traits ; ce qui a converti
les événemens en Fables : 3°. dans l ’envie déplaire, en faifanc briller fon
éloquence; ce qui a porté les Orateurs, les Poëtes, les Peintres & les Sculpteurs
a embellir tout ce qu ils nous ont donne de vrai, en lui prêtant du faux
& a farder, pour ainfi-dire, les perfonnages & les faits; 4°. danc l’amour des
Proches, qui a fait chercher par les Defcendans & trouver parmi les Ancêtres ,
des Princes, des Héros, des hauts faits & de grands événemens dans toutes
. familles ; j° . dans 1 ignorance de la Philofophie, qui fut caufe qu’on
anima le C ie l , la T erre, les Me rs , les fleuves, les fontaines, les forêts, &
cju on les divinifa : faute de connoiflances, la Lune pafla pour D ian e , & fes
eclipfes furent attribuées aux vifites fréquentes & fécretes que cette Divinité
rendoit a Endymion fon amant : 6°. enfin le même Auteur nous fait encore
regarder la pluralité des noms que 1 on donnoit à une même Divinité, à un
meme homme, a un même Héros, comme une des fources de la Fable.
Lignorance des Langues, de la Géographie , de l ’Hiftoire , & même celle
de 1 Ecriture Sainte, que 1 on a mal entendue & mal expliquée, tout cela a
donne lieu a prendre un Dieu pour un Héros, & un homme pour un autre;
a prêter a celui-ci les qualités, les attributs, les fondions, les evénemens de
celui-là ; a multiplier ces Dieux & ces Héros pour leur partager les travaux
les beaux faits & les traits de 1 Hiftoire qui ne convenoient qu’à un feul ; à
fuppoferdes lieux qui nexiftèrent jamais; à changer les pofitions & les noms
des Pays, des V ille s , des fleuves, des bois, & c , & à confondre l’Hiftoire
avec une infinité de traits fabuleux.
O n peut dire la même chofe des Métamorphofes : elles ont auffi les mêmes
cauies & les memes fources : la plupart font fondées fur des faits véritables ;
mais ces faits difparoiffent prefque entièrement, tant ils font ornés & fur-
charges de contes furnaturels & métaphoriques. O n verra, plus bas, ce que
cetoit que la plupart des Dieux & des Idoles, dans leur origine, & ce que la
Fable en a fait dans la fuite. Venons à préfenc à l ’Idolâtrie.
Réflexion I II j
D E S T Y P E S D E S M É D A I L L E S . 7i
r é f l e x i o n I I P . D e l ’Idolâtrie.
La Mythologie ne confifte pas feulement dans la connoiffance de la Fable ;
mais encore dans celle de tout ce qui regarde la Religion Païenne & l’Idolâtrie.
La matière eft d’une vafte.étendue, & renferme des connoiffances très-
intéreffantes, que nous donnerons dans le plus grand précis qu’il nous fera
poffible. Voyons d’abord.
Ré f l exi on I V *. Quelles furent les caufes de l ’Idolâtrie, dC jufgu’ ok
l'on, en peut faire remonter les commencemens ?
Depuis que le premier homme fouhaita d’être égal à D ie u , fes infortunés
Defcendans , héritiers de fes ténèbres, mirent trop fouvent, â fon exemple ,
la Créature a la place du Créateur. L idée d’un Être fuprême & fouveraine-
ment parfait, qu’ils confervèrent, ne fut plus pour la plupart d’entre eux
qu’une idée confufe, qui les fit errer dans mille objets différens, à qui ils
offrirent leur adoration. Devenus greffiers & charnels, fuivant les paroles
mêmes de l’Écriture, ils ne furent plus frappés que de ce qui tombe fous les-
fens : ils bornèrent leur connoiffance & leur amour â des chofes matérielles
& crurent que c’étoit pour elles que la Nature leur infpiroit les fentimens
de refpeCt, de reconnoiffance, de crainte & de confiance auxquels ils ne
pouvoient encore fe refufer. L ’amour du bien & la crainte du mal furent les
deux principaux mobiles qui les faifoient agir, & qui les déterminoient dans
les chofes mêmes de la plus grande importance, & jufque dans le choix d’une
Religion ; auffi chacune de ces deux pallions forma la lîenne & créa fes Dieux.
To u t ce qui parut beau, bon, utile, louable, admirable devint une Divinité
pour la première, & mérita l’amour &c la confiance de ces aveugles
Mortels : au contraire, tout ce qui montroit quelque chofe d’affligeaht, de
pernicieux, de terrible, devint redoutable à l’homme foible & timide qui crai-
gnoit d être malheureux : ainfi ne remontant plus jufqu a l’Être fuprême ,
q u i, par fa bonté & fa juftice toute-puiffante, leur envoyoit les biens pour les
attirer & les récompenfer, & les maux pour les punir ou les éprouver, ils
fixèrent leurs regards fur les inftrumens dont il fe fervoit pour leur faire
fentir les effets de fa tendreffe ou de fa colère. Voilà ce qui enfanta tant de
Divinités.
Mais en quel temps les hommes commencèrent-ils à s’égarer de la force
dans leurs penlees, & a fe faire des Idoles ? C ’eft ce qu’on ne peut marquer
au jufte. Cependant v oic i, félon quelques Auteurs, ce qui pourrait faire
croire que 1 Idolâtrie prit en quelque forte fa naiffance dans la Famille du
premier homme : d abord le culte imparfait que Caïn rendit à D ie u , fait
croire quil avoit déjà perdu prefqu’entiérement l’idée de fes perfections. En-
fuite il eft dit dEnos, fils de Seth & petit-fils d’Adam, qu’il commença à
.invoquer le nom du Seigneur ; ce que certains Auteurs ont interprété, d’après
le Texte Hebreu & original, comme s’il étoit d it, que ce fut du temps de
ce^Patriarche que Ion commença à profaner le culte du Seigneur, & à le
meler d Idolâtrie, ou même à lui fubftituer le culte des faux Dieux. L ’élooe
que 1 Ecriture Sainte lait d’Enoch, en difant, qu’il marcha devant le Seigneur
; la diftinCrion qu’elle met entre les enfans de Dieu ôc les enfans des
hommes, tout cela donne lieu de juger de la différence du culte des uns &
K