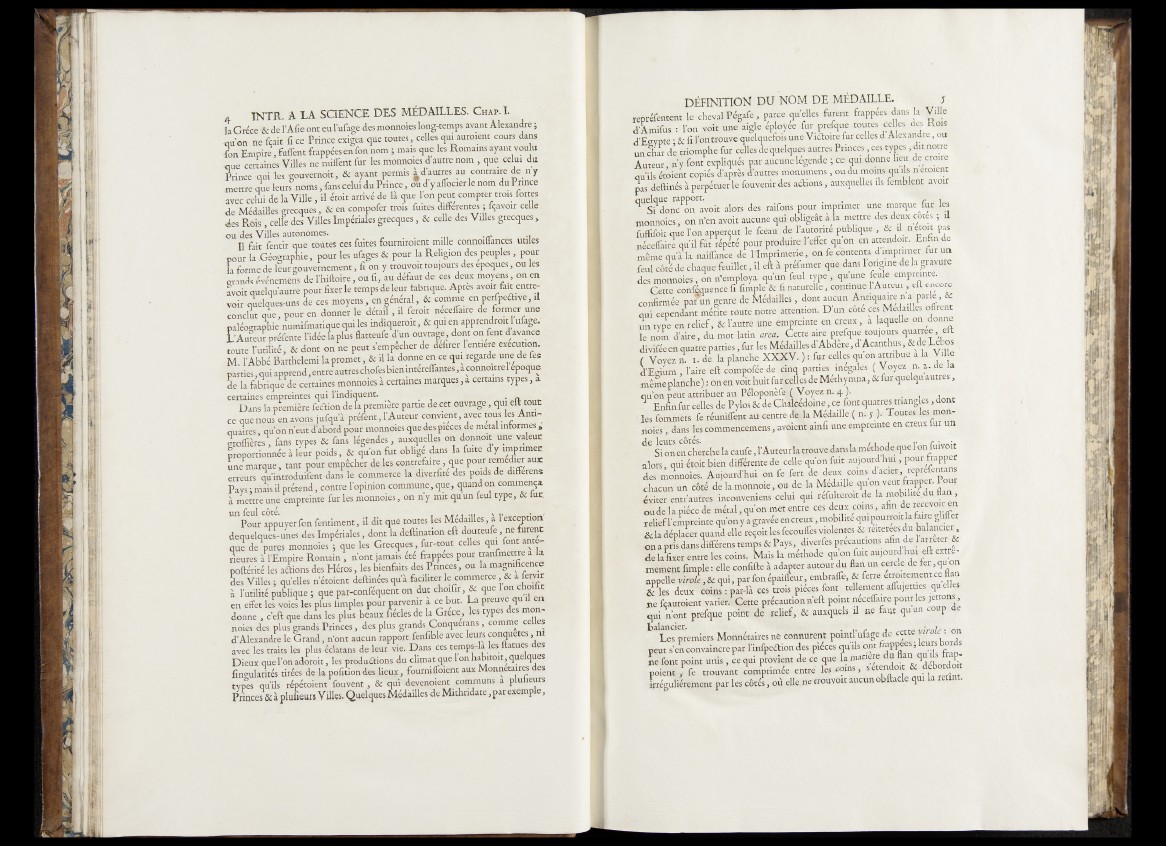
la Grèce & de l’A fie ont eu l’ufage des monnoies long-temps avant Alexandre ;
quon ne fiait fi ce Prince exigea que toutes, celles qui auraient cours dans
fon Empire fuffent frappées en fon nom ; mais que les Romains ayant voulu
«ue certaines Villes ne truffent fur les monnoies d’autre nom , que celui du
Prince qui les -gouvernoit, & ayant permis ^ ’autres au contraire de n y
.mettre mie leurs noms, fans celui du P rince, 0T1 d y affocier le nom du Prince
avec celui de la Ville | il étoit arrivé de R que l’on peut compter trois fortes
■ de Médailles grecques, & en compofer trois fuites differentes; Ravoir celle
des Rois , celle des Villes Impériales grecques, & celle des Villes grecques,
ou des Villes autonomes. . . ... -i
Il fait fentir que toutes ces fuites fourniraient mille connoiilances utiles
oour la Géographie, pour les ufages & pour la Religion des^euples , pour
la forme de leur gouvernement, fi on y trouvoit toujours des époques, ou les
crrands événemens de l’hiftoire, ou fi, au défaut de ces deux moyens , on en
avoir quelqu’autre pour fixer le temps de leur fabrique. Apres avoir fait entrevoir
quelques-uns de ces moyens , en général, & comme en perfpeéhve, il
conclut que, pour en donner le détail, il ferait nécelfaire de former une
paléographie numifmatique qui les indiquerait, & qui en apprendrait 1 ufage.
L ’Auteur préfente l’idée la plus flatteufe d un ouvrage, dont on fent devance
toute l’utilité, & dont on ne peut s’empêcher de defirer 1 entière execution.
M. l’Abbé Barthelemi la promet, & il la donne en ce qui regarde une de fis
parties qui apprend, entre autreschofesbienintereffantes, aconnoitre époque
de la fabrique de certaines monnoies à certaines marques, a certains types, a
certaines empreintes qui 1 indiquent. _
Dans la première feftion de la première partie de cet ouvrage, qui eft tout
ce que nous en avons j ufqu a préfent, l’Auteur convient, avec tous les Antl-
ouaires, qu’on n’eut d’abord pour monnoies que des pièces de métal informes ,
groffières, fans types & fans légendes, auxquelles on donnoit une valeur
proportionnée à leur poids, & qu’on fut oblige dans la fuite y imprimer
une marque, tant pour empêcher de les contrefaire, que pour remedier aux
erreurs qu'introduifent dans le commerce la diverfite des poids de differens
Pays ; mais il prétend, contre l’opinion commune, que, quand on commença
à mettre une empreinte fur les monnoies, on n y mit quun feul type, & lut.
Pour appuyer fon fentiment, il dit que toutes les Médailles, a 1 exception
dequelques-unes des Impériales, dont la dèftination eft douteufe, ne furent
que de pures monnoies ; que les Grecques, fur-tout Celles qui font anterieures
à l’Empire Romain , n’ont jamais ete frappées pour tran mettre a
poftérité les adions des Héros, les bienfaits des Princes, ou la magmficenc
des Villes ; quelles n’étoient deftinéesqu’à faciliter le commerce, & a lervir
à l’utilité publique ; que par-conféquent on dût choifir, & que Ion cho
en effet les voies les plus iimples pour parvenir a ce but. La preuve qu il en
donne , c’eft que dans les plus beaux fiécles de la Grèce, les types des monnoies
des plus grands Princes, des plus grands Conquérans, comme ce es
d’Alexandre le Grand, n’ont aucun rapport fenfible avec leurs conquêtes, ni
avec les traits les plus éclatans de leur vie. Dans ces temps- a es atues es
Dieux que l’on adorait, les produdions du climat que 1 on habitoit, que ques
Angularités tirées de la pofition des lieux, fourniffoient aux Monnétaires des
tvpes qu’ils répétoient fouvent., & qui devenoient communs a p u leurs
Princes & d plufieu» Villes. Quelques Médàilles de Mithridate ,par exemple,
reprérentent le cheval Pégafe, parce quelles furent frappées dans la Ville
d’Amifus : l’on voit une aigle éployee fur prefque toutes cel es Rois
d’Egvnte • & fi l’on trouve quelquefois une Vido ire fur celles d Alexandra, ou
un char de triomphe fur celles de quelques autres Princes, ces types, dit notre
Auteur n’y font expliqués par aucune légende ; ce qui donne lieu de croire
au’ils étoient copiés d’après d’autres monumens , ou du moins qu ils n etoient
pas deftinés à perpétuer le fouvenir des adions, auxquelles ils femblent avoir
Éfffl donc^on avoit alors des raifons pour imprimer une marque Tur le3
monnoies, on n’en avoir aucune qui obligeât à la mettre des deux cotes ; il
fuffifoit que l’on apperçut le fceau de l’autonte publique , & il neroit pas
néceffaire qu’il fût répété .pour produire l ’effet quon en attendoit. Enfin de
même qu'à la naiffance de l ’Imprimerie, on fe contenta d imprimer fur un
feul côté de chaque feuillet, il eft à préfumer que dans 1 origine de la gravure
des monnoies, on n’employa qu’un feul type , quune feule empreinte.
Cette con flu en c e fi fimple & fi naturelle, continue 1 Auteur , eft encore
confirmée parun genre de Médailles, dont aucun Antiquaire na parle, &
qui cependant mérite toute notre attention. D ’un cote ces Médaillés offrent
un type en relief, & l’autre une empreinte en creux, a laquelle on donne
le nom d’aire, du mot latin area. Cette aire prefque toujours quarree eit
diviféeen quatre parties, fur les Médailles d’Abdere, d Acanthus, g § § Lebos I
1 Voyez n. i . de la planche X X X V . ) : fur celles quon attribue a la V il e
d’Egium , l’aire eft compofée de cinq parties inégalés ( Voyez n. g de la
même planche ) : on en voit huit fur celles de Methy mua, & fur quelqu autres,
qu’on peut attribuer au Péloponèfe ( Voyez n. 4 ). . , , r g Enfin fur celles de Pylos & de Chalcédoine, ce fonc quatres triangles, donc
les fommets fe réunifient au centre de la Médaille ( n. ; ). Toutes les monnoies
, dans les commencemens, avoient ainfi une empreinte en creux fur un
W Sionenchérchela caufe, l’Auteur la trouve dans la méthode que l’onfuivoit
alors qui étoit bien différente de celle qu’on fuit aujourd h u i, pour happer
des monnoies. Aujourd’hui on fe fert de deux coins d acier reprefentans
chacun un côté de lamonnoie, ou de la Médaillé quon veut rapjaer. o .
éviter entr’autres inconveniens celui qui réfulteroit de la mobilité du flan,
ou de la pièce de métal, qu’on met entre ces deux coms, afin de recevo n
relief l’empreinte qu’ony a gravée en creux, mobilité quiçourroitla Rire guffer
& la déplacer quand elle reçoit les fecouffes violentes & reiterees du balancier ,
on a pris dans différens temps & Pays diverfes précautions afin de 1 «reter &
de la fixer entre les coins. Mais la méthode qu on fuit aujourd hui eft extrêmement
fimple: elle confifte à adapter autour du flan un cercle de f « , q u n
appeUe virole ,6c qui, par fonépaiffeur, embraffe, & ferre etronement ce flan
& Ples deux coins : par-là ces trois pièces font tellement affujetties quelles
ne fçauroient varier. Cette précaution n’eft point nécefiure pour les jetions,
qui n’ont prefque point de relief, & auxquels il ne faut quun coup üe
balancier. I »
Les premiers Monnétaires ne connurent pointl’ufage de cette virole: on
peut s’en convaincre par l’infpeétion des pièces qu’ils onc huppees ; kurs boi s
l e font point unis, ce qui provient de ce que la maciere du
poient J fe trouvant comprimée entre les coins, setendoi & debordou
irrégulièrement par les ■ g & f f l " e trouvolt aUCUn ° bftack qU‘ m