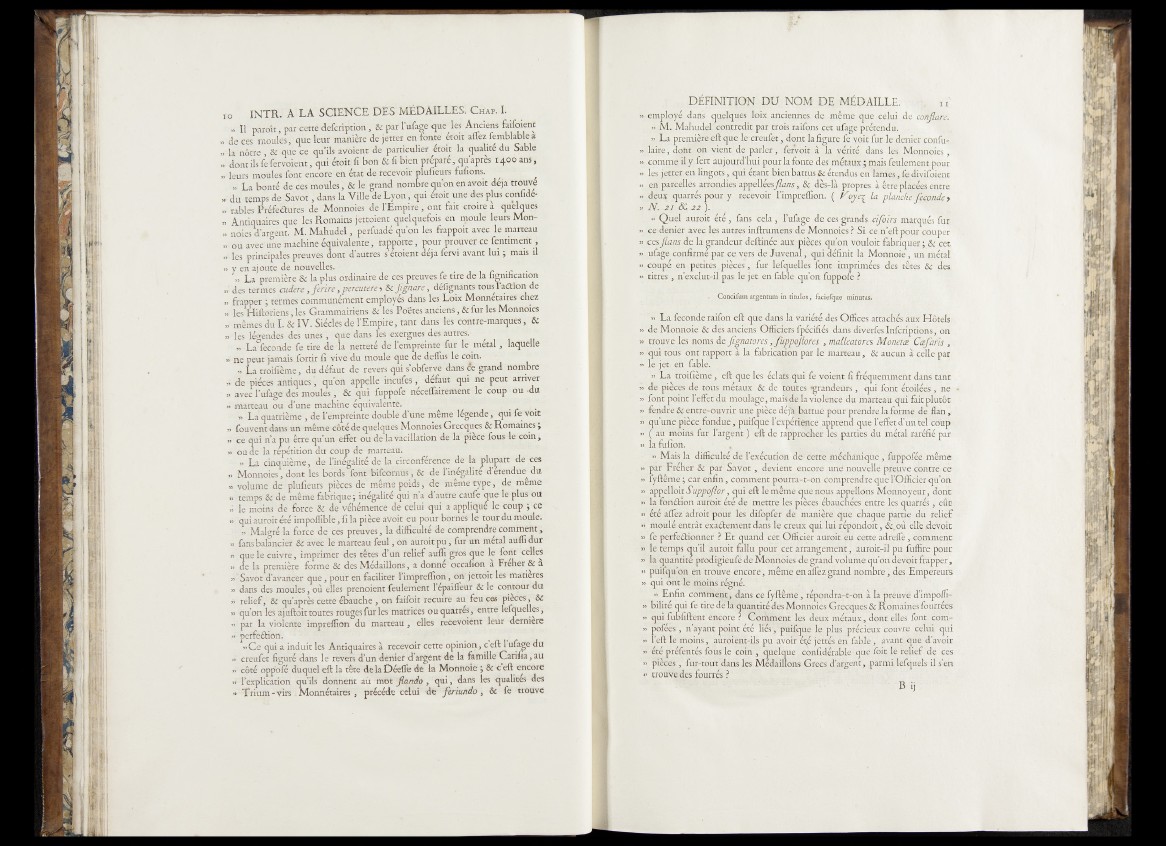
» Il paraît, par cette defcription, & par l’ufage que les Anciens faifoient
de ces moules, que leur manière de jetter en fonte etoit affez femblable a
». la nôtre , & que ce quils avoient de particulier étoit la qualité du Sable
,» dont ils fe fervoient, qui étoit fi bon & fi bien préparé qu’après 1400 ans,
» leurs moules font encore en état de recevoir plufieurs fufions. ^ ‘
»» La bonté de ces moules, & le grand nombre qu'on en avoir déjà trouve
» du temps de S a vo t, dans la Ville de L y o n , qui etoit une des plus confide-
»» râbles Préfectures de Monnoies de l’Empire, ont fait croire a quelques
»» Antiquaires que les Romains jèttoient quelquefois en moule leurs Mon-
»» noies d’araent. M. Mahudel, perfuadé qu’on les frappoit avec le marteau
», ou avec ime machine équivalente, rapporte, pour prouver ce fentimenp,
»= les principales preuves dont d’autres seraient déjà fervi avant lui ; mais il
»» y en ajoute de nouvelles.
„ La première & la plus ordinaire de ces preuves fe tire de la lignification
des termes cudere , fe r ir e , percutere ? &c flgnare, défignants tous 1 aCtionde
»» frapper ; termes communément employés dans les Loix Monnetaires chez
»» les Hiftoïiens, les Grammairiens & les Poëtes anciens, & fur les Monnoies
»» mêmes du I. & IV . Siècles de l’Empire, tant dans les contre-marques, &
»» les légendes des unes , que dans les exergues des autres.
»» La fécondé fe tire de la netteté de l’empreinte fur le métal, laquelle
» ne peut jamais fortir fi vive du moule que de delfus le coin.
»> La troifième, du défaut de revers qui s’obferve dans de grand nombre
=> de pièces antiques, qu’on appelle incufes , defaut qui ne peut arriver
»» avec l ’ufage des moules , & qui fuppofe necelfairement le coup ou -du
»» marteau ou d’une machine équivalente. . . . .
,» La quatrième, de l’empreinte double d une meme légende, qui fe voit
„ fouvent dans un même côté de quelques Monnoies Grecques & Romaines ,
» ce qui n’a pu être qu’un effet ou de la vacillation de la piece fous le coin,
» ou de la répétition du coup de marteau.
»> La cinquième, de l'inégalité de la circonférence de la plupart de ces
,» Monnoies, dont les bords font bifcornus, & de 1 inégalité d etendue du
». volume de plufieurs pièces de même poids, de meme type, de même
,» temps & de même fabrique; inégalité qui n’a d’autre carde cjue le plus ou
le moins de force & de véhémence de celui qui a applique le coup ; ce
»> qui aurait été impofltble, fi la pièce avoit eu pour bornes le tour du moule.
»» Malgré la force de ces preuves, la difficulté de comprendre comment,
>» fans balancier & avec le marteau feul, on auroit p u, fur un métal auifi dur
n que le cuivre, imprimer des têtes d’un relief auffi gros que le font celles
»> de la première forme & des Médaillons, a donné occafion a Freher &C a
» Savot d’avancer que, pour en faciliter 1 impreffion, on j étroit les matières
»» dans des moules, où elles prenoient feulement 1 épaiflèur & le contour du
»> relief, & qu’après cette ébauche , on faifoit recuire au feu cas pièces, &
» qu’on les ajuftoit toutes rouges fur les matrices ouquarrés, entre kfquelles,
»» par la violente impreffion du marteau, elles recevoient leur derniere
>» perfection.
»»Ce qui a induit les Antiquaires à recevoir cette opinion, c eft 1 ufage du
» creufet figuré dans le revers d’un denier d argent de la famille Carifia, au
» côté oppofé duquel eft la tête de la Déeflè de la Monnole ; & c eft encore
» l’explication qu’ils donnent air mot fltm io , q u i, dans les qualités des
» Trium-virs Monnétaires , précédé celui de fe r iu n d o , & fe trouve
»»-employé dans! quelques loix anciennes de même que celui de conflare.
»> M. Mahudel contredit par trois raifons cet ufage prétendu.
»> La première eft que le creufet, dont la figure fe voit fur le denier confu-
»> laire, doht on vient de parler, fervoit à la vérité dans les Monnoies,
== comme il y fert aujourd’hui pour la fonte des métaux ; mais feulement pour
»» les j etter en lingots, qui étant bien battus & étendus en lames, fe divifoient
=». en parcelles arrondies appellées_/Zu7zr, & dès-là propres à être placées entre
»» deux quarrés pour y recevoir l ’impreffion. ( Voye-^la planche fécon d a
»> IV- 21 SC 22 ).
« Que l auroit é té , fans cela, l’ufage de ces.grands cifoirs marqués fur
»>. ce denier avec les autres inftrumens de Monnoies ? Si ce n’eftpour couper
»» ces flans de la grandeur deftinée aux pièces qu’on vouloit fabriquer ; & cet
>» ufage confirme par ce vers de Juvenal, qui définit la Monnoie, un métal
» coupe en petitesj pièces, fur lefquelles font imprimées des têtes & des
» titres , n’exclut-il pas le jet en fable qu’on fuppofe ?
. Concifum argentum in titulos, faciefque minutas.
»» La fécondé raifon eft que dans la variété des Offices attachés aux Hôtels
»> de Monnoie & des anciens Officiers fpécifiés dans diverfeslnfcriptions, on
»» trouve les noms de fignatores , fuppoftores , malleatores Monetæ Coefaris ,
»> qui tous ont rapport à la fabrication par le marteau, & aucun à celle par
»» le jet en fable.
»> La troifième, eft que les éclats qui fe voient fi fréquemment dans tant
»> de pièces de tous métaux & de toutes •grandeurs, qui font étoilées , ne
»> font point l’effet du moulage, mais de la violence du marteau qui fait plutôt
» fendre & entre-ouvrir une pièce déjkà battue pour prendre la forme de flan ,
» qu’une pièce fondue, puifque l’expérience apprend que l’effet d’un tel coup
»> ( au moins fur l’argent ) eft de rapprocher les parties du métal raréfié par
»» la fufion.
»> Mais la difficulté de l’execution de cette méchânique , fuppôfée même
» par Fréher & par Savot , devient encore une nouvelle preuve contre ce
»> fyftême ; car enfin, comment pourra-t-on comprendre que l’Officier qu’on
» appelloitdizppo/for, qui eft le même que nous appelions Monnoyeur, dont
»> la fonction auroit été de mettre les pièces ébauchées entre les quartés , eût
»> ete affez adroit pour les difopfer de manière que chaque partie du relief
»» moulé entrât exactement dans le creux qui lui répondoit, &.où elle devoit
»> fe perfectionner ? Et quand cet Officier auroit eu cette adreffê, comment
» le temps qu’il auroit fallu pour cet arrangement, auroit-il pu fuffire pour
» la quantité prodigieufe de Monnoies de grand volume qu’on devoit frapper,
»> puifqu’on en trouve encore, même en affez grand nombre, des Empereurs
»> qui ont le moins régné.
»» Enfin comment, dans ce fyftême, répondra-t-on à la preuve d’impoiïï-
» bilité qui fe tire de la quantité des Monnoies Grecques & Romaines fourrées
». qui fubfiftent encore ? Comment les deux métaux, dont elles font com-
». pofées, n’ayant point été liés, puifque le plus précieux couvre celui qui
»> l’eft le moins, aùroient-ils pu avoir ét;é jettés en fable, avant que d’avoir
» été préfentés fous le coin , quelque confidérable que foit le relief de ces
»> pièces , fur-tout dans les Médaillons Grecs d’argenc, parmi lefquels il s’en
»> trouve des fourrés ?
B i j