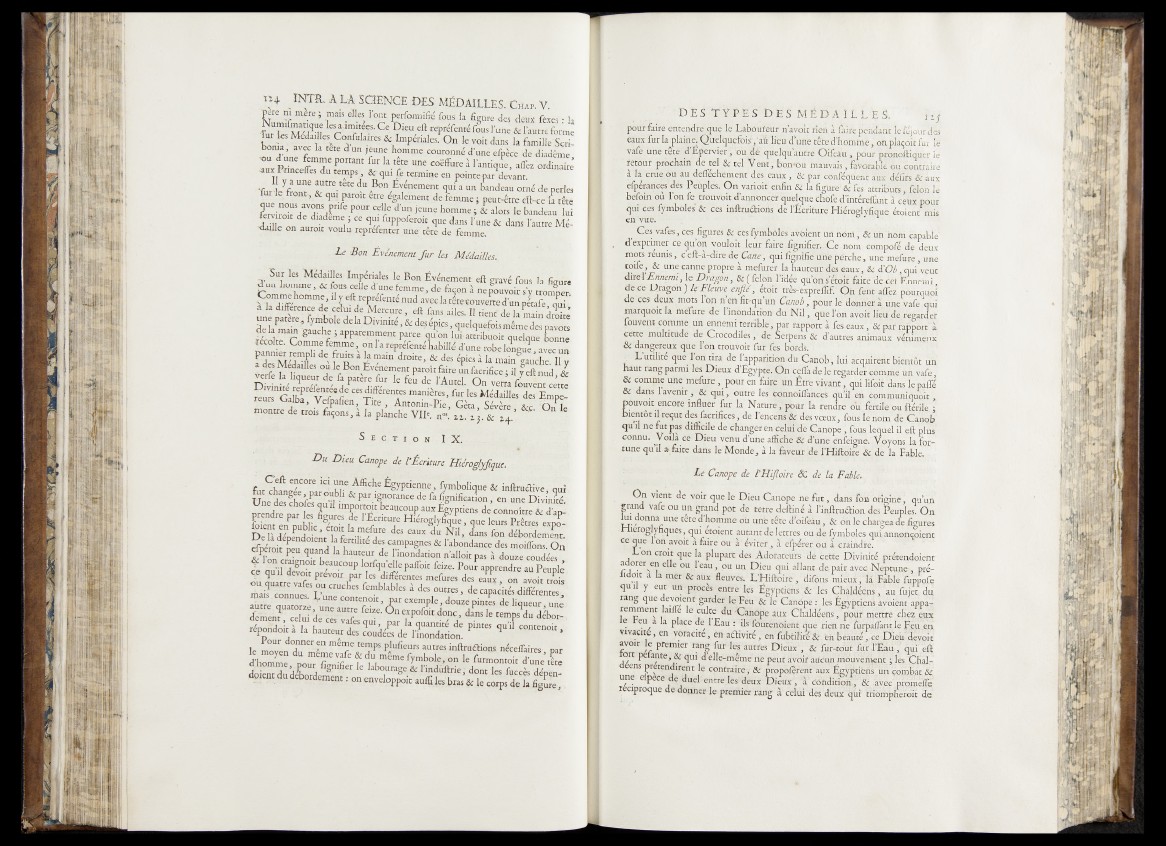
l i t , W | | É L À S C IE N C E D E S M É D A IL L E S . C hap. V .
pere ni mère ; niais elles l'om: perfonnifié fous la figure des deux fêxes : la
S f l W Ê B C e f i M «PréLncé fous lune I l’autre forme
îur les Médaillés^ Cqnfularres & Impériales. O n le voit dans la famille Scri-
boma3 avec la tete lu n jeune homme couronné d’une efpèce de diadème
" J M R e p o r t a n t fur la tête une coëffure I l’antique, affez ordinaire
aux Pnnceffes du temps & q u i fe termme en pointepar devant.
im m è Ê Ê T ü I S l du/Bon/E7 nement qui a un bandeau orné de perles
lui front-, & qui paraît etre également de femme; peut-être eft-ce la tête m m mm r°» SI 5® m IWif ,i„„ WÊM1
J „ , 3B S !3 H B B ; 1 S“ r"PPof«oi. que dam l'une & dam l'aune Mé-
diille on auroit voulu reprefenter une tête de femme.
L e -Bon Evénement fu r les M éd a illes,
Sur les Médaillés Impériales le Bon Événement eft gravé fous la figure
d u n homme, & fous celle dune femme, de façon | ne pouvoir s’y tronmen
V k T f f é r 0 1 a* 1^1J eft/ ePr/ en ten u d avec La tête couverte d’un pétafe, qui
a la différence de celui de Mercure eft fans ailes II nVnr Ap 1, P , *L ’
n p a éK , f y„ f c l , d . l , D ^ ^
f c i l r a ' C om UChf ’ aPPare?I1™ent: P? J qu’on luiaaribuoit quelque bonne
recol e. Comme femme, on 1 a repréfenté habillé d’une robe longue g avec un
a de M ' H de' m a ê T m dmiK’ & des épi« à la mainggauche II y
verfe ^de.dal es ou le Bon Evénement paraît faire un facrifice ; il y eftnud &
verfe la liqueur de fa patere fur le feu de l’Autel. O n verra fouvent cette
S i i r G a S reVef 8 ?" CeTlfféreT N B fm' reurs foalba, Vefpafien, Txte , Antonin-Pie, Gèktas, M SéédvaèirIele s &Bc EOmnp elemontre
de trois façons, à la planche V I I e. n°!. z z . z 3. & '
S e c t i o n I X.
D u Dieu Can°pe de l'Écriture Hiéroglyfiquc.
k ' uu6 Àffic!le Égyptienne, fymbolique & inftructive qui
prendra par les beau“ upaux Egyptiens de connoître & d’apfoient
enPDubhc V ’ f e « Hlerog]y % e , que leurs Prêtres expo-
ïOent en public, etoit la mefure des eaux du N il , dans fon débordement
D e la dependoient la fertilité des campagnes & l’abondance des moiffons Ôn
èfperoit peu quand la hauteur de l’inondation n’alloitpas à d é c i d é e s
% S T beaUCOUP Q u e l l e paffoit feize. Pour apprendre au Peuplé
ce qui! devoit prévoir par les différentes mefures des eaux on avo t t r Ï Ï
S “ S mches remblables à des outres’ mais connues. Lune contenoit, par exemple, douze pintes de liqueur uné
parTPOf°k d°^ ^ ^ "“P dU d'b°rrépondoit
à la hauteur des t f / l g l ^ qUd C° “ >
le m o v e n T 1 “ me? S tC? pS Plufleurs autres inftruftions néceffaires- par
d'hôm7™ t , r r vf f le f i S l g ,
A ' A K. j e ^a^ourage & 1 induftrie, donc les fuccès deoen
dpient du débordement : on enveloppait auffi les bras & le corps de la figure ’
D E S É Ÿ P E S D E S M É D A I L L E S . h]
pour faire entendre que le LabôufeUr n’avoit rien a faire pendant Ieféjourdes
eaux fur la plàirie. Quelquefois'-,'ali lieu d une tête d’homme, on plaçoit fur le
vafe une tête d’Epervietfriu dé qUelqu’autre Oifeàu, pour pronoftiquer le
retour prochain de tel & tel V e n t , bon*ôu mauvais, Favorable ou contraire
à la crue ou au defféchement des eaux, & par cOnfeqiient aux défirs &aux
éfperanees des Peuples. On varioit enfin & la figure'& fes attributs, félon le
befoin où l’on fe trouvbit d’annoncer quelque chofe d’intéreflànt-a ceux pour
qui ces fymboles & ces inftrucrions de l’Écriture Hiéroglyfique étoient mis
en vues
, Ces vafes, ces figures & cèsfymbôles avôient un nom, & un hom capablé
d exprimer ce qu on vouloit leur faire lignifier. C e nom compofé de deux
mots reunis, c eft-a-dire de Cane, qui fignifie Une perche, une mefure, une
toife & une canne propre à mefurer la hauteur des eaux, & d’O b, qui veut
dire 1 Ennemi, le Dragon, & ( feloh 1 idée qu’on s etoit faite de cet Ennemi
de ce Dragon ) le Fleuve enflé, étoir très-éxpreftif. O n fent affez pourquoi
de ces deux mots 1 ôn n’en fit-qu’un Canob, pour le donner à une vafe qui
marquoit la mefure de 1 inondation du N i l , qüe Ion âvoit lieu de regarder
fouvent comme un ennemi terrible, par rapport à fes eaüx, & pat rapport ù
cette multitude de Crocodiles, de Serpens & d’autres animaux vénimenx
& dangereux que l’on trouvoit fur fes bords. :
^ L utilité que^ 1 on tira de 1 apparition du Canob, lui acquirent bientôt uU
haut rang parmi les Dieux d Égypte. O n ceffadele regarder comme un vafe,
& comme une mefure , pour en faire un Être vivant, qui lifoit dans le paffé
& dans 1 avenir, & qui, outre les connoiffances qu’il en cùmmuniquoit
pouvoir encore influer fur la Nature, pour la rendre ou fertile ou ftérile ;
bientôt il reçut des facrifices, de 1 encens & des voeux, fous le nom de Canob
qu il ne fut pas difficile de changer en celui de Canôpe, fous lequel il eft plus
connu. Voila ce Dieu venu dune affiche & d’une enfeigne. Voyons la fortune
qu’il a- faite dans le Monde, à la faveur de l’Hiftoire & de la Fable.
Le Canope de l’Hifloire SC de la Fable.
O n vient de voir que le Dieu Canope ne fu t , dans fon origine, quun
grand vafe ou un grand pot de terre deftiné à l’inftruéHon des Peuples. O n
lui donna une tete d’homme ou une tête ffoifèâu, & ôn le chargea de figures
ieroglytiques, qui etoient autant de lettres ou de fymboles qui annonçoient
ce que 1 on avoit à faire ou à éviter , à efpérer ou à craindre.
on cr° it que la plupart des Adorateurs de cette Divinité prétendoient
a orer^en elle ou leau , ou un Dieu qui allant de pair avec Neptune^, pré-
1 oit a amer & aux fleuves. L Hiftoire , difons mieux, là Fable fuppofo
qui! y eut un procès entre les Égyptiens & lès Chàldéens, au fujet du
ran§ flue ^voient garder le Feu & le Canôpe : lés Égyptiens âvoient appa-
remment aille le culte du Canôpe aux Chaidéens, pour mettre chez eux
e eu a a place dé lE au : ils fôutenôient que rien ne furpaffant le Feu err
vivacité, en voracité, en adtivité, en fubtilité & en beauté,.ce Dieu devoit
f V° lr tr Pfem^er ranS Dr les autres Dieux , & fur-tout fur l’E a u , qui eft
ort p ante, & qui d elle-même ne peut avoir aucun mouvement ; les Chal-
ens pr^ tendirent le contraire, & propofèrent aux Égyptiens un combat &
une efpece de duel entre les deux D ieu x , al condition, & .avec promeffe
réciproque de donner le premier rang à celui dès deux qùi triompherait de