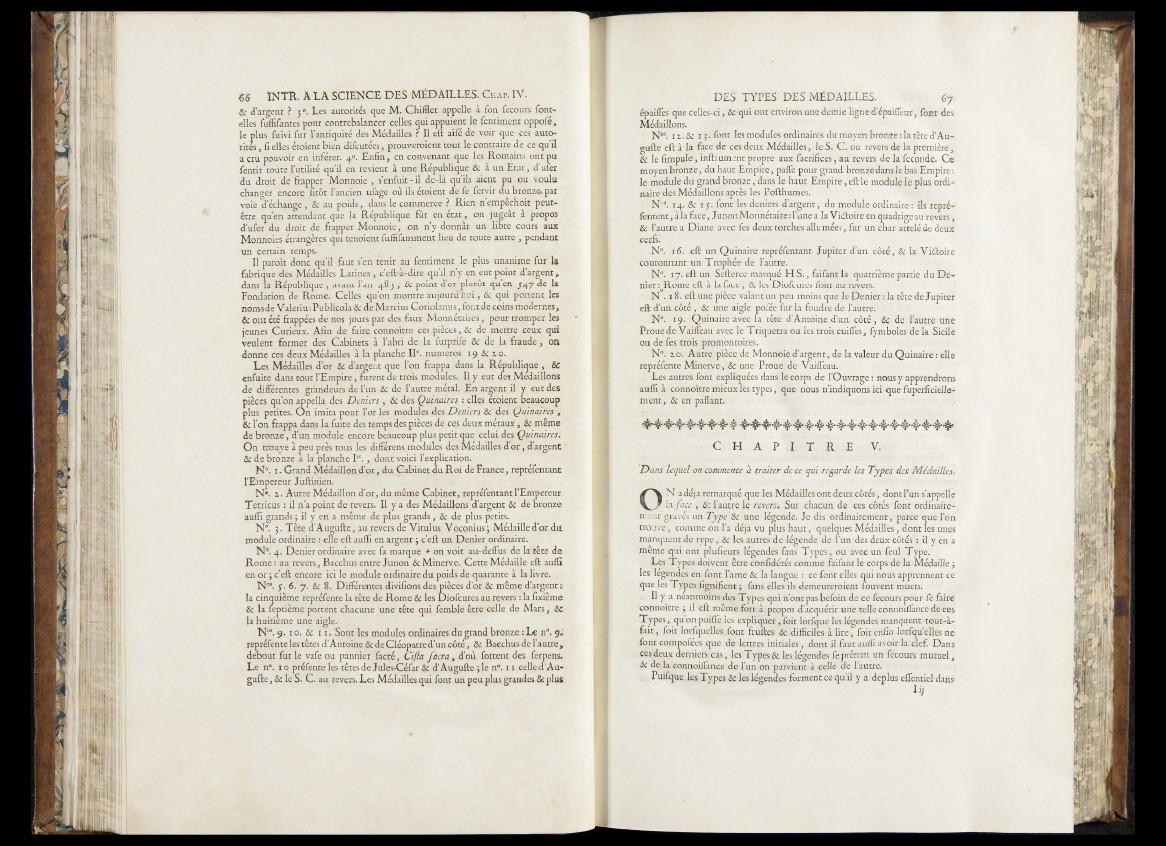
Sc d argent ? 30, Les autorités que M. Chifflet appelle à fon fecours font-
elles fuffifantes pour contrebalancer celles qui appuient le fentiment oppofé,
le plus fuivi fur l’antiquité des Médailles ? Il eft aifé de voir que ces autorites,
fi elles étoient bien difcutées, prouveroient tout le contraire de ce qu’il
a cru pouvoir en inférer. 4°. Enfin, en convenant que les Romains ont pu
fentir toute l’utilité qu’il en revient à une République & à un É tat, d’ufer
du droit de frapper Monnoie , s’enfuit-il de-là qu’ils aient pu ou voulu
changer encore lîtôt l’ancien ufage où ils étoient de fe fervir du bronza par
voie d’échange, & au poids, dans le commerce ? Rien n empechoit peut-
être qu’en attendant que la République fut en état, on jugeât a propos
d’ufer du droit de frapper Monnoie, on n’y donnât un libre cours aux
Monnoies étrangères qui tenoient fuffifamment lieu de toute autre , pendant
un certain temps.
Il paraît donc qu’il faut s’en tenir au fentiment le plus unanime fur la
fabrique des Médailles Latines, c’eft-à-dire qu’il n’y en eut point d’argent »
dans la République, avant l ’an 48 y , & point dor plutôt quen J 47
Fondation de Rome. Celles qu’on montre aujourd’h u i, & qui portent les
noms de Valerius Publicola & de Marcius Coriolanus, font de coins modernes,
& ont été frappées de nos jours par des faux Monnétaires, pour tromper les
jeunes Curieux. Afin de faire connoître ces pièces, & de mettre ceux qui
veulent former des Cabinets à l’abri de la furprife & de la fraude, on
donne ces deux Médailles à la planche IIe. numéros 19 S c zo .
Les Médailles d’or & d’argent que l’on frappa dans la République, Sc
enfuite dans tout l’Empire, furent de trois modules. Il y eut des Médaillons
de différentes grandeurs de l’un S c de l’autre métal. En argent il y eut des
pièces qu’on appella des Deniers , & des Quinaires : elles etoient beaucoup
plus petites. O n imita pour l’or les modules des Deniers Sc des Quinaires ,
& l’on frappa dans la fuite des temps des pièces de ces deux métaux, S c même
de bronze, d’un module encore beaucoup plus petit que celui des Quinaires.
O n trouve à peu près tous les différens modules des Médailles d’or , d’argent
Si de bronze a la planche Irc. , dont voici l’explication.
N°. i . Grand Médaillon d’o r , du Cabinet du Ro i de France, repréfentant
l’E'mpereur Juftinien.
N», z. Autre Médaillon d’o r, du même Cabinet, repréfentant l’Empereur
Tetricus : il n’a point de revers. Il y a des Médaillons d’argent & de bronze
auffi grands ; il y en a même de plus grands, & de plus petits.
N°. 3. Tête d’Augufte, au revers de Vitulus Voconius3 Médaille d’or du
module ordinaire : elle eft auffi en argent 3 c’eft un Denier ordinaire.
N°. 4. Denier ordinaire avec fa marque * on voit au-deffiis de la tete de
Rome : au revers, Bacchus entre Junon S c Minerve. Cette Médaille eft auffi
en or 3 c’eft encore ici le module ordinaire du poids de quarante à la livre,
N°*. y. 6. 7. & 8. Différentes divifions des pièces d’or & même d’argent:
la cinquième repréfente la tête de Rome S c les Diofcures au revers : la fixième
S c la feptième portent chacune une tête qui femble être celle de Mars, &
la huitième une aigle.
N°‘. 9. 1 o. & n . Sont les modules ordinaires du grand bronze : Le n°. 9.
repréfente les têtes d’Antoine Sc de Cléopâtre d’un côté, S c Bacchus de l’autre,
debout fur le vafe ou pannier facré, Cifia facra, d’où fortent des ferpens.
L e n°. 10 préfente les têtes de Jules-Céfar S c d’Augufte 5 le n°. 11 celle d’Au-
gufte, S c le S. C . au revers. Les Médailles qui font un peu plus grandes & plus
épailfes que celles-ci, S c qui ont environ une demie ligne d’épaiffeur, font des
Médaillons.
N os. 1 z . & 13- font les modules ordinaires du moyen bronze : la tête d’A u gufte
eft à la face de ces deux Médailles, le S. C . ou revets de la première,
& le fimpule, inftiument propre aux facrifices, au revers de la fécondé. Ce
moyen bronze, du haut Empire, paffe pour grand bronzé dans le bas Empire:
le module du grand bronze, dans le haut Empire, eft le module le plus ordinaire
des Médaillons après les Pofthumes.
N os. 14. & 1 y. font les deniers d’argent, du module ordinaire : ils repré-'
fentent, âla face, Junon Monnetaire: l’une a la Victoire en quadrige au revers,
& l’autre a Diane avec fes deux torches allumées, fur un char attelé de deux
cerfs.
N°. 1 6. eft un Quinaire repréfentant Jupiter d’un côté, & la Victoire
couronnant un Trophée de l’autre.
N°. 17. eft un Sefterce marqué H S . , faifant la quatrième partie du D e nier
: Rome eft à la face , S c les Diofcures. font au revers.
N . 18. eft une pièce valant un peu moins que le Denier : la tête de Jupiter
eft d’un côte, & une aigle pofée fur la foudre de l’autre.
N°. 19- Quinaire avec la tête d’Antoine d’un cô té, S c de l ’autre une
Proue de Yaiffeau avec le Triquetra ou les trois cuiflès, fymboles de la Sicile
ou de fes, trois promontoires. :
N°. zo . Autre pièce de Monnoie d’argent, de la valeur du Quinaire : elle
repréfente Minerve, S c une Proue de Vaiffeau.
Les autres font expliquées dans le corps de l’Ouvrage : nous y apprendrons
auffi à connoître mieux les types, que nous n’indiquons ici que fuperficielle-
ment, & en paflant.
C H A P I T R E V.
Dans lequel on commence a traiter de ce qui regarde les Types des Médailles,
ON a déjà remarqué que les Médailles ont deux côtés, dont l’un s’appelle
la face , & l’autre le revers. Sur chacun de ces côtés font ordinairement
graves un Type S c une légende. Je dis ordinairement, parce que l’on
trouve, comme on l’a déjà vu plus haut, quelques Médailles, dont les unes
manquent de type, & les autres de légende de l’un des deux côtés : il y en a
meme qui ont plufieurs légendes fans Types, ou avec un feul Type.
Les Types doivent être confidérés comme faifant le corps de la Médaille 3
les légendes en font l’ame & la langue : ce font elles qui nous apprennent ce
que les Types lignifient 3 fans elles ils demeureraient fouvent muets;
- Il y a neanmoins des Types qui n’ont pas befoin de ce fecours pour fe faire
connoître 3 il eft même fort â propos d’acquérir une telle connoilîànce de ces
T yp e s , qu on puilfe les expliquer, foit lorfque les légendes manquent tout-à-
fait, foit lorfquelles font fruftes & difficiles à lire, foit enfin lorfqu’elles ne
font compofées que de lettres initiales, dont il faut auffi avoir la clef. Dans-'
ces deux dernierscàs, les Types & les légendes fe. prêtent un fecours mutuel,
&C de la connoiffance de l’un on parvient â celle de l’autre;
Puifque les Types S c les légendes forment ce qu’il y a déplus elfentiel dans 1