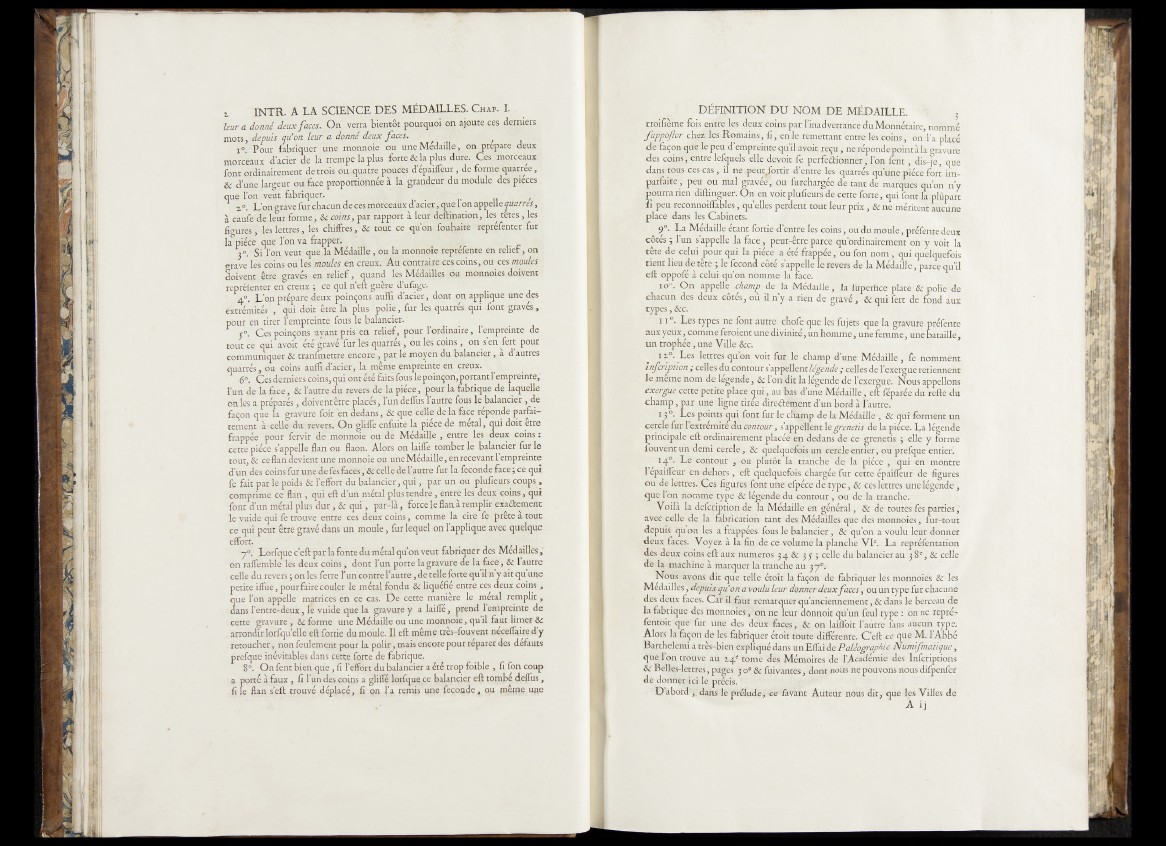
leur a donné deux faces. O n verra bientôt pourquoi on ajoute ces derniers
mots, depuis qu’on leur a donné deux faces. _ , '
i°. Pour fabriquer une monnoie ou une Médaille, on préparé deux
morceaux d’acier de la trempe la plus forte & la plus dure. Ces morceaux
font ordinairement de trois ou quatre pouces d’épaiffeur, de forme quarrée,
& d’une largeur ou face proportionnée à la grandeur du module des pièces
que l’on veut fabriquer. j ,
z °. L ’on grave fur chacun de ces morceaux d’acier, que l’on appelle quarrés,
à caufe de leur forme, & coins, par rapport à leur deftination, les tetes, les
fio-ures, les lettres, les chiffres, & tout ce qu’on fouhaite repréfenter fur
la pièce que Ion va frapper. ^
3°. Si l’on veut que la Médaille, ou la monnoie repréfente en relief, on
orave les coins ou les moules en creux. A u contraire ces coins, ou ces moules
Soivent être gravés en relief, quand les Médailles ou monnoies doivent
repréfenter en creux ; ce qui n’eft guère d’ufage. _
4°. L ’on prépare deux poinçons auïfi d’acier, dont on applique une des
extrémités , qui doit être la plus polie, fur les quarrés. qui font gravés.,
pour en tirer l’empreinte fous le balancier.
r j° . Ces poinçons -ayant pris en relief, pour l’ordinaire, l’empreinte de
tout ce qui avoit été gravé fur les quarrés , ou les coins, on s en fert pour
communiquer & tranfmettre encore , par le moyen du balancier, a d autres
quarrés, ou coins auffi d’acier, la même empreinte en creux.
6°. Ces derniers coins, qui ont été faits fous le poinçon, portant 1 empreinte,
l’un de la face, & l'autre du revers de la pièce, pour la fabrique de laquelle
on les a préparés , doivent être placés, 1 un deffus 1 autre fous le balancier , de
façon que la gravure foit en dedans, & que celle de la face réponde parfaitement
à celle du revers. O n gliffe enfuite la piece de métal, qui doit etre
frappée pour fervir de monnoie ou de Médaille , entre les deux coins :
cette pièce s’appelle flan ou flaon. Alors on lailfe tomber le balancier fur le
tout, & ce flan devient une monnoie ou une Médaille, enrecevant 1 empreinte
d’un des coins fur une de fes faces, & celle de 1 autre fur la fécondé face ; ce qui
fe fait par le poids & l’effort du balancier, q u i, par un ou plufieurs coups,
comprime ce flan , qui eft d’un métal plus tendre, entre les deux coins, qui
font d’un métal plus dur , & q u i, par-là, force le flan à remplir exa&ement
le vuide qui fe trouve entre ces deux coins, comme la cire fe prête à tout
ce qui peut être gravé dans un moule, fur lequel on 1 applique avec quelque
effort.
7°. Lorfque c’eft par la fonte du métal qu’on veut fabriquer des Médailles,'
on raffemble les deux coins, dont l’un porte la gravure de la face, & 1 autre
celle du revers ; on les ferre l’un contre l’autre, de telle forte qu il n y ait qu une
petite iffue, pour faire couler le métal fondu & liquéfié entre ces deux coins ,
que l’on appelle matrices en ce cas. D e cette manière le métal remplit,
dans l’entre-deux, le vuide que la gravure y a laiffé, prend 1 empreinte de
cette gravure, & forme une Médaille ou une monnoie, quil faut limer &
arrondir lorfqu’elle eft fortie du moule. Il eft même très-fouvent neceffaire d y
retoucher, non feulement pour la polir, mais encore pour réparer des defauts
prefque inévitables dans cette forte de fabrique.
8°. O n fent bien que, fi l’effort du balancier a été trop foible , fi fon coup
a porté à faux , fi l’un des coins a gliffé lorfque ce balancier eft tombé deffus,
fi le flan s’eft trouvé déplacé, fi on l’a remis une feçoqde, ou urêpie une
troifième fois entre les deux coins par l’inadvertance du Monnétaire, nommé
fuppoftor chez les Romains, fi, en le remettant entre les coins, on’ l’a placé
de façon que le peu d empreinte qu il avoit reçu, ne répondepoint à la gravure
des coins, entre lefquels elle devoir fe perfectionner, l’on fe n t , dis-je, que
dans tous ces cas, il ne .peuqfortir d’entre les quarrés qu’une pièce fort imparfaite,
peu ou mal gravée, ou furchargée de tant de marques qu’on n’y
pourra rien diftinguer. O n en voit plufieurs de cette forte, qui font la plupart
fi peu reconnoiffables, quelles perdent tout leur prix, & ne méritent aucune
place dans les Cabinets.
9°. La Médaillé étant fortie d’entre les coins, ou du moule, préfente deux
côtés ; l’un s’appelle la face, peut-être parce qu’ordinairement on y voit la
tête de celui pour qui la pièce a été frappée, ou fon nom, qui quelquefois
tient lieu de tête ; le fécond côté s’appelle le revers de la Médaille, parce qu’il
eft oppofe a celui qu’on nomme la face.
io°. O n appelle champ de la Médaille, la fuperfice plate & polie de
chacun des deux côtés, où il n’y a rien de gravé, & qui fert de fond aux
types, &c.
1 1°- Les types ne font autre chofe que les fujets que la gravure préfente
auxyeux, comme feroient une divinité, un homme, une femme, une bataille,
un trophée, une V ille &c.
i z°. Les lettres qu on voit fur le champ d une Médaille, fe nomment
infcription celles du contour s appellent légende • celles de l’exergue retiennent
le meme nom de legende, & 1 on dit la légende de l’exergue. Nous appelions
exergue cette petite place qui, au bas dune Médaille, eft féparée du refte du
champ, par une ligne tiree directement d’un bord à l’autre.
i 3 Les points qui font fur le champ de la Médaille , & qui forment un
cercle fur 1 extrémité du contour, s’appellent le grenetis de la piece. La légende
principale eft ordinairement placée en dedans de ce grenetis ; elle y forme
fouventun demi cercle, & quelquefois un cercle entier, ou prefque entier!
140. L e contour , ou plutôt la tranche de la pièce , qui en montre
1 épaiffeur en dehors , eft quelquefois chargée fur cette épaiffeur de figures
ou de lettres. Ces figures font une efpéce de type, & ces lettres une légende,
que 1 on nomme type & légende du contour , ou de la tranche. 1
Voila la defcription de la Médaille en général, & de toutes fes parties ,
avec celle de la fabrication tant des Médailles que des monnoies, fur-tout
depuis qu on les a frappées fous le balancier, & qu’on a voulu leur donner
deux faces. Voyez à la fin de ce volume la planche V I S. La repréfentation
des deux coins eft aux numéros 34 & 3 y ; celle du balancier au 3 8 e, & celle
de la machine à marquer la tranche au 3 7 e.
Nous avons dit que telle étoit la façon de fabriquer les monnoies & les
Médaillés, depuis qu’on a voulu leur donner deux faces, ou un type fur chacune
des deux faces. Car il faut remarquer qu’anciennement, & dans le berceau de
la fabrique des monnoies, on ne leur dônnoit qu’un feul type : on ne repré-
fentoit que fur une des deux faces, & on laifloit l’autre fans aucun type.
Alors la façon de les fabriquer étoit toute différente. C ’eft ce que M. l’Abbé
Barthelemi a très-bien expliqué dans un Effai de Paléographie Numifmatique,
que l’on trouve au 1 4 ' tome des Mémoires de l ’Académie des Infçriptions
& Belles-lettres, pages 3 oe & fuivantes, dont nous ne pouvons nous difpenfer
de dorïner ici le précis.
D abord, dans le prélude, ce favant Auteur nous dit, que les Villes de
A ij