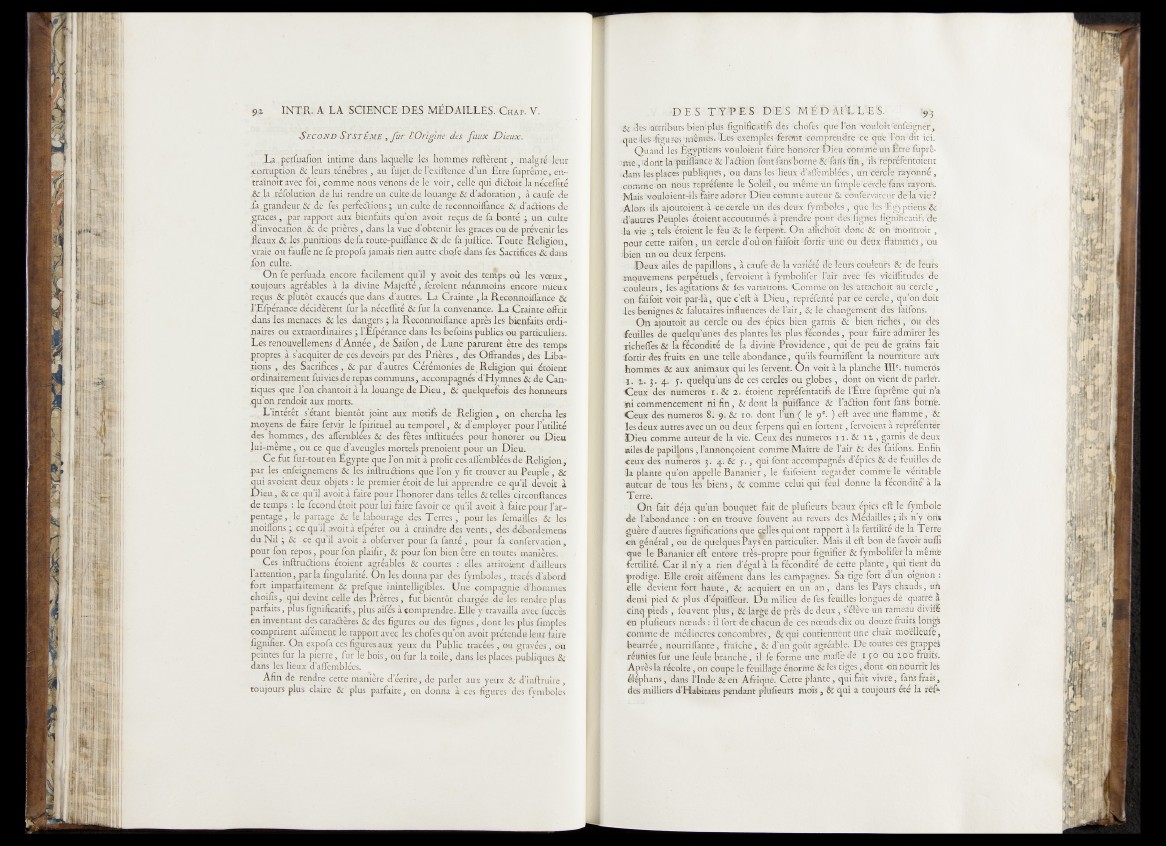
S econd S ystème , fur l'Origine des faux Dieux.
.La . perfuafion intime dans laquelle les nommes relièrent, malgré leur
.corruption & leurs.tenebres , au füjet.de l’exiftençe.d’un Être fuprême, entraînent
avec fo i, comme nous venons de le voir, celle qui diétoit la nécefiïté
3c la refolution de lui rendre un culte de louange & d’adoration, à caufe de
Ja.grandeur,& de fes perfections; un culte de reconnoiflance & d’actions de
grâces, par rapport aux bienfaits qu’on avoit reçus de fa bonté ; un culte
d’invocation ,& de prières , dans la vue d’obtenir les grâces ou de prévenir‘les
fléaux &c les .punitions de fa toute-puilfance & .de fa juftice. Toute Religion,
vraie ou faufle ne fe propofa jamais rien autre cliQfe dans fes Sacrifices & dans
ion culte.
O n fe perfuada encore facilement qu’il y avoit des temps où les voeux,
.toujours agréables à la divine Majefté, feraient néanmoins encore mieux
reçus & plutôt exaucés que dans d’autres. La Crainte, la Reconnoiflance &
2’Efpérance décidèrent fur la néceflité & fu r la convenance. La Crainte offrit
dans les menaces & les dangers ; la Reconnoiflance après les bienfaits ordinaires
ou extraordinaires ; l’Ëfpérance dans les befoins publics ou particuliers.
Les renouvellemens d’Année, de Saifon, de Lune parurent être des temps
propres a s’acquiter d.e ces devoirs par des Prières, des Offrandes, des Libations
, des Sacrifices, & par d’autres Cérémonies de Religion qui étoient
ordinairement fuiviesde repas communs, .accompagnés d’Hymncs ,&c de Cantiques
que l’on chantoit à la louange de D ie u , & quelquefois des honneurs
qu’on rendoit aux morts.
L ’interet s’étant bientôt joint aux motifs de R e lig ion , on chercha les
moyens de faire fetvir le fiùrituel au temporel, & d’employer pour l’utilité
des hommes, des aflemblees & des fêtes inftituées pour honorer ou Dieu
lui-meme, ou ce que d’aveugles mortels prenoient pour un Dieu.
C e fut fur-tout en Égypte que l’on mit à profit ces aflemblées de Religion,
par les enfeignemens &c les inftruétions que l’on y fit trouver au Peuple , &
qui avoient deux objets : le premier étoit de lui apprendre - ce qu’il deyoit à
D ie u , & ce qu’il avoit à faire pour l’honorer dans telles ôc telles circonftances
de temps : le fécond étoit pour lui faire favoir ce qu’il avoit à faire pour l’arpentage,
le partage & le labourage des Terres, pour les femailles & les
moiflons ; ce qu il avait a efpérer ou à craindre des vents, des débordemens
du Nil ; & ce qu il avoit à obferver pour fa fanté , pour fa confervation,
pour fon repos, pour fon plaifir, & pour fon bien être en toutes manières.
Ces inflruétions étoient agréables & courtes : elles attiraient d’ailleurs
l’attention, parla Angularité. O n les donna par des fymboles, tracés d’abord
fort imparfaitement & prefque inintelligibles. Une compagnie d’hommes
choifis, qui devint celle des Prêtres , fut bientôt chargée de les rendre plus
parfaits, plus fignificatifs, plus aifés à comprendre. Elle y travailla avec fuccès
en inventant des caractères & des figures ou des lignes, dont les pliis fimples
comprirent aifement le rapport avec les chofes qu’on avoit prétendu leur faire
lignifier. O n expofa ces figures aux yeux du Public tracées, ou gravées , ou
peintes fur la pierre, fur le bois, ou fur la toile, dans les places publiques &c
dans les lieux d’aflemblées.
Afin de rendre cette manière d’écrire, de parler aux yeux & d’inftruire,
toujours plus claire &c plus parfaite, on donna à ces figures des fymboles
& des attributs bien-plus fignificatifs des -chofes que Ton voulokënfeigner,
que dés figures'niâmes. 'Les‘exemples-feront 'comprendre -ce què l’on dit ici.
Quand les Égyptiens voulbiërit faire horiorer-Dieu cômrriè-uh Etre fuprême.,
dont la puiffancé te l'aéfci'o'n font-fanshorne & Taris f in , ils 'rëpréfèntoient
dans les places publiques, ’ou dans les dieux d’aflemblées, ûmcërclë rayonné ,
comme on nous repréfente lé Soleil, ou même un fimple‘cerclefans rayons.
Mais vouloient-ils-rait-e adôret Dieu-comme auteur & cônfervStéur delà vie?
-Alors ils ajbutoie'rft-a-ee'eercle un dés deux fymboles, què des Egyptiens &
d’autres Peuples étoient accoutumés à prendre pour-dès -lignes fignificatifs de
-la vie -tels étoient le feu & le ferpèrit. O n affichait 'donc «fie bft mOntroit,
pour cette raifon, un cercle d’oùbri-’faifoit fbrrir uiie ou deux flammes., ou
bien un ou deux ferpens.
Deux ailes de papillons, à càulèdë la variété dè -leurs couleurs -fie dè leurs
mouvemens perpétuels, fervbient à fymbolifer flair avise fës vicilfitudês de
couleurs, fës agitations fie fes variations. Comme on lés •Uttachoit au'cercle ,
-on faifoit voir par-là, qüë c’eft à D ieu , repréferité par ce cercle, q'u’on doit
les bénignes fie falutaires influences dëTaïr, & le changement dès fiiifons.
On ajourait au cërcle ou des épies -bien garnis & bien richës, ou dès
feuilles de quelqu’nn'es des plantés lé$ plus fécondes, pour faire admirèr lès
lichefles fic la fécondité dfe la divinfe Providence, qui de péu dé grains fait
■ fortir des fruits en une telle abondance, qu’ils fourniflent la nourriture 'auh
hommes & aux animaux qui les fervent. O n voit à la planche IIIe. humerds
x. i . 3. 4. y. quelqu’uns de ces cercles ou globes, dont on vient de parldr.
C eu x des numéros i .& 2. étoient repréfentatifs de l’Être fuprê'mfe qui n'a
ïii commencement ni fin, & dont la puiflancë & l’aétfon font fàht borné.
C eu x des numéros 8. 9. & 10. dont l’un ( lte f . ) éft avec une flammé, &
les deux autres avec un ou deux ferpens qui en fortent, fervoient a reprefenter
D ieu comme auteur de la vie. Ceux des numéros 1 1 . & 1 z , garnis de deux
ailés de papillons, l’annonçoient comme Maîtrè de l’air & des faifons. Enfin
ceux des numéros 3. 4 . & y . , qui font accompagnés d épies & de feuilles de
la plafite qu’on appelle Bananier, lé faifoiéht regarder comme lë véritable
auteur de tous les biens, &c comme Celui qui féul donne la fécondité a la
Terre.
O n fait déjà qu’un bouquet fait de plufieurs beau* épies eft lë fymbole
dé l’abôndartce : on ën trouve fduvëht au revers des Médaillés ; ils n y bris
guère d’autrês fignifications que celles qui ont rapport à la fertilité de la Terre
en général, ou de quelques Pays en particulier. Mais il eft bon dê favoir auffi
que le Bananier eft entore très-propre pout lignifier & fymbolifer la meriib
fertilité. Car il n’y a rien d’égal a la fécondité de cette plante, qui rient dfi
prodige. Elle croît aifément dans les campagnes. Sa tige fbrt d un oignon :
elle devient fort haute, &c acquiert en un an, dans lés Pays chauds, ufi
demi pied & plus d’épaifleuf. D u milieu de fes feuillès Ibngués dé quatrê à
Cinq pieds, fbuverit plus, & large de près de deux , s’élève un rameau divife
Cri plufieurs noeuds : il fbrt dé chacun de ces noeuds dix ou douze fruits longi
Comme de médiocres concombres, & qui contiennent une chair.riaoëlleufè,
heurtée, nourriflante, fraîche, & d’un goût agréable. De toutes tés grappèi
réunies fur une feule branche, il fe forme une maflè de iy o bu zo o frùits.
Après la récolte, on Coupe le feuillage ériormè & lès tiges, dont cri nourrit lès
éléphans, dans l’Inde & en Afrique. Cette plante, qui fait vivrè, fans frais,
des milliers d’Habitans pendant plufieurs mois, & qui a toujours été la réf