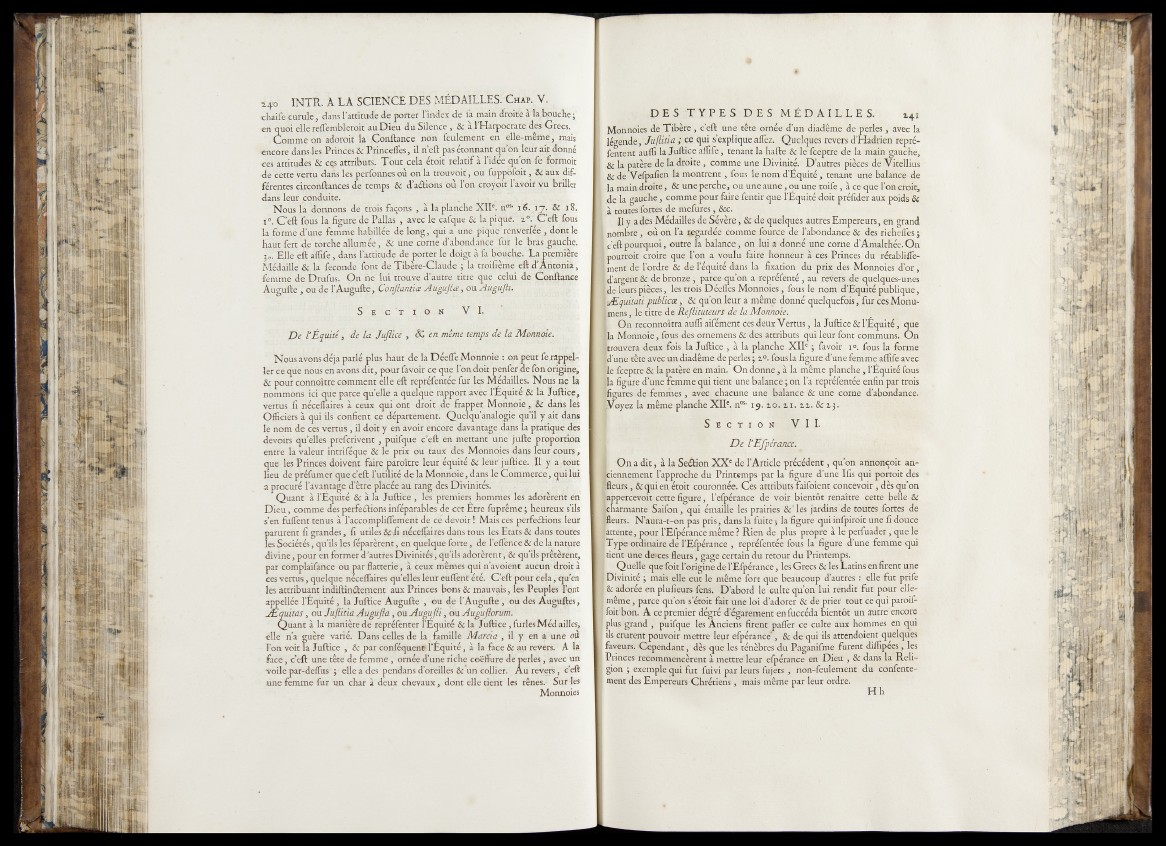
chaife curiale dans l'attitude de porter l’index de la main droite à la bouche ;
en quoi elle reflembleroit au Dieu du Silence , & à l ’Harpocrate des Grecs.
Comme on adoroit la Conftance non feulement en elle-même, mais
encore dansles Princes & PrincefTes, il n’eft pas étonnant qu’on leur ait donné
ces attitudes & cçs attributs. T o u t cela étoit relatif à l’idee qu’on fe formoit
■ de cette vertu dans les perfonnes où on la trouvoit, ou fuppôfoit, & aux différentes
circonftances de temps Sc d’aétions ou Ion croyoit lavoir vu briller
dans leur conduite.
Nous la donnons de trois façons , à la planche X I Ie. nos' 16. iy . & 18.
i° . C ’eft fous la figure de Pallas , avec le cafque & la pique. z°. C ’eft fous
la forme d’une femme habillée de long, qui a une pique rënÿerfée , dont le
haut fert de torche allumée, & une corne d’abondance fur le bras gauche.
30' Elle eft aflife, dans l’attitude de porter le doigt à fa bouche. La première
Médaille & la fécondé font de Tibère-Claude ; la troifième eft d’Ântonia,
femme de Drufus. O n ne lui trouve d’autre titre que celui de Conftance
Augufte , ou de l’A ugufte, Confiantioe Augujloe, ou Augufti.
S e c t i o n V I .
D e l’Équité, de la Juftice , êC en même temps de la Monnaie.
Nous avons déjà parlé plus haut de la DéelTe Monnoie : on peut fe râppel-
ler ce que nous en avons dit, pour favoir ce que l’on doit penferde fon origine»
& pour connoître comment elle eft repréfentée fur les Médailles. Nous ne la
nommons ici que parce quelle a quelque rapport avec l’Équité & la Juftice,
vertus fi néceffaires à ceux qui ont droit de frapper Monnoie, & dans les
Officiers à qui ils confient ce département. Quelqu’analqgie qu’il y ait dans
le nom de ces vertus, il doit y en avoir encore davantage dans la pratique des
devoirs quelles prefcrivent , puifque c ’eft en mettant une jufte proportion
entre la valeur intriféque & le prix ou taux dès Monnoies dans leur cours >
que les Princes doivent faire paraître leur équité & leur juftice. Il y a tout
lieu de préfumer que c’eft l’utilité de la Monnoie, dans le Commerce, qui lui
a procuré l’avantage d’être placée au rang des Divinités. .
Quant à l’Équité & à la Juftice, les premiers hommes les adorèrent en
D ie u , comme des perfections inféparables de cet Être fuprême ; heureux s’ils
s’en fuffent tenus à l’accomplifTement de ce devoir ! Mais ces perfections leur
parurent fi grandes, fi utiles & J1 néceffaires dans tous les Etats & dans toutes
les Sociétés, qu’ils les féparèrent, en quelque forte, de l’effence & de la nature
divine, pour en former d ’autres Divinités, qu’ils adorèrent, & qu’ils prêtèrent,
par complaifance ou par flatterie, à ceux mêmes qui n’avoient aucun droit à
ces vertus, quelque néceffaires qu’elles leur euffienf été. C ’eft pour cela, qu’en
les attribuant indiftindlement aux Princes bons & mauvais, les Peuples l ’ont
appellée l’Équité , la Juftice Augufte , ou de l’Augufte , ou des Auguftes,
J E quittas, ou Jufiitia A u gu f i a , ou Aupufli, ou Auguflorum.
Quant à la manière de repréfenter l’Équité & la Juftice, furies Médailles,
elle n’a guère varié. Dans celles de la famille Marcia , il y en a une ou
l’on voit la Juftice , & par conféquenc l’Équité, à la face & au revers. A 1*
fa c e , c ’eft une tête de femme, ornee d’une riche coëffure de perles, avec un
Toile par-deffus ; elle a des pendans d’oreilles St un collier. A u revers, c’eft
une femme fur un char à deux chevaux, dont elle tient les rênes. Sur les
Monnoies
D E S T Y P E S D E S M É D A I L L E S . 141
Monnoies de T ib è re , c’eft une tête ornée d’un diadème de perles , avec la
légende, Jufiitia ; ce qui s’explique affez. Quelques revers d’Hadrien repré-
fentent auffi la Juftice affife, tenant la hafte & le fceptre de la main gauche,
& la patère de la droite, comme une Divinité. D ’autres pièces de Vitellius
& de Vefpafien la montrent , fous le nom d’Équité, tenant une balance de
la main droite, St une perche, ou une aune, ou une toife , à ce que l’on croit,
de la gauche, comme pour faire fentir que l’Équité doit préfider aux poids Si
à toutes fortes de mefures, &c.
Il y a des Médailles de Sévère, & de quelques autres Empereurs, en grand
nombre , où on l’a regardée comme fource de l’abondance & des richeffes ;
c’eft pourquoi, outre la balance, on lui a donné une corne d’Amalthée. O n
| pourrait croire que l ’on a voulu faire honneur à ces Princes du rétabliffe-
[ment de l’ordre St de l’équité dans la fixation du prix des Monnoies d’o r ,
[ d’argent & de bronze, parce qu’on a repréfenté, au revers de quelques-unes
[de leurs pièces, les trois Déeffes Monnoies, fous le nom d’Équité publique,
|iÆquitati publicoe, & qu’on leur a meme donné quelquefois, fur cesMonu-
Imens, le titre de Reftituteurs de la Monnoie.
I On reconnoîtra auffi aifément ces deux Vertus, la Juftice St l’Équité, que
lia Monnoie, fous des orneinens St des attributs qui leur font communs. On
Strouvera deux fois la Juftice , à la planche X I Ie ; favoir 1°. fous la forme
fd’une tête avec un diadème de perles ; z°. fous la figure d’une femme affife avec
fie fceptre & la patère en main. O n donne, à la même planche, l’Équité fous
fia figure d’une femme qui tient une balance ; on l’a reprefentée enfin par trois
ffigures de femmes, avec chacune une balance & une corne d’abondance.
■ Voyez la même planche X I Ie. nos- 19. zo . z i . z z . & 13.
S e c t i o n V I I .
D e l’Efpérance.
I O n a d it, à la Seétion X X e de l’Article précédent, qu’on annonçoit an-
Iciennement l’approche du Printemps-par la figure d’une Ifis qui portoit des
fleurs, & qui en étoit couronnée. Ces attributs faifoient concevoir , des qu’on
iappercevoit cette figure, l’efpérance de voir bientôt renaître cette belle &
Jcharmante Saifon, qui émaillé les prairies & ’ les jardins de toutes fortes de
fleurs. N ’aura-t-on pas pris, dans la fuite 5 la figure qui infpiroit une fi douce
[attente, pour l’Efpérance même ? Rien de plus propre à le perfuader, que le
jType ordinaire de l’Efpérance , repréfentée fous la figure d’une femme qui
[tient une de*ces fleurs, gage certain du retour du Printemps,
ï Quelle que foit l’origine de l’Efpérance, les Grecs & les Latins en firent une
Divinité 3 mais elle eut le même fort que beaucoup d’autres : elle fut prife
| S t adorée en plufieurs fens. D ’abord le culte qu’on lui rendit fut pour elle-
| même, parce qu’on s’étoit fait une loi d’adorer S i de prier tout ce qui paroif-
foit bon. A ce premier dégré d’égarement enfuccéda bientôt un autre encore
plus grand, puifque les Anciens firent pafTer ce culte aux hommes en qui
ils crurent pouvoir mettre leur efpérance*, S t de qui ils attendoient quelques
faveurs. Cependant, dès que les ténèbres du Paganifme furent diffipees , les
Princes recommencèrent à mettre leur efpérance en Dieu , & dans la Religion
; exemple qui fut fuivi par leurs fujets , non-feulement du confente-
ment des Empereurs Chrétiens, mais même par leur ordre.
H h