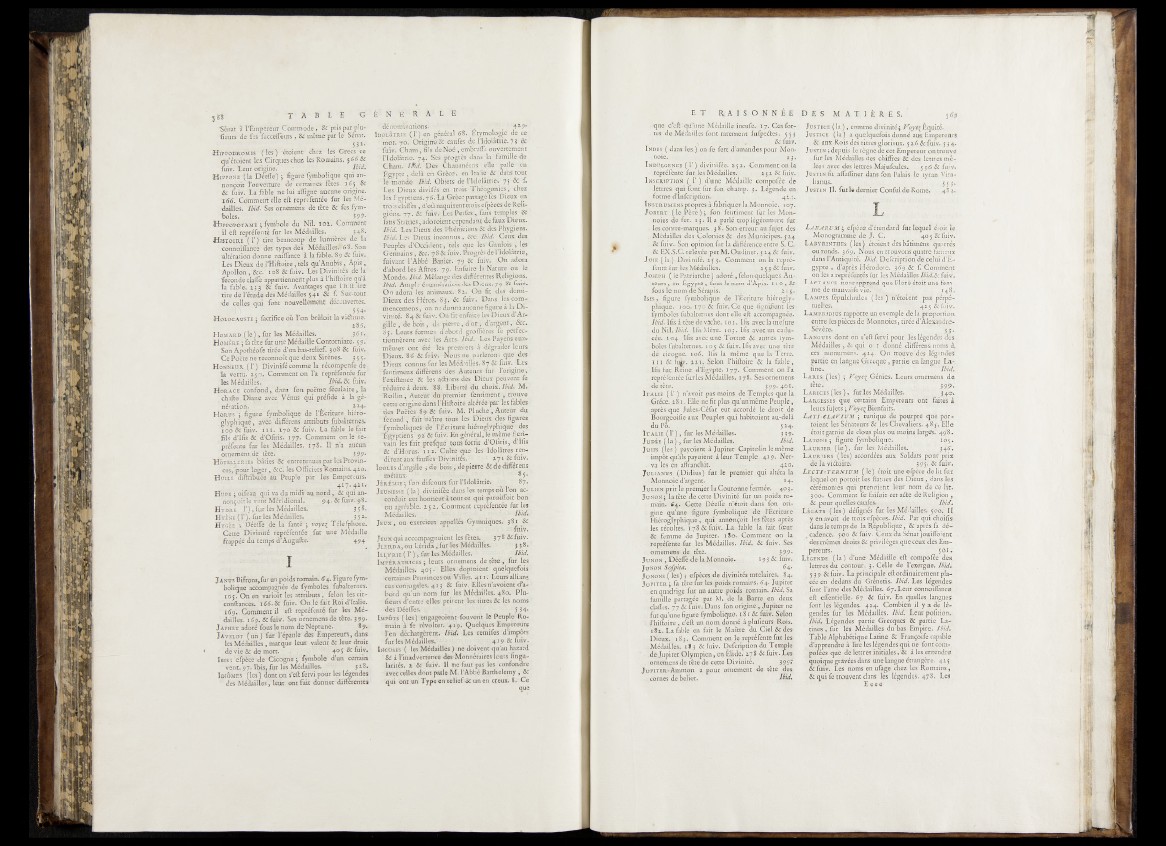
’Sénat à l'Empereur Commode , 8c pris par plusieurs
de Iss fuccéffeurs , & même par le Sénat.
551*
H iïpo ürom es '( les1) -étoient chez les Grecs ce
qu étoient ies Cirques chez les Romains. $66 8c
fuiv. Leur origine. 1 Ibid ,
HippoNe % la Déeffe) ; figure fymbolique qui an-
nonçoit l’ouverture de certaines fêtes. 165 &
& fuiv. La fable, ne lui aÏÏigne aucune origine.
1 6 6 . Comment elle eft reprc-fentée fur les Médaillés.
Ibid. Ses ornemens de tète & fes fym-
boles. 3 99*
H ip po to ïàm è j fymbole du Nil. 101. Comment
il eft repréfenté fur les Médailles. 348*
H isto ir e ( 1’ ) tire beaucoup de lumières de la
connoiffanue des types des Médailles.* 68. Son
■ altération donne naiffimce à la fable. 89 ôc iuiv.
Les Dieux de l’Hiftoire, tels qu’Anubis 3 Apis ,
Apollon , 8cc. 108 & fuiv. Les Divinités de la
fécondé claffè appartiennent plus à l’hiftoire qu’à
la fable. 2.5 3 8c fuiv. Avantages que l’h.ftjire
tire de l’étude des Médailles 541 8c f* Sur-tout
de celles qui font nouvellement découvertes.
L . 5 54-
H olocauste i facrifice où l ’on brûloit la vnftime.
286.
H omar d ( le ) , fur les Médailles. : J 61*
H omère j fa tête fur une Médaille Contorniate. 5 9.
Son Apothéofe tirée d’un bas-relief. 308 8c fuiv.
Ce Poëte ne reconnoît que deux Sirènes. 355.
H onneur ( 1\) Divinifé comme la récompenfe de
la vertu. 250. Comment on l’a repréfentée fur
les Médailles. Ib id . 8c fuiv.
H o rac e confond, dans fon poëroe féculaire, la
chiffe Diane avec Vénus qui préfide à la gé-
H orus j figure fymbolique de l’Écriture hiéro-
alyphique, avec différens attributs fubalternes.
îo o & fuiv. n i . 170 8c fuiv. La fable le fait
fils d’Ifis 8c d’Ofiris. 177. Comment, on le repréfente
fur les Médailles. 178. Il n’a aucun
omement.de tête. . . . 399'
H ôtelleries bâties & entretenues par les Provinces,
pour loger ,.&c. les Officiers Romains. 420.
H uile diftribuée au Peuple par les Empereurs.
4 I7* 4- 1 •
H upe ; oifeau qui va du midi au nord, & qui annoncent
le vent Méridional. 94. & fuiv. 98.
Hydre 1’) , fur les Médailles. 3 5 8.
Hyène (TV fur les Médailles. ( 352-
H ygée j Déeffe de la fanté ■ voye{ Télefphore.
Cette Divinité repréfentée fur une Médaille
frappée du temps d’Augufte. 494
I
J a nus Bifrons,fur un poids romain. 6 4. Figure fymbolique
accompagnée de fymboles fubalternes.
105. On en varioit les attributs , félon les cir-
conftances. 166. & fuiv. On le fait Roi d’Italie.
1 6 9 . Comment il eft repréfenté fur les Médailles.
16 9 . & fuiv. Ses ornemens de tète. 3 99.
J aphet adoré fous le nom de Neptunè. 8 9.
J a v elo t (un) fur l’épaule des Empereurs, dans
les Médailles, marque leur valeur 8c leur droit
de vie & de mort. . 40 J & fuiv.
I bis ; efpèce de Cicogne ; fymbole d’un certain
vent. 97. Ibis, fur les Médailles. 328.
Idiomes (les) dont on s’eft fervi pour les légendes
' des Médailles, leur ont fait donner différentes
dénominations. ; '
ÏDoiaTRiE ( 1’ ) en général 68. Étymologie de ce
mot. 70. Origine & caufes de l'Idolâtrie. ? 3 8c
fuiv. Chain , fils de-Noé , embraffa ouvertement
l’ Idolâtrie. 74. Ses progrès dans la famille de
Cham. i f id . Des Chananéens elle pâlie en
Égypte , delà en Grèce, en Ita'ie 8c dans tout
le monde Ibid . Objets de l’Idolâtrie* 7 S ^ '£*
Les Dieux divifés en trois Théogonies, chez
les Égyptiens. 76. La Grèce partage fes Dieux en
trois claffes , d’où naquirent crois efpèces de Religions.
77. & fuiv. LesPerfes, fans temples 8C
fans Statues, adoroient cependant de faux Dieux.
Ib id . Les Dieux des Phéniciens 8c des Phygiens.
Ib id . Les Dieux inconnus , 88c. Ib id . Ceux des
Peuples d’Occident, tels que les Gaulois , les
Germains, 8cc. 78 & fuiv. Progrès de l Idolâtrie,
fuivant l’Abbé Banier. 79 8c iuiv. On adora
d’abord les Affres. 79. Enfuire la Nature ou le
Monde. Ib id . Mélange des différentes Religions.
Ibid . Ample énumération des Dieux. 79 8c fuiv.
On adora les animaux. 82. On fit des demi-
Dieux des Héros.-S3. & fuiv. Dans les com-
mencemens, on ne donna aucune figure a la Divinité.
84 & fuiv. On fit en fui ce les Dieux d’Ar-
gille , de bois , de pierre, d’or , d’argent, 8cc.
b’5. Leurs formes d'abord groffières fe perfectionnèrent
avec les Arts. Ib id . Les Payens eux-
mêmes ont été les premiers à dégrader leurs
Dieux. 86 & fuiv. Nous ne parlerons que des
Dieux connus fur les Médailles. 87 8c fuiv. Les
fentimens différens des Auteurs fur 1 origine ;
l’exiftence 8c les avions des Dieux peuvent fe
réduire à deux. 88. Liberté du choix. Ib id . M.
• Rollin, Auteur du premier fentiment ,- trouve
cette origine dans l’Hiftoire altérée par les fables
des Poëres 89 & fuiv. M. Pluche , Auteur du
fécond , fait -naître tous les Dieux des figures
■ fymboliques de l’Écriture hiéroglyphique des
‘Égyptiens’ 92' & fuiv. Eh général, le même Écrivain
les fait prefquë tous fortir d’Ofiris,- dlfis
8c d’Horus. 1 n . Culte que les Idolâtres rendirent
aux fâuffes ^Divinités. 271 8c fuiv.
I doles d’argille de bois, de pierre 8c de différens
métaux- ; . * 5-
J érémie ■ fon difcours fut l’Idolâtrie. 87.
J eunesse (la) divinifée dans les temps où l’on ac-
cordoit cet honneur à tout ce qui paroilfoit bon
ou agréable. 2 5 2. Comment repréfentée fur les
Médailles. ■ : . ; • *' Ibid*
Je u x , ou exercices appëllés Gymniques. 381 8c
fuiv.
Jeux qui accompagnoient les fêtes. 37^ 5c fuiv.
J l e r d a , ou Lérida , fur les Médailles. 338.
I l l y r ie ( 1’ ) , fut les Médailles. Ib id .
Im p ér a t r ic es } leurs ornemens de tête , fur les
Médailles. 405. Elles doptoient quelquefois
certaines Provinces ou Villes. 4 1 1 Leurs alliant
ces conjugales. 413 & fuiv. Elles n’avoient d’abord
qu’un nom fur les Médailles. 480. Plu-
fieurs d’entre elles prirent les titres 8c les noms
des Déeffes. , 534*
Impôts ( les) engageoient fouvent le Peuple Romain
à fe révolter. 419. Quelques Empereurs
l’en déchargèrent. Ib id . Les remifes d’impôts
fur les Médailles. 419 5c fuiv.
Incuses ( les Médailles ) ne doivent qu’au hazard
8c à l’inadvertènee des Monnéraires leurs fingu-
larités. 2 8c fuiv. Il ne faut pas les confondre
avec celles dont parle M. l’Abbé Barthélémy , 5c
qui ont un Type en relief 8c un en creux. 8. Ce
que
que c’c-ft qu’une Médaille incufe. 17. Cësfor-
. tes de Médailles font rarement fufp'eétes. 553
8c fuiv.
Indes ( dans les.) on fe fert d'amandes pour M ou-
Indulgence ( 1’ ) divinifée. 252. Comment on la
repréfente fur les Médailles. 2526c fuiv.
Inscrip t ion ( 1’ ) d’une Médaille compofée de
lettres qui font fur fon champ. 3. Légende en
forme d’înfcription. 424.
Instrumens propres à fabriquer la Monnoie. :t 07.
J o bert ( le Père ) ; fon fentiment fur les Mon-
noies de fer. 13. lia parlé trop légèrement lut
les contre-marques. 3 8. Son erreur au fujet des
Médailles des Colonies & des Municipes. 524
& fuiv. Son opinion fur la différence entre S. C.
5c EX.S.C. relevée per M.Oudiner. 5 246c fuiv.
J oie (la) Divinifé. 253. Comment on la repréfente
iur les Médailles. 25 3 & fuiv.
J oseph ( le Patriarche ) adoré , félon quelques Auteurs
, en Egypte , fous le nom d’Apis. 110., 8C
fous le nom.de Sérapis. ( 215 .
Isis, figure fymbolique dè l’Écriture hiéroglyphique.
100. 170 & fuiv. Ce que lignifient les
lymbûles fubalternes dont elle eft accompagnée.
Ib id . Ifis à tête de vache. 1 o 1. Ifis avec la mefure
du Nil. Ibid. Ifis Mère. 10,3. Ifis avec un eadu-
. cée. 104 Ifis avec une Tortue 8c autres lym-
boles fubalternes. 105 8c fuiv. Ifis avec une tête
dé cicogne. 106. Ifis la même que la Terre.
111 ôc Iuiv. 221. Selon l’hiftoire 8c la fable,
Ifis fut Reine d’Égypte. 177. Comment on l’a
. repréfentée furies Médaillés. 178. Ses ornemens
- . de tête. . . 3 99.401.
I t a lie ( 1’ ) n’avoir pas moins de Temples que la
Grèce. 281. Elle ne fit plus qu’un même Peuple ,
après que Jules-Céfar eut accordé le droit de
Bourgeoisie aux Peuples qui habitoient au-delà
du Po. ,, , 5 24.
I t a l ie (1’ ) fur lès Médailles. 3 3 9.
J udée ( la ) , fur les Médailles. Ib id .
J uifs (les) payoient à Jupiter Capitolin le même
impôt qufils payoient à leur Temple. 419. Ner-
. va les en affranchit. 420.
J ulianus (Didius) fut le premier qui altéra la
Monnoie. d’argent. 14.
J ulien prit le premier la Couronne fermée. 40 3.
J u n o n } la tête de cette Divinité fur un poids romain.
64. Cette Déeffe n’étoit dans fon origine
qu’une figure fymbolique de l’Écriture
Hiéroglyphique, qui annonçoit les fêtes après
- les récoltes. 178 8c fuiv. La fable la fait foeur
8c femme de Jupiter. 180. Comment on la
repréfente fur les Médailles. Ibid. 8c fuiv. Ses
ornemens de tête. 399*
Junon , Déeffe de la Monnoie. 19 3 8c fuiv.
J unon S o fp ita . _ 1 6 \ .
J unons (les) 5 efpèces de divinités tutélaires. 84.
J upiter : fa tête fur les poids romains. 64. Jupiter
en quadrige fur un autre poids romain. Ib id . Sa
famille partagée par M. de la Barre en deux
claffes. 77 5c iuiv. Dans fon origine, Jupiter ne
fur qu’une figure fymbolique. 18 1 & fuiv. Selon
l’hiftoire , c’eft un nom donné à plufieurs Rois.
182. La fable en fait le Maître du Ciel 8c des
Dieux. 183. Comment on le repréfente fur les
Médailles. 18 3 6c fuiv. Defcription du Temple
de Jupiter Olympien, en Élide. 278 6c fuiv. Les
. ornemens de tcce de cette Divinité. 399«
J u p it e r -Ammon a pour ornement de tête des
cornes de belier. Ibid .
Just ice ( la ) , comme divinité} Voye{Équité.
Justice (la) a quelquefois donné aux Empereurs
5c aux Rois des titres glorieux. 526 8 c fuiv. 534.
Justin ; depuis le règne de cet Empereur on trouve
fur les Médailles des chiffres ôc des lettres mêlées
avec des lettres Majufcules. 53 6 S i fuiv*
Justin fit affaflîner dans fon Palais le tyran Vira-
lianus. ^ „ ■ ■; ■. ■ , i • ,
J ustln II. fut le dernier Conful de Rome. 48 2.
L
L a b a r u m j efpèce d’étendard fur lequel croit le
Monogramme de J. C. 405 6c fuiv.
L a b yr in th e s (les) étoient desbâtimens qnarrés
ou ronds. 369. Nous en trouvons quatre fameux
dans l’Antiquité. Ibid. Defcription de celui d’Égypte
, d’après Hérodote. 3698c fi Comment
on les a repréfentés fur les Médailles Ibid.8c fuiv.
L a c t an g e nousapprend que Flore étoitune femme
de mauvaife vie. 14S.
L ampes fépulchrales ( les ) n’étoieiit pas pérpé-
tuelles. . " 425 & fuiv.
L am pr id iü S rapporte un exemple delà proportion
entre ies pièces de Monnoies, tirée d’Àlexandré-
Sévère. 35.
L angues dont on s’eft fervi pour ies légendes des
Médailles, 6c qui o- r donné différens noms à.
ces monumens. 424. On trouve' dés légendes
partie en langue Grecque, partie en langue Latine.
/ ' . ‘ ’ " Ib id :
L are s (les) } Vo y c^ Génies. Leurs ornemens de
•.tête, , ■ ■ ■ H WÊÊmm
L a rice s ( les ), fut lès Médailles,. 340*
L argesses que certains Empereurs ont faites à
leurs fujets j V o y t {Bienfaits.
L a t i -è l a v i u m j tunique de pourpré que pôr-
toient les Sénateurs 8c lès Chevaliers. 48 j. Elle
éroit garnie de clous plus ou moins larges. 498.
L atone j figure fymbolique.; . " 105.
L au r ie r ( le ) , fur les Médailles. 346.
L aur ier s ( lés) accordées aux Soldats pour prix
de la viétoirè. - 395. 8c fuiv.
L e c t i s t e r n i u m ( le) croit une efpèce délit fur
lequel on portoit les ftatues des Dieux, dans les
cérémonies qui prenoient leur nom de ce lit.
300. Comment fe faifoit cet aéte de Religion,
8c pour quelles caufes. I b id .
L égats (les) défignés fur les Médailles. 500. Il
y en avoir de trois efpèces. Ib id . Par qui choifis
dans le temps de la République , 8c après fa dé-
% cadencé. 500 8c fuiv- Ceux du Sénat jouiffoiénc
des memes droits & privilèges que ceux des Empereurs.
50I.
L égende (la) d’une Médaille eft compofée des
lettres du contour. 3. Celle de l’exergue. Ib id .
539 8c fuiv. La principale eft ordinairement placée
en dedans du Grénetis. Ib id . Les legendes
font l’ame des Médailles. 67. Leur connoiflànce
eft effentielle. 67 8c fuiv. En quelles langues
font les légendes. 424. Combien il y a de légendes
fur les Médailles. Ibid. Leur pofitiôn.
Ib id . Légendes partie Grecques 8c partie Latines
, fur les Médailles du bas Empire. I b id .
Table Alphabétique Latine 6c Françoife capable
d’apprendre à lire les légendes qui né font composées
que de lettres initiales, ôc à les entendre
quoique gravées dans une langue étrangère. 425
8c fuiv. Les noms en ufage chez les Romains,
8c qui fe trouvent dans les légendes. 478. Les