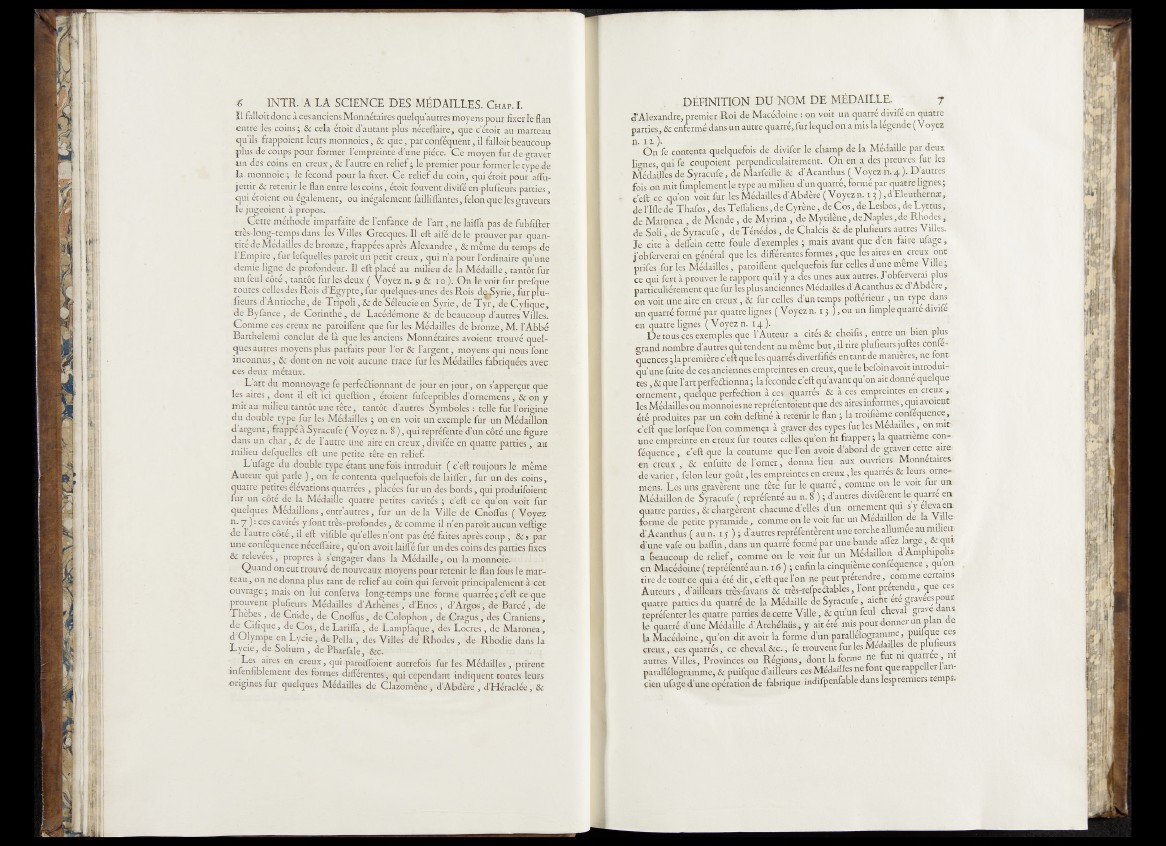
Il falloitdonc à ces anciens Monnétaires quel qu’autres moyens pour fixer le flan
entre les coins ; & cela étoit d’autant plus néceffaire, que c étoit au marteau
qu’ils frappoient leurs monnoies, & que, parconféquent, il falloit beaucoup
plus de coups pour former l’empreinte d’une pièce. C e moyen fut de oraver
un des coins en creux, & l’autre en relief ; le premier pour former le type de
la monnoie; le fécond pour la fixer. C e relief du coin, qui étoit pour affu-
jettir & retenir le flan entre les coins, étoit fouvent divifé en plufieurs parties,
qui étoient ou également, ou inégalement failliffantes, félon que les graveurs
le jugeoient à propos.
Cette méthode imparfaite de l’enfance de l’a r t, ne laiffa pas de fubfifter
trèsdong-temps dans les Villes Grecques.il eft aifé de le prouver par quantité
de Médaillés de bronze, frappées après Alexandre, &même du temps de
l ’Empire , fur lefquelles paroît un petit creux, qui n’a pour l’ordinaire qu’une
demie ligne de profondeur. Il eft placé au milieu de la Médaille, tantôt fur
unfeul côté, tantôt fur les deux ( Voyez n. 9 & 10). O n le voit fur prefque
toutes celles des Rois d’Egypte, fur quelques-unes des Rois doJSyrie, fur plufieurs
d Antioche, de T ripo li, & de Séleucie en Syrie, de T y r , de Cyfique,
de Byfance , de Corinthe, de Lacédémone & de beaucoup d’autres Villes.
Comme ces creux ne paroilfent que fur les Médailles de bronze, M. l’Abbé
Barthelemi conclut de là que les anciens Monnétaires avoient trouvé quelques
autres moyens plus parfaits pour l’or & l’argent, moyens qui nous font
inconnus, & dont on ne voit aucune trace fur les Médailles fabriquées avec
ces deux métaux.
L a r t du monnoyage fe perfectionnant de jour en jour, on s’apperçut que
les aires, dont il eft ici queftion , étoient fufceptibles d’ornemens, & on y
mit au milieu tantôt une tête, tantôt d’autres Symboles : telle fut l’origine
du double type fur les Médailles ; on en voit un exemple fur un Médaillon
d argent, frappe a Syracufe ( Voyez n. 8 ) , qui repréfente d’un côté une figure
dans un char, & de l’autre une aire en creux, divifée en quatre parties , au
milieu defquelles eft une petite tête en relief.
L ufage du double type étant une fois introduit ( c’eft toujours le même
Auteur qui parle ) , on fe contenta quelquefois de lailfer, fur un des coins,
quatre petites élévations quarrées , placées fur un des bords, qui produifoient
fur un cpté de la Médaille quatre petites cavités ; c’eft ce qu'on voit fur
quelques Médaillons, entr’autres, fur un delà Ville de Cnoffus ( Voyez
n. 7 ) ; ces cavités y font très-profondes, & comme il n’en paroît aucun veftige
de 1 autre cote, il eft vifible qu elles n’ont pas été faites après coup , & 5 par
une confequence neceffaire, qu on avoit laiffé fur un des coins des parties fixes
& relevées, propres à s’engager dans la Médailles ou la monnoie.
Quand on eut trouve de nouveaux moyens pour retenir le flan fous le marteau
, on ne donna plus tant de relief au coin qui fervoit principalement à cet
ouvrage; mais on lui conferva long-temps une forme quarrée; c’eft ce que
prouvent plufieurs Médailles d’A thènes, d’Erïos, d’Arg os, de Barcé , de
Thebes , de Cnide, de Cnolfus, de Colophon, de Cràgus, des Crâniens,
de Cifique , de C o s , de Larifla, de Lampfaque, des Locres, de Maronea,
d Olympe en L y c ie , de Pella , des Villes de Rhodes, de Rhodie dans la
L y c ie , de Solium , de Phatfale, &c.
. aires en creux, qui paroiffoient autrefois fur les Médailles, prirent
infenfiblement des formes différentes, qui cependant indiquent toutes leurs
origines fur quelques Médailles de Clazomène, d’A bdère, d’Héraclée, &
d’Alexandre, premier Ro i de Maçedoine : on voit un quatre divifé en quatre
parties, & enfermé dans un autre quarré, fur lequel on a mis la légende (Voyez
O n fe contenta quelquefois de divifer le champ de la Médaillé par deux
lignes, qui fe coupoient perpendiculairement. O n en a des preuves fur les
Médailles de Syracufe, de Marfeille & d’Acanthus ( Voyez n. 4 ). D autres
fois on mit Amplement le type au milieu d’un quarré, formé par quatre lignes ;
c’eft ce qu’on voit fur les Médailles d’Abdère (Vo y e z n. 13 ) ,d ’Eleuthernæ,
de fille de Thafos, des Teffaliens, de Cyrêne, de C o s , de Lesbos, de Lyttus,
de Maronea , de Mende, de Myrina , de Mytilène, de Naples, de Rhodes,
de S o li, de Syracufe , de Ténédos, de Çhalcis 8c de plufieurs autres Villes.
Je cite à delfein cette foule d’exemples ; mais avant que d en faire ufage,
j ’obferverai en général que les différentes formes, que les aires en^ creux ont
prifes fur les Médailles, paroilfent quelquefois fur celles d’une même V ille ;
ce qui fert à prouver le rapport qu’il y a des unes aüx autres. J’obferverai jflus
particuliérement que fur les plus anciennes Médailles d Acanthus & d’Abdere,
on voit une aire en creux, & fur celles d’un temps poftérieur , un type dans
un quarré formé par quatre lignes ( V oyez n. 13 ) , ou un fimple quarré divifé
en quatre lignes (V o y e z n. 14 ) . _
D e tous çes exemples que l’Auteur a cités & choifis, entre un bien plus
crand nombre d’autres qui tendent au même b u t, il tire plufieurs juffes confe-
quence? ; la première c’eft que les quarrés diverfifiés en tant de maniérés, ne font
qu’une fuite de ces anciennes empreintes en creux, que lebefoinavoit introduites
, & que l’art perfectionna ; la fécondé c’eft qu avant qu on ait donne quelque
ornement, quelque perfection à ces quarrés & à ces empreintes en creux ,
les Médailles ou monnoies ne repréfentoient que des aires informes, qui avoient
été produites par un coin deftiné à retenir le flan ; la.troifième conféquence,
c’eft que lorfque l’on commença à graver des types fur les Médailles^, on mit
une empreinte en creux fur toutes celles qu’on fit frapper; la quatrième conféquence
, c’eft que la coutume que l’on avoit d abord de graver cette aire
en creux , Si enfuite de l’orner, donna lieu aux ouvriers Monnétaires
de varier, félon leur goût, les empreintes en creux, les quar'res & leurs orne-
mens. Les uns gravèrent une tête fur le quarré, comme on le voit, fur un
Médaillon de Syracufe ( repréfenté au n. 8 ) ; d’autres divifèrent le quarré en
quatre parties, & chargèrent chacune d’elles d’un ornement qui s y
forme de petite pyramide , comme on le voit fur un Médaillon de la V i e>
d’Acanthus ( aun. 1 ; ) ; d’autres repréfentèrent une torche allumée au milieu
d’une vafe ou badin, dans un quarré formé par une bande affez large 1 & qui-
a beaucoup de relief, comme on le voit fur un Médaillon dAmphipolis:
en Macédoine ( repréfenté aun. 16 ) ; enfin la cinquième confequence , qu on
tire de tout ce qui a été dit, c’eft que 1 on ne peut prétendre, comme certains
Auteurs, d’ailleurs très-favans & très-refpe£tables, 1 ont preten u , cpie ces
quatre parties du quarré de la Médaille de Syracufe, aiefit ete gravées pour
repréfenter les quatre parties de cette V i l le , & quun feul cheval grave ans
le quarré d’une Médaille d’Archélaiis., y ait été mis pour donner un p an e
la Macédoine, qu’on dit avoir la forme d un parallélogramme, pu que ces
creux, ees quarrés, ce cheval & c ., fe trouvent fur les Médaillés de plufieurs
autres Villes, Provinces ou Régions, dont la forme ne fut ni quarree ni
parallélogramme, & puifque d’ailleurs ces Médailles nefont que rappeller 1 ancien
ufage d’une opération de fabrique indifpenfable dans lespremiers temps.