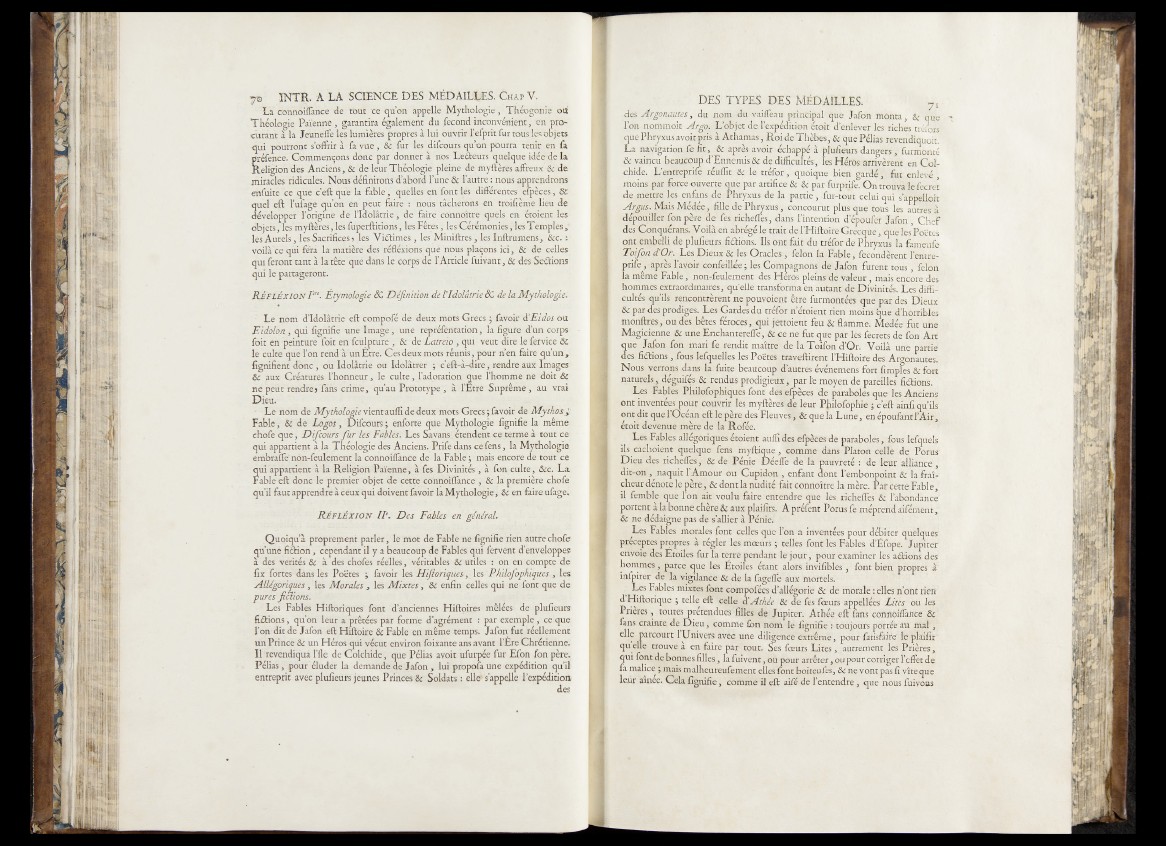
La Connoiffance de tout te qu’on appelle Mythologie, Théogonie ou
Théologie Païenne , garantira également du fécond inconvénient , en pro-
•clrrant a la JeunelFe les lumières propres à lui ouvrir refprïtfur tous les objets
•qui pourront s’offrir à fa v u e , & fur les difcours qu’on pourra tenir en fa
préfenee. Commençons donc par donner à nos Lecteurs quelque idée de la
Religion des Anciens, & de leur Théologie pleine de myftères affreux & de
miracles ridicules. Nous définirons d’abord l’une & l’autre : nous apprendrons
enfuite ce que c’eft que la fable, quelles en font les differentes efpèces, &
quel eft l’ufage qu’on en peut faire : nous tâcherons en troifième lieu de
développer l’origine de l’Idolâtrie, de faire cûnnôître quels en étoient les
objets, les myftères, les fuperftitions, les Fêtes, les Cérémonies, les Temples,1
les A utels, les Sacrifices ? les Viètimes , les Miniftres , les Inftrumens, &c. :
voilà ce qui fera la' matière des réflexions qué nous plaçons ic i, & de celles
qui feront tant à la tête que dans le corps de l’Article fuivànt, & des Sections
qui le partageront.
R éflexion P " . Etymologie Se Définition de l’Idolâtrie SC de la Mythologie.
L e nom d’idolâtrie eft compofé de deux mots Grecs ; favoir d’Eidos ou
Eidolon , qui fignifie une Image, une repréfentation, la figure d’un corps
foit en peinture foit en fculpture , & de Latreio , qui veut dire le fervice &
le culte que l’on rend à un Être. Ces deux mots réunis, pour n’en faire qu’u n ,
lignifient donc , ou Idolâtrie ou Idolâtrer ; c’eft-à-dire, rendre aux Images
& aux Créatures l’honneur, le culte, l’adoration que l’homme ne doit &
ne peut rendre) fans crime, qu’au Prototype, à l’Être Suprême, au vrai
Dieu.
L e nom de Mythologie vient auffi de deux mots Grecs ; favoir de Mythos >
Fable, & de Logos, Difcours ; enforte que Mythologie fignifie la même
chofe que, Difcours fu r les Fables. Les Savans étendent ce terme à tout ce
qui appartient à la Théologie des Anciens. Prife dans ce fens, la Mythologie
embraffe non-feulement la connoiffance de la Fable ; mais encore de tout ce
qui appartient à la Religion Païenne, à fes Divinités , à fon culte, &c. La.
Fable eft donc le premier objet de cette connoiffance , & la première chofe
qu’il faut apprendre à ceux qui doivent favoir la Mythologie, &c en faire ufage.
Réflexion IP . D e s Fables en général.
Quoiqu’à proprement parler, le mot de Fable ne fignifie rien autre chofe
qu’une fiàion , cependant il y a beaucoup de Fables qui fervent d’enveloppes:
à des vérités & à des chofes réelles, véritables & utiles : on en compte de
fix fortes dans les Poëtes ; favoir les Hiftoriques, les Philofophiques , les
Allégoriques, les Morales , les M ix te s , & enfin celles qui ne font que de
pures fictions.
Les Fables Hiftoriques font d’anciennes Hiftoires mêlées de plufieurs
fiétions, qu’on leur a prêtées par forme d’agrément : par exemple, ce que
l’on dit de Jafon eft Hiftoire & Fable en même temps. Jafon fut réellement
un Prince & un Héros qui vécut environ foixante ans avant l’Ère Chrétienne.
Il revendiqua l’fle de Colchide, que Pélias avoit ufurpée fur Efon fon père.
Pélias, pour éluder la demande de Jafon , lui propofa une expédition qu’il
entreprit avec plufieurs jeunes Princes & Soldats : elle' s’appelle l ’expédition.
des Argonautes, du nom du vaiffeau principal que Jafon monta, 8c que
l’on nommoit Atgo. L ’objet de l’expédition etoit d’enlévet les riches tréfors
que Phryxus avoit pris à Athamas, Ro i de Thèbes, & que Pélias revendiquoit.
La navigation fe f it , & après avoir échappé à plufieurs dangers , furmonté
& vaincu beaucoup d’Ennemis & de difficultés, les Héros arrivèrent en C o lchide.
L ’entreprife réuffit & le tréfor, quoique bien gardé, fut enlevé ,
moins par force ouverte que par artifice & & par furprife. O n trouva le fecret
de mettre les enfans de Phryxus de la partie, fur-tout celui qui s’appellok
Argus. Mais Médée, fille de Phryxus, concourut plus que tous les autres à
dépouiller fon père de fes richelfes, dans l’intention depoufer Jafon, C h e f
des Conquérans, Voilà en abrégé le trait de l ’Hiftoire Grecque, que les Poëtes
ont embelli de plufieurs fictions. Ils ont fait du tréfor de Phryxus la fameufe
Toifon d’Or. Les Dieux & les Oracles , félon la Fable, fécondèrent l’entre-
prife | après l ’avoir confeillée ; les Compagnons de Jafon furent tous, félon
la meme Fable, non-feulement des Héros pleins de valeur, mais encore .des
hommes extraordinaires, quelle transforma en autant de Divinités. Les difficultés
qu’ils rencontrèrent ne pouvoient être furmontées que par des Dieux
& par des prodiges. Les Gardes du tréfor n’étoient rien moins que d’horribles
monftres, ondes bêtes féroces, qui jettoient feu & flamme. Medée fut une
Magicienne & une Enchantereffe, & ce ne fut que par les fecrets de fon A r t
que Jafon fon mari fe rendit maître de la Toifon d’Or. Voilà une partie
des fictions , fous lefquelles les Poëtes traveftirent l’Hiftoire des Argonautes.
Nous verrons dans la fuite beaucoup d’autres événemens fort fimples & fo r t
naturels,,, déguifés & rendus prodigieux, par le moyen de pareilles fictions.
Les Fables Philofophiques font des efpèces de paraboles que les Anciens
ont inventées pour couvrir les myftères de leur Pfiilofophie ; c’eft ainfi qu’ils
ont dit que l’Océan eft le père des Fleuves, & que la Lune, en époufant l’A ir ,
étoit devenue mère de la Rofée.
Les Fables allégoriques étoient auffi des efpèces de paraboles, fous lefquels
ils cachoient quelque fens myftique, comme dans Platon celle de Porüs
Dieu des richeffes, & de Pénie Déeffe de la pauvreté : de leur alliance,
dit-on, naquit l’Amour ou Cupidon , enfant dont l’embonpoint & la fraîcheur
dénote le père, & dont la nudité fait connoître la mère. Par cette Fable,
il femble que l’on ait voulu faire entendre que les richeffes & l’abondance'
portent à la bonne chère 8c aux plaifirs. A préfent Porus fe méprend aifément,
& ne dédaigné pas de s’allier à Pénie.
Les Fables morales font celles que l’on a inventées pour débiter quelques
préceptes propres à régler les moeurs ; telles font les Fables d’Éfope. Jupiter
envoie des Étoiles fur la terre pendant le jour, pour examiner les aétions des
hommes, parce que les Étoiles étant alors, invifibles, font bien propres à
infpirer de la vigilance & de la fagefle aux mortels.
Les Fables mixtes font compofées d’allégorie 8c de morale : elles n’ont rien
d-Hiftorique ; telle eft celle d’Athée 8c de fes foeurs appelléeS Lites ou les
Prières, toutes prétendues filles de Jupiter. Athée eft fans coiïnoiflànce &
fans crainte de D ie u , comme fon nom le fignifie : toujours portée au mal ,
elle parcourt 1 Univers avec une diligence extrême, pour farisfàite le plaifir
qu elle trouve a en faire par tout. Ses foeurs L ite s , autrement les Prières,
qui font de bonnes filles, la fuivent, ou pour arrêter, oupour corriger l’effet de
fa malice ; mais malheureufement elles font boiteufes, & ne vont pas fi vite que
leur aînee. Cela fignifie, comme il eft aifé de l’entendre, que nous fuivoas