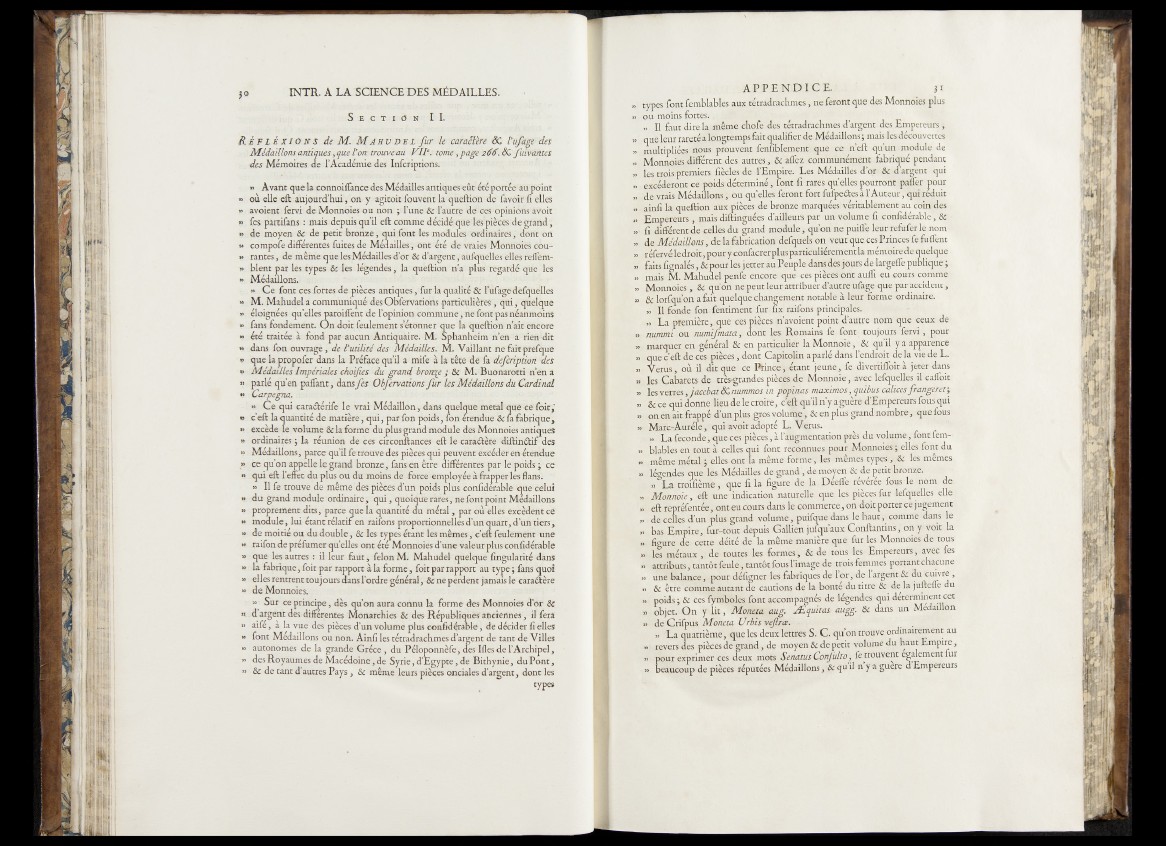
S e c t i o n II.
R é f l e x i o n s de M . M a hv d e l fur le caractère êC l’ufage des
Médaillons antiques, que l’on trouve au V IIe. tome, page 266. SC fuivantes
des Mémoires de l’Académie des Infcriptions.
» Avant que la connoilfance des Médailles antiques eût été portée au point
» ou elle eft aujourd’h ui, on y agitoit fouvent la queftion de favoir fi elles
» avoient fervi de Monnoies ou non ; l’une & l’autre de ces opinions avoit
» fes partifans : mais depuis qu’il eft comme décidé que les pièces de grand,
» de moyen & de petit bronze, qui font les modules ordinaires, dont on
» compofe différentes fuites de Médailles, ont été de vraies Monnoies cou-
» rantes, de même que les Médailles d’or & d’argent, aufquelles elles reffem-
» blent par les types & les légendes, la queftion n’a plus regardé que les
•> Médaillons.
» C e font ces fortes de pièces antiques, fur la qualité & l’ufage defquelles
« M. Mahudel a communiqué des Obfervations particulières, q u i, quelque
» éloignées quelles paroiffent de l’opinion commune, ne font pas néanmoins
» fans fondement. O n doit feulement s’étonner que la queftion n’ait encore
» été traitée à fond par aucun Antiquaire. M. Sphanheim n’en a rien dit
*> dans fon ouvrage, de l ’uùlité des M édailles. M. Vaillant ne faitprefque
» que la propofer dans la Préface qu’il a mife à la tête de fa defcription des
» M édailles Impériales choijies du grand bronze ; & M. Buonarotti n’en a
» parlé qu’en paffant, dans fe s Objervations fu r les Médaillons du Cardinal
v Carpegna.
* C e qui caractérife le vrai Médaillon, dans quelque métal que ce foit,’
e c’eft la quantité de matière, qui, par fon poids, fon étendue & fa fabrique,
» excede le volume & la forme du plus grand module des Monnoies antiques
» ordinaires ; la réunion de ces circonftances eft le caractère diftinéHf des
» Médaillons, parce qu’il fe trouve des pièces qui peuvent excéder en étendue
.» ce qu’on appelle le grand bronze, fans en être différentes par le poids ; ce
» qui eft l’effet du plus ou du moins de force employée à frapper les flans.
» Il fe trouve de même des pièces d’un poids plus confidérable que celui
» du grand module ordinaire, q u i, quoique rares, ne font point Médaillons
» proprement dits, parce que la quantité du métal, par où elles excèdent câ
» module, lui étant rélatif en raifons proportionnelles d’un quart, d’un tiers,
•> de moitié ou du double, & les types étant les mêmes, c’eft feulement une
» raifon de prefumer quelles ont été Monnoies d’une valeur plus confidérable
» que les autres : il leur faut, félon M. Mahudel quelque Angularité dans
» la fabrique, foit par rapport à la forme, foit par rapport au type ; fans quoi
» elles rentrent toujours dans l’ordre général, & ne perdent jamais le caractère
« de Monnoies.
m Sur ce principe, dès qu’on aura connu la forme des Monnoies d’or Sc
« d argent des differentes Monarchies & des Républiques anciennes, il fera
” aife, a la vue des pièces d’un volume plus confidérable, de décider 11 elles
» font Médaillons ou non. Ainfi les tétradrachmes d’argent de tant de Villes
” autonomes de la grande Grèce, du Péloponnèfe, des Ifles de l’A rchipel,
» des Royaumes de Macédoine, de Syrie, d’Egypte, de Bithynie, du Pont,
” & de tant d autres Pa y s , & même leurs pièces onciales d’argent, dont les
types
» types font femblables aux tétradrachmes, ne feront que des Monnoies plus
» ou moins fortes.-, :
„ Il faut dire la même chofe des tétradrachmes d’argent des Empereurs ,
» que leur rareté a longtemps fait qualifier de Médaillons ; mais les découvertes
multipliées nous prouvent fenfiblement que ce n’eft qu’un module de
» Monnoies différent des autres , & affez communément fabriqué pendant
b les trois premiers fiècles de l’Empire. Les Médailles d or & d argent qui
b excéderont ce poids déterminé, font f i rares qu elles pourront paffer pour
I de vrais Médaillons, ou qu’elles feront fort fufpeétes a l’Auteur, qui réduit
b ainfi la queftion aux pièces de bronze marquées véritablement au coin des
b Empereurs , mais diftinguées d’ailleurs par un volume f i confidérable, &
»• fi différent de celles du grand module, qu’on ne puiffe leur refufer le nom
b de M édaillons, de la fabrication defquels on veut que ces Princes fe fuffent
» réfervé le droit, pour y confacrerplus particuliérement la mémoire de quelque
« faits fignalés, & pour les j etter au Peuple dans des jours de largeffe publique ;
b mais M. Mahudel penfe encore que ces pièces ont auffi eu cours comme
b Monnoies , &c qu’on ne peut leur attribuer d’autre ufage que par accident,
b & lorfqu’on a fait quelque changement notable à leur forme ordinaire.
b II fonde fon fentiment fur fix raifons principales.
b L a première, que ces pièces n’avoient point d’autre nom que ceux de
b nummi ou numifmata, dont les Romains fe font toujours fe rv i, pour
b marquer en général & en particulier la Monnoie, & qu’il y a apparence
b que c’eft de ces pièces, dont Capitolin a parlé dans l’endroit de la vie de L.
b Verus, où il dit que ce Prince, étant jeune, fe divertiffoit à jeter dans
b les Cabarets de très-grandes pièces de Monnoie, avec lefquelles il caffoic
b les verres ,jacebatSCnummos in popinas maximos, quibus calices frangeref,
b & ce qui donne lieu de le croire, c’eft qu’il n’y a guère d Empereurs fous qui
b on en ait frappé d’un plus gros volume, & en plus grand nombre, que fous
b Marc-Auréle, qui avoit adopté L. Verus.
» L a fécondé, que ces pièces, à l’augmentation près du volume, font fem-
b blables en tout a celles qui font reconnues pour Monnoies ; elles font du
b même métal ; elles ont la même forme, les mêmes types , & les memes
« légendes que les Médailles de grand, de moyen & de petit bronze.
,,&La troifième, que fi la figure de la Deeflè révérée fous de nom de
» Monnoie, eft une indication naturelle que les pièces fur lefquelles elle
» eft repréfentée, ont eu cours dans le commerce, on doit porter ce j ugement
b de celles d’un plus grand volume, puifque dans le haut, comme dans le
b bas Empire, fur-tout depuis Gallien jufquaux Conftantins, on y voit la
b figure de cette déité de la même manière que fur les Monnoies de tous
b les métaux , de toutes les formes, & de tous les Empereurs, avec fes
b attributs, tantôt feule, tantôt fous l’image de trois femmes portant chacune
b une balance, pour défigner les fabriques de 1 o r , de 1 argent & du cuivre,
b & être comme autant de cautions de la bonté du titre & de la juftelfe du
b poids ; & ces fymboles font accompagnés de légendes qui déterminent cet
j, objet. O n y l i t , Moneta aug. Æ quitas augg. &c dans un Médaillon
b de Crifpus Moneta Urbis veftræ.
b L a quatrième, que les deux lettres S. C . qu’on trouve ordinairement au
b revers des pièces de grand, de moyen & de petic volume du haut Empire,
b pour exprimer ces deux mots Senatus Conjiilto, fe trouvent egalement fur
b beaucoup de pièces réputées Médaillons, & qu il n y a guère d Empereurs