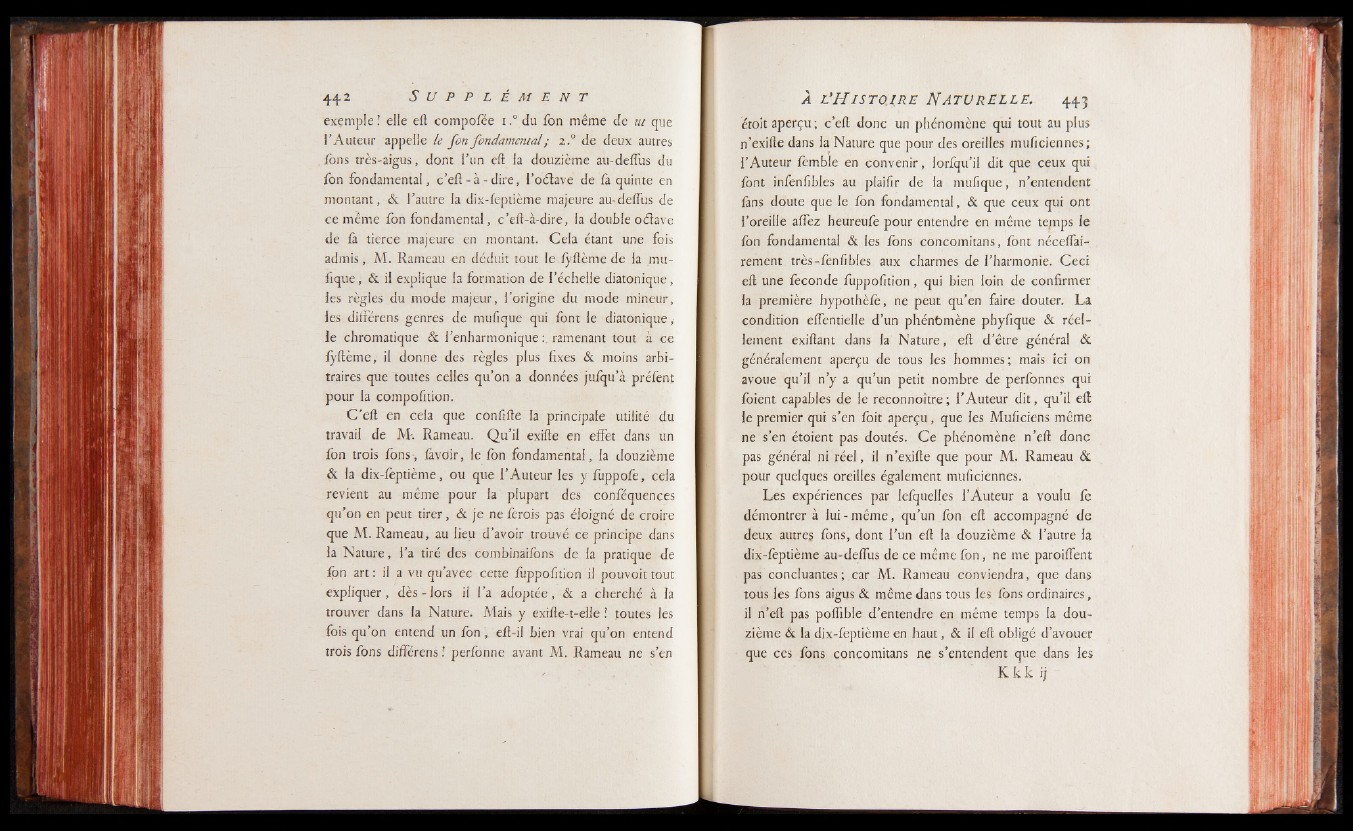
exemple l elle eft compofee i.° du fon même de ut que
l ’Auteur appelle le fonfondamental ; z.° de deux autres
fons très-aigus, dont l’un eft la douzième au-deflus du
fon fondamental, c ’e ft-à -d ire , i ’oétave de fà quinte en
montant, & l’autre la dix-feptième majeure au-deiïiis de
ce même fon fondamental, c ’eft-à-dire, la double odave
de fa tierce majeure en montant. Cela étant une fois
admis, M. Rameau en déduit tout le fyftème de la mu-
fique, & il explique la formation de l’échelle diatonique,
les règles du mode majeur, l’origine du mode mineur,
les différens genres de mufique qui font le diatonique,
le chromatique & l ’enharmonique ramenant tout à ce
fyftème, il donne des règles plus fixes & moins arbitraires
que toutes celles qu’on a données jufqu’à préfont
pour la compofition.
C ’eft en cela que confifte la principale utilité du
travail de M-. Rameau. Q u ’il exifte en effet dans un
fon trois fons, lavoir, le fon fondamental, la douzième
& la dix-fèptième, ou que l’Auteur les y fuppofe, cela
revient au même pour la plupart des conféquences
qu’on en peut tirer, & je ne ferais pas éloigné de croire
que M. Rameau, au lieu d’avoir trouvé ce principe dans
la Nature, l’a tiré des combinaifons de la pratique de
fon art : il a vu qu’avec cette fuppofition il pouvoit tout
expliquer, dès-lors il l ’a adoptée, & a cherché à la
trouver dans la Nature. Mais y exifte-t-elle ! toutes les
fois qu’on entend un fon , eft-il bien vrai qu’on entend
trois fons différens ! perfonne avant M. Rameau ne s’en
À L ’H / S T O f R E N a t u r e l l e . 443
étoit aperçu; c ’eft donc un phénomène qui tout au plus
n’exifte dans la Nature que pour des oreilles muficiennes;
l ’Auteur fèmble en convenir, lorfqu’il dit que ceux qui
font infenfibles au plaifir de la mufique, n’entendent
fans doute que le fon fondamental, & que ceux qui ont
l ’oreille affez heureufo pour entendre en même tepips le
fon fondamental & les fons concomitans, font néceffai-
rement très-fenfibles aux charmes de l’harmonie. Ceci
eft une fécondé fuppofition, qui bien loin de confirmer
la première hypothèfè, ne peut qu’en faire douter. La
condition effentielle d’un phénomène phyfique & réellement
exiftant dans la Nature, eft d’être général &
généralement aperçu de tous les hommes; mais ici on
avoue qu’il n’y a qu’un petit nombre de perfonnes qui
foient capables de le reconnoître ; l'Auteur dit, qu’il eft
le premier qui s’en foit aperçu, que les Muficiens même
ne s’en étoient pas doutés. C e phénomène n’eft donc
pas général ni réel, il n’exifte que pour M. Rameau &
pour quelques oreilles également muficiennes.
Les expériences par lefquelles l’Auteur a voulu fo
démontrer à lui - même, qu’un fon eft accompagné de
deux autres fons, dont l’un eft la douzième & l ’autre la
dix-fèptième au-deffus de ce même fon, ne me paroiffent
pas concluantes ; car M. Rameau conviendra, que dans
tous les fons aigus & même dans tous les fons ordinaires,
il n’eft pas poftible d’entendre en même temps la douzième
& la dix-feptième en haut, & il eft obligé d’avouer
que ces fons conconfitans ne s’entendent que dans les
K k k ij