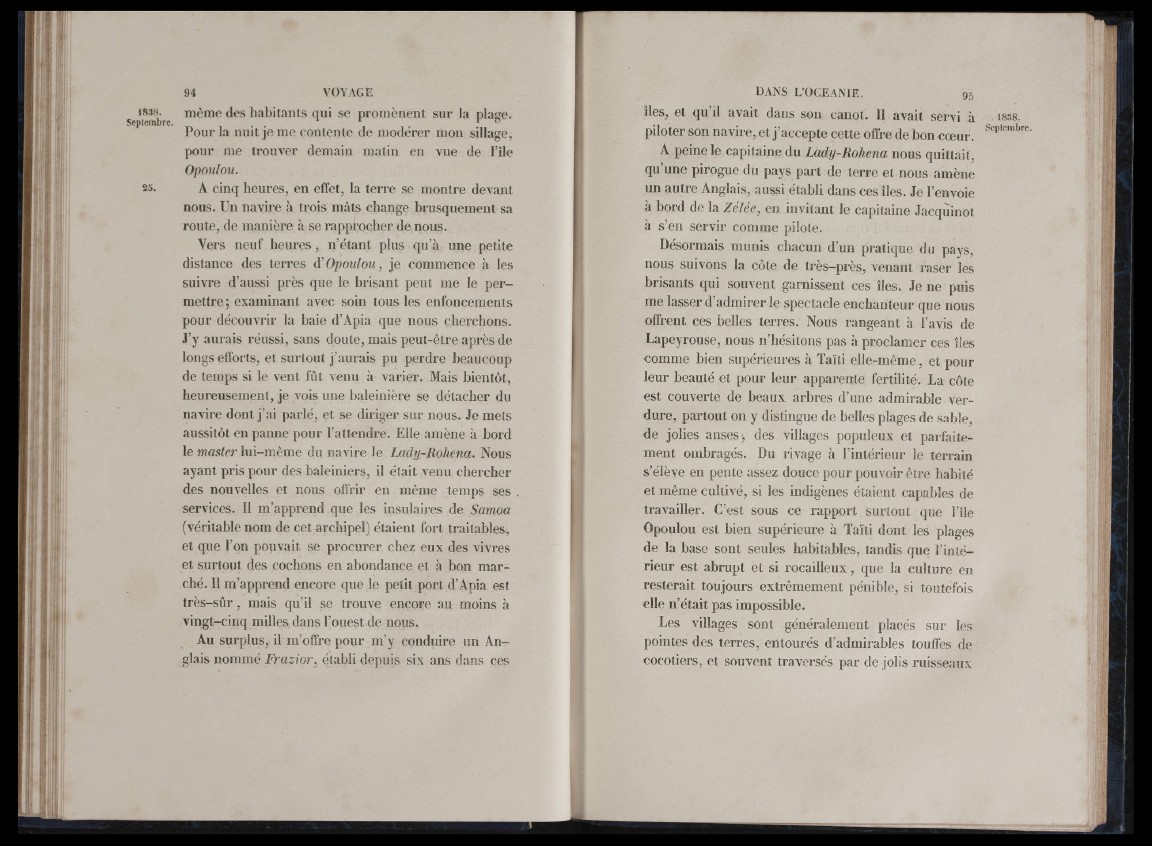
25.
même des habitants qui se promènent sur la plage.
Pour la nuit je me contente de modérer mon sillage,
pour me trouver demain matin en vue de l’île
Opoulou.
A cinq heures, en effet, la terre se montre devant
nous. Un navire à trois mâts change brusquement sa
route, de manière à se rapprocher de nous.
Vers neuf heures, n’étant plus qu’à une petite
distance des terres d'Opoulou, je commence à les
suivre d’aussi près que le brisant peut me le permettre
; examinant avec soin tous les enfoncements
pour découvrir la baie d’Apia que nous cherchons.
J’y aurais réussi, sans doute, mais peut-être après de
longs efforts, et surtout j’aurais pu perdre beaucoup
de temps si le vent fût venu à varier. Mais bientôt,
heureusement, je vois une baleinière se détacher du
navire dont j’ai parlé, et se diriger sur nous. Je mets
aussitôt en panne pour l’attendre. Elle amène à bord
le master lui-même du navire Je Lady-Rohena. Nous
ayant pris pour des baleiniers, il était venu chercher
des nouvelles et nous offrir en même temps ses .
services. Il m’apprend que les insulaires de Samoa
(véritable nom de cet archipel) étaient fort traitables,
et que l’on pouvait se procurer chez eux des vivres
et surtout des cochons en abondance et à bon marché.
Il m’apprend encore que le petit port d’Apia est
trè s-sû r, mais qu’il se trouve encore au moins à
vingt-cinq milles dans l’ouest de nous.
Au surplus, il m’offre pour m’y conduire un Anglais
nommé Frazior, établi depuis six ans dans ces
îles, et qu il avait dans son canot. Il avait servi à
piloter son navire, et j’accepte cette offre de bon coeur.
A peine le capitaine du Lady-Rohena nous quittait,
qu’une pirogue du pays part de terre et nous amène
un autre Anglais, aussi établi dans ces îles. Je l’envoie
a bord de la Zelee, en invitant le capitaine Jacquinot
à s’en servir comme pilote.
Désormais munis chacun d’un pratique du pays,
nous suivons la côte de très-près, venant raser les
brisants qui souvent garnissent ces îles. Je ne puis
me lasser d’admirer le spectacle enchanteur que nous
offrent ces belles terres. Nous rangeant à l’avis de
Lapeyrouse, nous n’hésitons pas à proclamer ces îles
comme bien supérieures à Taïti elle-même, et pour
leur beauté et pour leur apparente fertilité. La côte
est couverte de beaux arbres d’une admirable verdure,
partout on y distingue de belles plages de sable,
de jolies anses ■, des villages populeux et parfaitement
ombragés. Du rivage à l’intérieur le terrain
s’élève en pente assez douce pour pouvoir être habité
et même cultivé, si les indigènes étaient capables de
travailler. C’est sous ce rapport surtout que l’île
Opoulou est bien supérieure à Taïti dont les plages
de la base sont seules habitables, tandis que l’intérieur
est abrupt ët si rocailleux, que la culture en
resterait toujours extrêmement pénible, si toutefois
elle n’était pas impossible.
Les villages sont généralement placés sur les
pointes des terres, entourés d’admirables touffes de
cocotiers, et souvent traversés par de jolis ruisseaux