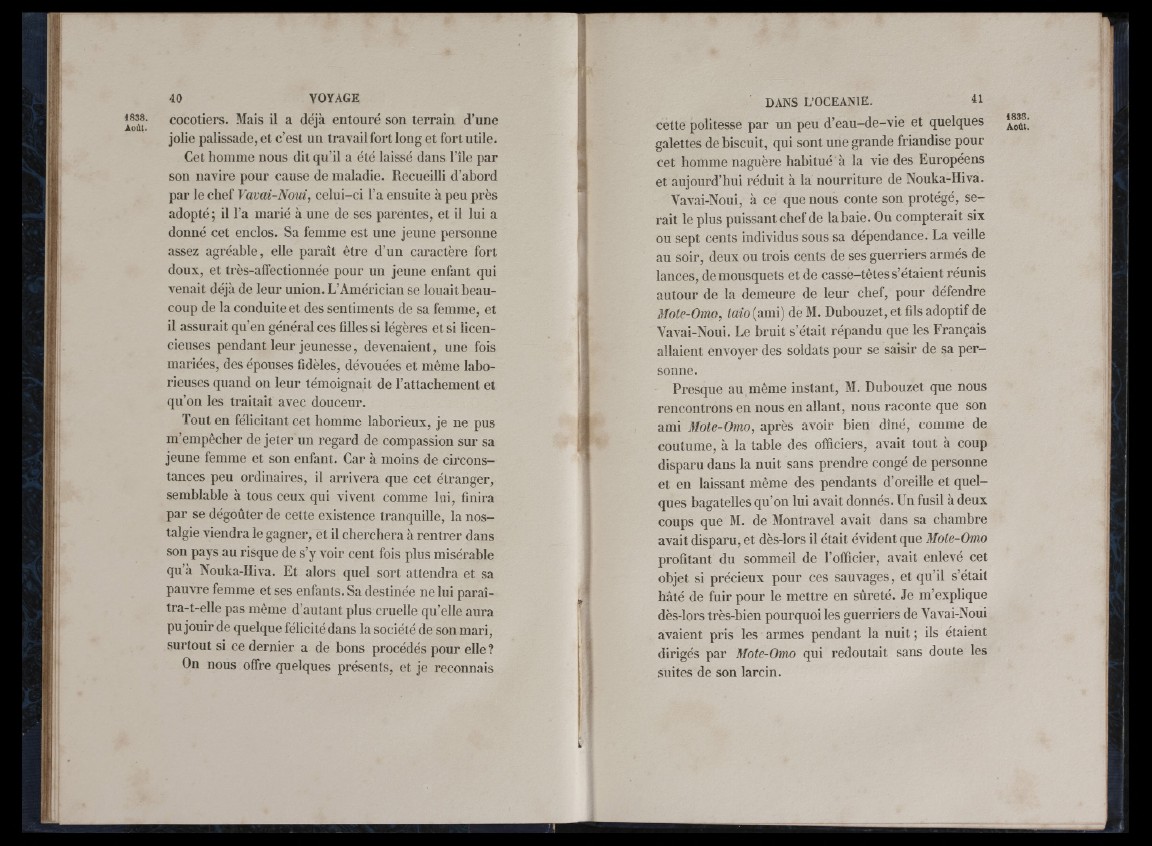
cocotiers. Mais il a déjà entouré son terrain d’une
jolie palissade, et c’est un travail fort long et fort utile.
Cet homme nous dit qu’il a été laissé dans l’île par
son navire pour cause de maladie. Recueilli d’abord
par le chef Vavai-Noui, celui-ci l’a ensuite à peu près
adopté; il l’a marié à une de ses parentes, et il lui a
donné cet enclos. Sa femme est une jeune personne
assez agréable, elle paraît être d’un caractère fort
doux, et très-affectionnée pour un jeune enfant qui
venait déjà de leur union. L’Américian se louait beaucoup
de la conduite et des sentiments de sa femme, et
il assurait qu’en général ces filles si légères et si licencieuses
pendant leur jeunesse, devenaient, une fois
mariées, des épouses fidèles, dévouées et même laborieuses
quand on leur témoignait de l’attachement et
qu’on les traitait avec douceur.
Tout en félicitant cet homme laborieux, je ne pus
m’empêcher de jeter un regard de compassion sur sa
jeune femme et son enfant. Car à moins de circonstances
peu ordinaires, il arrivera que cet étranger,
semblable à tous ceux qui vivent comme lui, f in i r a
par se dégoûter de cette existence tranquille, la nostalgie
viendra le gagner, et il cherchera à rentrer dans
son pays au risque de s’y voir cent fois plus misérable
qu’à Nouka-Hiva. Et alors quel sort attendra et sa
pauvre femme et ses enfants. Sa destinée ne lui paraîtra
t-elle pas même d’autant plus cruelle qu’elle aura
pu jouir de quelque félicité dans la société de son mari,
surtout si ce dernier a de bons procédés pour elle ?
On nous offre quelques présents, et je reconnais
cette politesse par un peu d’eau-de-vie et quelques
galettes de biscuit, qui sont une grande friandise pour
cet homme naguère habitué à la vie des Européens
et aujourd’hui réduit à la nourriture de Nouka-Hiva.
Vavai-Noui, à ce que nous conte son protégé, serait
le plus puissant chef de la baie. On compterait six
ou sept cents individus sous sa dépendance. La veille
au soir, deux ou trois cents de ses guerriers armés de
lances, de mousquets et de casse-têtes s’étaient réunis
autour de la demeure de leur chef, pour défendre
Mote-Omo, taio (ami) de M. Dubouzet, et fils adoptif de
Vavai-Noui. Le bruit s’était répandu que les Français
allaient envoyer des soldats pour se saisir de sa personne.
Presque au même instant, M. Dubouzet que nous
rencontrons en nous en allant, nous raconte que son
ami Mote-Omo, après avoir bien dîné, comme de
coutume, à la table des officiers, avait tout à coup
disparu dans la nuit sans prendre congé de personne
et en laissant même des pendants d’oreille et quelques
bagatelles qu’on lui avait donnés. Un fusil à deux
coups que M. de Montravel avait dans sa chambre
avait disparu, et dès-lors il était évident que Mote-Omo
profitant du sommeil de l’officier, avait enlevé cet
objet si précieux pour ces sauvages, et qu’il s’était
hâté de fuir pour le mettre en sûreté. Je m’explique
dès-lors très-bien pourquoi les guerriers de Vavai-Noui
avaient pris les armes pendant la nuit ; ils étaient
dirigés par Mote-Omo qui redoutait sans doute les
suites de son larcin.