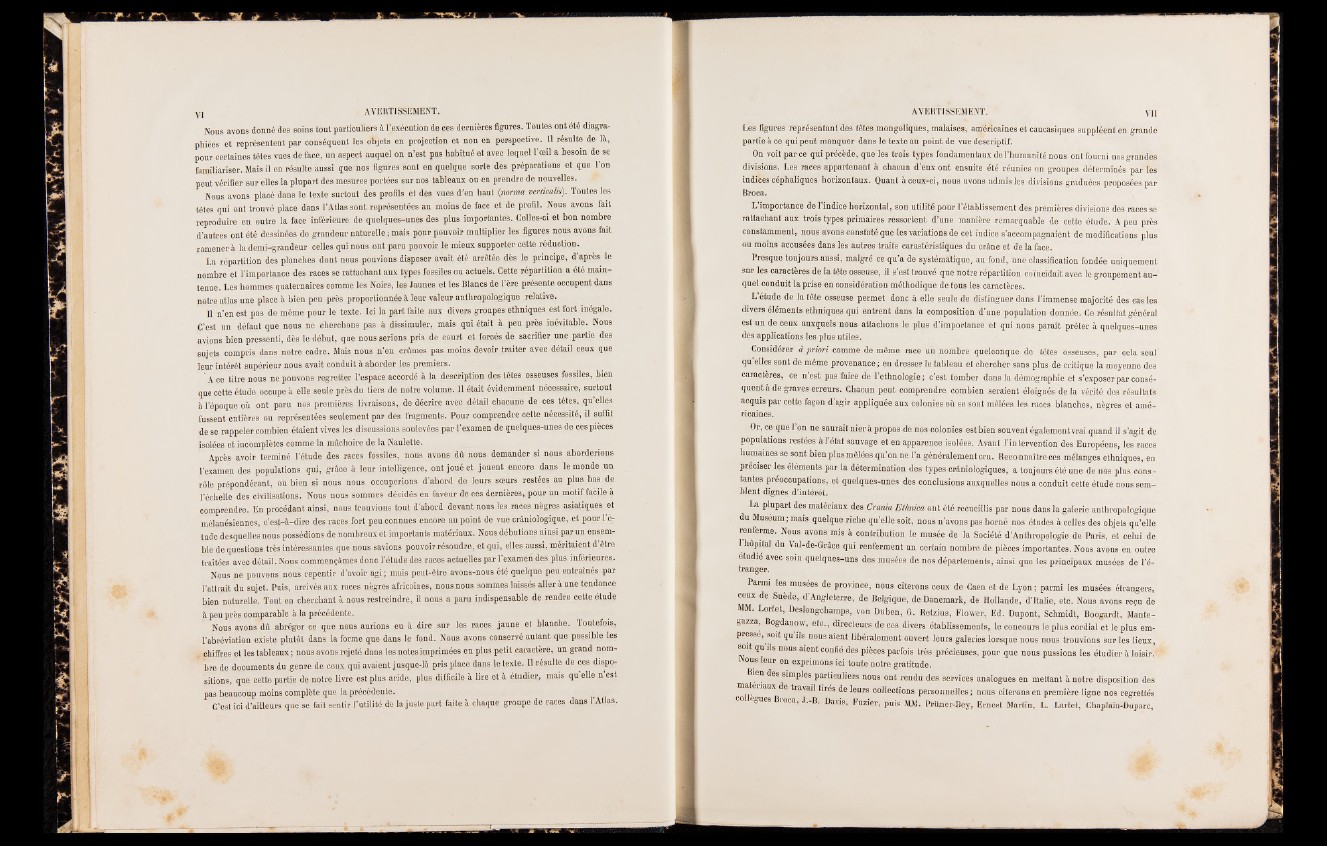
Nous avons donné des soins tout particuliers à l’exécution de ces dernières figures. Toutes ont été diagra-
phiées et représentent par conséquent les objets en projeotion et non en perspective. 11 résulte de là,
pour certaines têtes vues de facè, un aspect auquel on n’est pas habitué et avec lequel l’oeil a besoin de se
familiariser. Mais il en résulte aussi que nos figures sont en quelque sorte des préparations et que Ton
peut vérifier sur elles la plupart des mesures portées sur nos tableaux ou en prendre de nouvelles.
Nous avons placé dans le texte surtout des profils et des vues d’en haut (norma verticalis). Toutes les
têtes qui ont trouvé place dans l'Atlas sont représentées au moins de face et de profil. Nous avons fait
reproduire en outre la face inférieure de quelques-unes des plus importante^. Celles-ci et bon nombre
d'antres ont été dessinées de grandeur naturelle ; mais pour pouvoir multiplier les figures nous avons fait
ramener à la demi-grandeur celles qui nous ont paru pouvoir le mieux supporter cette réduction.
La répartition des planches dont nous pouvions disposer avait été arrêtée dès le principe, d après le
nombre et l’importance des raoes se rattachant aux types fossiles ou actuels. Cette répartition a été maintenue.
Les hommes quaternaires comme les Noirs, les Jaunes et les Blancs de 1 ère présente occupent dans
notre atlas une placé;à bien peu près proportionnée à leur valeur anthropologique relative.
Il n’ïfiîést pas de même pour le texte. Ici la part faite aux divers groupes ethniques, çst fort inégale.
C’est un défaut que nous ne cherchons pas à dissimuler, mais quiétaiTà peu près inévitable. Nous
avions biep pressenti, dès ledébut, que nbjjsserions pris^de.court et forcés de sacrifier une partie des
■sujets compris dans notre cadre. Mais nous n’en crûmes pas. mpins devoir traiter avec détail peux |jie
leur intérêt supérieur nous avait conduit à aborder les premiers.
A ce titre nous ne pouvons regretter l’espace accordé à la description des tètes osseuses f p ^ ^ ^ b ie p
qne cette étude occupe à elle s e u lê ^ |s ^ u tiers de notre volump. 11 était évidemment nécessaire, surtout
à l’époque où ont paru nos preinières livraisons, de décrire avèc détail chaoune de ces têtes, qu Q R 9
fussent entières onfreprésentées seulement par des fragments. Pour comprendre ceUe.nécessité, il suffit
de se rappeler combien étaient vives les discussions s,opleyées par l’examen de quelques-unes de ces pièces
isolées et incomplètèspomme la mâchoire de la Naulette.
Après, avoir terminé l’étude des races fossiles^; nous avons dû nous demander pi no,us aborderions
l’examen .des populations qui, grâce à leur intelligence, ont joué et jouent pupore dans te monde un
ride prépondérant, ,oû biém si nous npus . occuperions dlabord de leurs soeurs restées au'plus ,b#p, ,do
l’échelle des civilisations. Nous nous sommes décidés en faveur de ces dernières, pour un motif facile à
comprendre. En procédant ainsi, nous teoüyious tout d'abord devant nous tes,pac^ jiègr1es asiatique^ et
m élan é sien n e s',,.c’est-à-dire des races fort peu connues encore au point de vue crânjologique, et ppur l’é tude
desquelles nous possédions de nombreux et importants matériaux. Non,^débutions ainsi par un ensemble
deuuestions très intéressantes queggps savions, pouvoir résoudre, et qui^ B aussi, méritaient d être
traitées avec détail. Nous commençâmes donc l^gjjjp des. races actuelles par l’examen des plus inférieures,.
Nous ne pouvons nous.repentir d’avoir agi; mais peut-être a v o n s -i^ ttté quelque peu .entraînés par
l’attrait du sujet. Puis, arrivés aux races nègres africaines, nous nous sommes laissés aller à une tendance
bien naturelle- Tout en cherchaiji, nous restreindre, il nous a paru indispensable de rendre cette étude
à peu près comparable à la précédente.
Nous avons dû abréger ce que nous aurions eu à dire sur les races jaune et blanche. Toutefois,
l’abréviation existe plutôt dans la forme que dans lg fond. Nous avons conservé autant que possible les
chiffres et les tableaux; nous avons rejeté dans les notes imprimées en plus petit caractère, un grand nombre
de documents du genre de ceux qui avaient jusque-là pris place dans le texte. Il résulte de ces dispositions,
que cette partie de notre livre est plus aride, plus difficile à lire et à étudier, mais qu elle n est
pas beaucoup moins complète que la précédente.
C’est ici d’ailleurs que se fait sentir l’utilité de la juste part faite à chaque groupe de races dans l’Atlas.
Les figures représentant des têtes mongoliques, malaises, américaines et caucasiques suppléent en grande
partie à ce qui peut manquer dans le texte au point de vue descriptif.
On voit par ce qui précède, que les trois types fondamentaux de l’humanité nous ont fourni nos grandes
divisions. Les races appartenant à chacun d’eux ont ensuite été réunies en groupes déterminés par les
indices céphaliques horizontaux. Quant a ceux-ci, nous avons admis les divisions graduées proposées par
Broca.
L’importance de l’indice horizontal, son utilité pour l’établissement des premières divisions des races se
rattachant aux trois types primaires ressortent d’une manière remarquable de cette étude. A peu près
constamment, nous avons constaté que les variations de cet indice s’accompagnaient de modifications plus
ou moins accusées dans les autres traits carastéristiques du crâne et de la face.
Presque toujours aussi, malgré ce qu’a de systématique; au fond, une classification fondée uniquement
sur les caractères de la tête osseuse, il s’est trouvé que notre répartition coïncidait avec le groupement auquel
conduit la prise en considération méthodique de tous les caractères.
L’étude de la tête osseuse permet donp à elle seule de distinguer dans l’immense majorité des cas les
divers éléments ethniques qui entrent dans la composition d’une population donnée. Ce résultat général
est un de ceux auxquels nous attachons le plus d’importance et qui nous paraît prêter à quelques-unes
des applications les plus utiles.
Considérer à priori comme de même race un nombre quelconque de têtes osseuses, par cela seul
qu elles sont de même provenance; en dresser le tableau et chercher sans plus de critique la moyenne des
caractères, ce n est pas faire de l’ethnologie ; c’est tomber dans la démographie et s’exposer par conséquent
à de graves erreurs. Chacun peut comprendre combien seraient éloignés de la vérité des résultats
acquis par cette façon d agir appliquée aux colonies où se sont mêlées les races blanches, nègres et américaines.
Or, ce quel on ne saurait nier à propos de nos colonies est bien souvent égalementvrai quand il s’agit de
populations restées à l état sauvage et en apparence isolées. Avant l’intervention des Européens, les races
humaines se sont bien plus mêlées qu’on ne l’a généralement cru. Reconnaître ces mélanges ethniques, en
préciser les éléments par la détermination des types crâniologiques, a toujours été une de nos plus constantes
préoccupations, et quelques-unes des conclusions auxquelles nous a conduit cette étude nous semblent
dignes d’intérêt.
La plupart des matériaux des Crania Ethnica ont été recueillis par nous dans la galerie anthropologique
du Muséum; mais quelque riche qu’elle soit, nous n’avons pas borné nos études à celles des objets qu’elle
renferme. Nous avons mis à contribution le musée de la Société d’Anthropologie de Paris, et celui de
■ ^u Val-de-Grace qui renferment un certain nombre de pièces importantes. Nous avons en outre
étudié avec soin quelques-uns des musées de nos départements, ainsi que les principaux musées de l’étranger.
Parmi les musées de province, nous citerons ceux de Caen et de Lyon; parmi les musées étrangers,
ceux de Suède, d’Angleterre, de Belgique, de Danemark, de Hollande, d’Italie, etc. Nous avons reçu de
MM. Lortet, Deslongchamps, von Düben, G. Retzius, Flower, Ed. Dupon*, Schmidt, Boogardt, Mantegazza,
Bogdanow, etc., directeurs de ces divers établissements, le concours le plus cordial et le plus empressé,
soit qu ils nous aient libéralement ouvert leurs galeries lorsque nous nous trouvions sur les lieux,
oit qu ils nous aient confié des pièces parfois très précieuses, pour que nous pussions les étudier à loisir.^
Nous leur en exprimons ici toute notre gratitude.
m a té ria ^ S*m^ es Particuliers nous ont rendu des services analogues en mettant ànotrè disposition des
c lié aUXft 6 *raVa^ *eurs collections personnelles ; nous citerons en première ligne nos regrettés
-gués loca, J.-B. Davis, Fuzier, puis MM. Prüner-Bey, Ernest Martin, L. Lartet, Chaplain-Duparc,