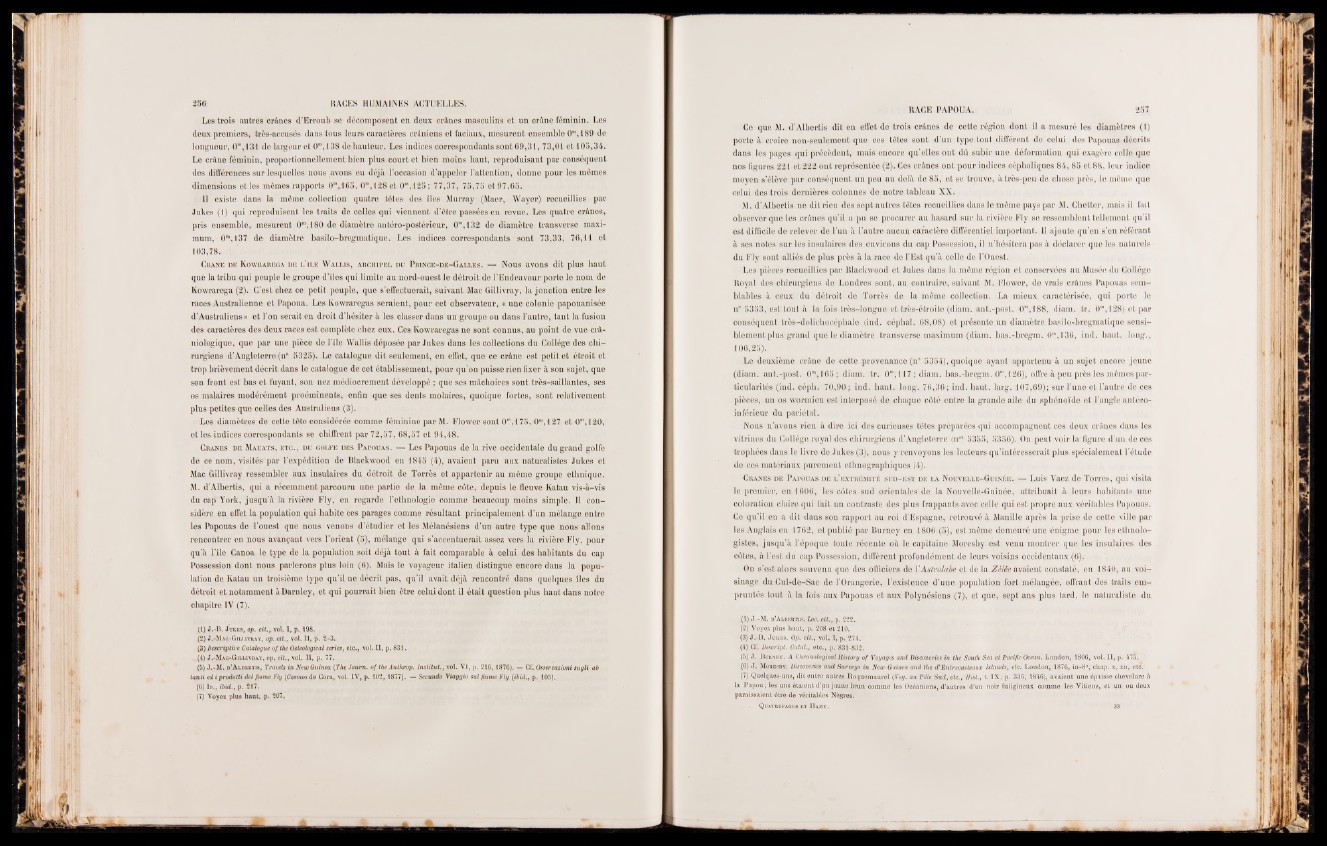
Les trois autres orânes d’Erroub se décomposent en deux crânes masculins et un orâne féminin. Les
deux premiers, très-acousés dans tous leurs caraotères orâniens et faoiaux, mesurent ensemble 0™, 189 de
longueur, 0'",131 de largeur et 0“, 138 de hauteur. Les indioes correspondants sont 69,31, 73,01 et 105,34.
Le crâne féminin, proportionnellement bien plus oourt et bien moins haut, reproduisant par conséquent
dos différences sur lesquelles nous avons eu déjà roooasion d’appeler l’attention, donne pour les mômes
dimensions et les mêmes rapports 0u',i65, 0'“,128 et 0“',125; 77,37, 75,75 et 97,65.
11 existe dans la môme collection quatre têtes des îles Murray (Maer, Wayer) reouoilUes par
Jukes (1) qui reproduisent les traits de celles qui viennent d’ôtre passées eu revue. Les quatre crânes,
pris ensem ble, mesurent 0m,180 de diamètre antéro-postérieur, 0"\132 de diamètre transverse maximum,
0m, 137 de diamètre basilo-bregmatique. Les indices correspondants sont 73,33, 76,11 et
103,78.
Crâne de Kowrarega de l’ile Wallis, archipel du Prince- de-G alles. — Nous avons dit plus haut
que la tribu qui peuple le groupe d’iles qui limite au nord-ouest le détroit de l’Endeavour porte le nom de
Kowrarega (2). C’est ohez oe petit peuple, que s’effectuerait, suivant Mac Gillivray, la jonotion entre les
raoes Australienne et Papoua. Les lvowraregas seraient, pour cet observateur, « une colonie papouanisée
d’Australiens » et l’on serait en droit d’hésiter à les olasser dans un groupe ou dans l’autre, tant la fusion
des caractères des deux races est oomplète chez eux. Ces lvowraregas ne sont connus, au point de vue orâ-
niologique, que par une pièce de l’ile Wallis déposée par Jukes dans les collections du Collège des chirurgiens
d’Angleterre (n° 5325). Le catalogue dit seulement, en effet, que oe orâne est petit et étroit et
trop brièvement décrit dans le oatalogue de oet établissement, pour qu'on puisse rien fixer à son sujet, que
son front est bas et fuyant, son nez médioorcment développé ; que ses mâohoires sont très-saillantes, ses
os malaires modérément proéminents, enfin que ses dents molaires, quoique fortes, sont relativement
plus petites que celles des Australiens (3).
Les diamètres de cette tête considérée oomme féminine par M. Flower sont 0"',175, 0m,127 et 0m,120,
et les indices correspondants se ohiffrent par 72,57, 68,57 et 94,48.
Crânes de Mauats, etc., du golfe des Papouas. — Les Papouas de la rive occidentale du grand golfe
de oe nom, visités par l'expédition de Blackwood en 1845 (4), avaient paru aux naturalistes Jukes et
Mac Gillivray ressembler aux insulaires du détroit de Torrès et appartenir au môme groupe ethnique.
M. d’Albertis, qui a récemment paroouru une partie de. la même côte, depuis le fleuve Katau vis-à-vis
du oap York, jusqu’à la rivière Fly, en regarde l’ethnologie comme beaucoup moins simple. Il considère
en effet la population qui habite ces parages comme résultant principalement d’un mélange entre
les Papouas de l’ouest que nous venons d’étudier et les Mélanésiens d’un autre type que nous allons
rencontrer en nous avançant vers l’orient (5), mélange qui s’accentuerait assez vers la rivière Fly, pour
qu’à l’ile Canoa le type de la population soit déjà tout à fait comparable à oelui des habitants du cap
Possession dont nous parlerons plus loin (6). Mais le voyageur italien distingue encore dans la population
de Katau un troisième type qu’il ne décrit pas, qu’il avait déjà rencontré dans quelques îles du
détroit et notamment àDarnley, et qui pourrait bien être celui dont il était question plus haut dans notre
ohapitre IY (7).
(1) J.-B. Jures, op. cil., vol. I, p. 193.
(2) J.-Mac-Giluvray, op. cil., vol. H, p. 2-3.
(3) Desciiptive Catalogue of the Osteological sériés, etc., vol. II, p. 831.
i (4) J.-Mag-Gilliyray, op. c»L, vol. II, p. 77.
(5) J.-M. d'A ujkrtis, Travels in New Guinea (The Journ. of the Anlhrop. Institut., vol. VI, p. 216, 1876). — CI'. Osservaxioni sugli ab
tanti ed iprodotti del fiutne Fig {Cosmos de Cora, vol. IV, p. 102, 1877). — Secundo Viaggio sul fiume Fly (ibùl., p. 103).
(6) § 1 »Md., p. 217.
(7) Voye« plus haut, p. 207.
Ce que M. d’Albertis dit en effet do trois orânes de cette région dont il a mesuré les diamètres (1)
porte à croire non-seulement que oos têtes sont d’un type tout différent de oelui des Papouas déorits
dans les pages qui précèdent, mais enoore qu’elles ont dû subir uno déformation qui exagère celle que
nos figures 221 et 222 ont représentée (2). Ces crânes ont pour indices céphaliques 84, 85 et 88, leur indice
moyen s’élève par conséquent un peu au delà de 85, et se trouve, à très-peu de chose près, le même que
oelui des trois dernières oolonnes do notre tableau XX.
M. d’Albertis ne dit rien des sept autres têtes recueillies dans le môme pays par M. Chetter, mais il fait
observer que les orânes qu’il a pu so procurer au hasard sur la rivière Fly se ressemblent tellement qu’il
est difficile de relever de l’un à l’autre aucun caractère différentiel important. Il ajoute qu’en s’en référant
à ses notes sur les insulaires des environs du cap Possession, il n’hésitera pas à déclarer que les naturels
du Fly sont alliés de plus près à la raoe de l’Est qu’à oolle do l’Ouest.
Los pièces recueillies par Blackwood et Jukes dans la même région et conservées au Musée du Collège
Royal des chirurgiens de Londres sont, au contraire, suivant M. Flower, de vrais crânes Papouas semblables
à ceux du détroit de Torrès de la môme collection. La mieux caractérisée, qui porto le
n° 5353, est tout à la fois très-longue et très-étroite (diam. ant.-post. 0m,188, diam. tr. 01 2 3 * 5 6 7",.128) et par
conséquent très-dolichocéphale (ind. céphal. 68,08) et présente un diamètre basilo-bregmatique sensiblement
plus grand que le diamètre transverse maximum (diam. bas.-bregm. 0IU,136, ind. haut, long.,
106,25).
Le deuxième crâne de cette provenance (n° 5354), quoique ayant appartenu à un sujet encore jeune
(diam. ant.-post. 0m,165; diam. tr. 0“, I17 ; diam. bas.-bregm. O™, 126), offre à peu près les mômes particularités
(ind. céph. 70,90; ind. haut. long. 76,36; ind. haut. larg. 107,69); sur l’une et l’autre de ces
pièces, un os wormien est interposé de chaque côté entre la grande aile du sphénoïde et l’angle antéro-
inférieur du pariétal.
Nous n'avons rien à dire ioi des curieuses têtes préparées qui aocompagnent ces deux crânes dans les
vitrines du Collège royal dos chirurgiens d’Angleterre (n°* 5355, 5356). On peut voir la figure d’un de oes
trophées dans le livre de Jukes (3), nous y renvoyons les lecteurs qu’intéresserait plus spécialement l’étude
de ces matériaux purement clhnographiques (4).
Crânes de Papouas de l’extrémité sud- est de la Nouvelle-G uinée. — Luis Vaez de Torrès, qui visita
le premier, en 1606, les oôtes sud orientales de la Nouvelle-Guinée, attribuait à leurs habitants une
ooloration claire qui fait un contraste des plus frappants avec celle qui est propre aux véritables Papouas.
Ce qu’il en a dit dans son rapport au roi d’Espagne, retrouvé à Manille après la prise de cette ville par
les Anglais en 1762, et publié par Burney en 1806 (5), est môme demeuré une énigme pour les cthnolo-
gistes, jusqu’à l’époque toute réoente oà le capitaine Moresby est venu montrer que les insulaires des
oôtes, à l’est du cap Possession, diffèrent profondément do leurs voisins occidentaux (6).
On s’est alors souvenu que des ofüoiers de Y Astrolabe et de la Zélée avaient constaté, en 1840, au voisinage
du Cul-de-Sao de l’Orangerie, l ’existence d’une population fort mélangée, offrant des traits empruntés
tout à la fois aux Papouas et aux Polynésiens (7), et que, sept ans plus tard, le naturaliste du
(1) J.-M. d’Alubrtis. Loc. cit., p. 222.
(2) Voyez plus haut, p. 208 et 210.
(8) J.-B. J ures. Op. cit., vol. 1, p. 274.
(4) | | Desoript. Datai., eto., p. 831-832.
(5) J. Burney. A Chronologiml History of Voyages and Discoveries -tu the South Sea et Pacific Océan. London, 4806, vol. II, p. 475.
(6) J. Moresby. Discom'ies and Suruoys in New-Guinea and the d’Entrecasteaux Islande, etc. London, 4876, in-8°, chap. x, xu, etc.
(7) Quelques-uns, dit entre autres Roquemaurel {Voy. au Pôle Sud, etc., Ilist., t. IX, p. 336, 1846), avaient une épaisse chevelure à
la Papou ; les uns étaient d'un jaune brun comme les Océaniens, d’autres d’un noir fuligineux comme les Vitiens, et un ou deux
paraissaient être de véritables Nègres.
. Quai ET I I aMY.