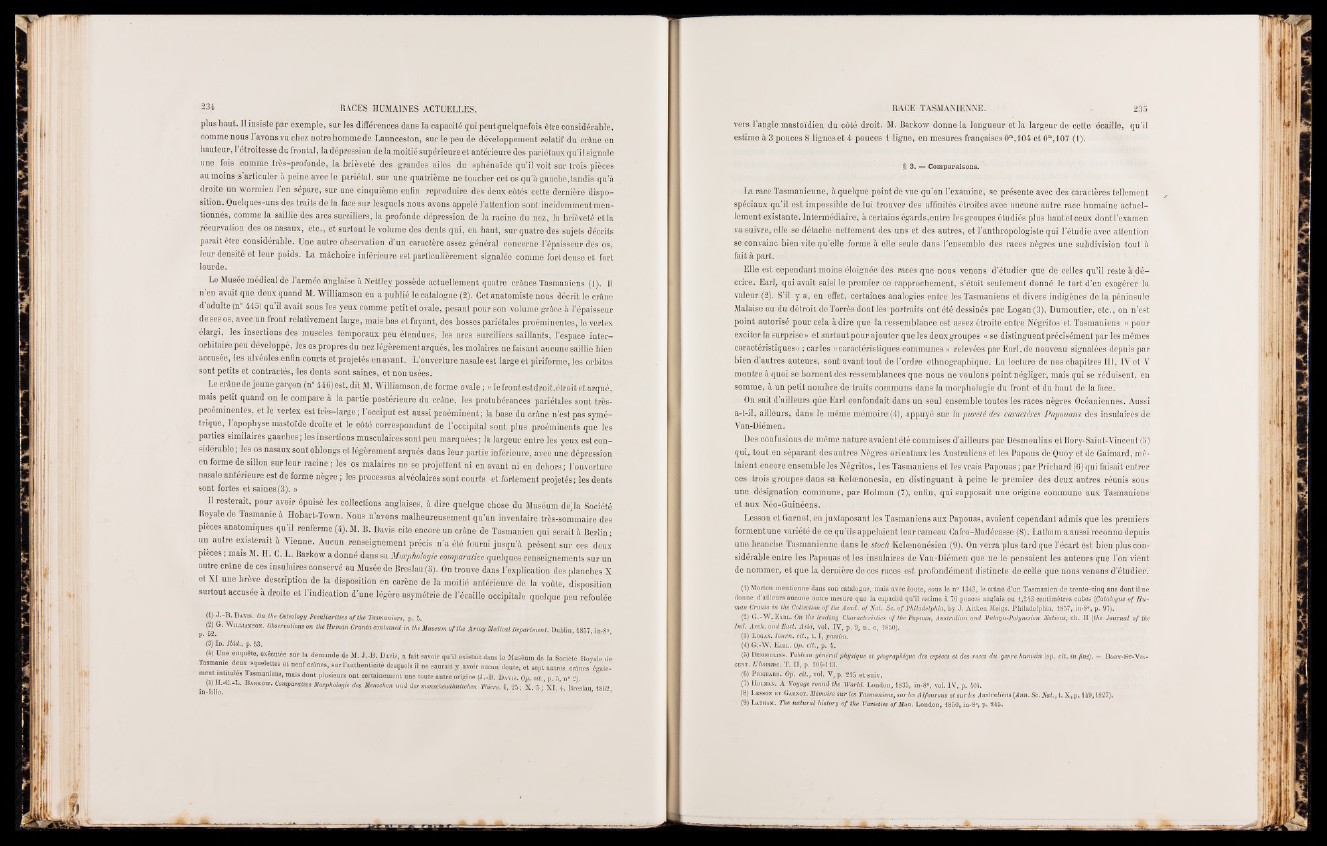
plus haut. Il insiste par exemple, sur les différences dans la capacité qui peut quelquefois être considérable,
comme nous 1 avons vu chez notre homme de Launceston, sur le peu de développement relatif du crâne en
hauteur, 1 étroitesse du frontal, la dépression de la moitié supérieure et antérieure des pariétaux qu’il signale
une fois comme très-profonde, la brièveté des grandes ailes du sphénoïde qu’il voit sur trois pièces
au moins ,s articuler à peine avec le pariétal, sur une quatrième ne toucher cet os qu’à gauche,tandis qu’à
droite un wormien l’en sépare, sur une cinquième enfin reproduire des deux côtés cette dernière disposition.
Quelques-uns des traits de la face sur lesquels nous avons appelé l’attention sont incidemment mentionnés,
comme la saillie des arcs surciliers, la profonde dépression de la racine du nez, la brièveté et la
récurvation des os nasaux, etc., et surtout le volume des dents qui, en haut, sur quatre des sujets décrits
paraît être considérable. Une autre observation d’un caractère assez général concerne l’épaisseur des os,
leur densité et leur poids. La mâchoire inférieure est particulièrement signalée comme fort dense et fort
lourde.
Le Musée médical de 1 armée Anglaise à Nettley possède actuellement quatre crânes Tasmaniens (1). Il
n en avait que deux quand M. Williamson en a publié le catalogue (2). Cet anatomiste nous décrit le crâne
d adulte (n° 445) qu il avait sous les yeux comme petit et ovale, .p.esant pour son volume grâce à l’épaisseur
de ses os, avec un front relativement large, mais bas et fuyant, des bosses pariétales proéminentes, le vertex
élargi, les insertions des muscles temporaux peu étendues, les arcs surciliers saillants, l’espace interorbitaire
peu développé, les os propres du nez légèrement arqués, les molaires ne faisant aucune saillie bien
accusée, les alvéoles enfin courts et projetés en avant. L’ouverture nasale est large et piriforme, les orbites
sont petits et contractés, les dents sont saines, et non usées.
Le crâne de jeune garçon (n° 446) est, dit M. Williamson,de forme ovale | « le front est droit, étroit et arqué,
mais petit quand on le compare à la partie postérieure du crâne, les protubérances pariétales sont très-
proéminentes, et le vertex est très-large; l’occiput est aussi proéminent; la base du crâne n’est pas symétrique,
l’apophyse mastoïde droite et le côté correspondant de l’occipital sont plus proéminents que les
parties" similaires gauches ; les insertions musculaires sont peu marquées ; la largeur entre les yeux est considérable;
les os nasaux sont oblongs et légèrement arqués dans leur partie inférieure, avec une dépression
en forme de sillon sur leur racine ; les os malaires ne se projettent ni en avant ni en dehors; l’ouverture
nasale antérieure est de forme nègre ; les processus alvéolaires sont courts et fortement projetés; les dents
sont fortes et saines (3). » .
Il resterait, pour avoir épuisé les collections anglaises, à dire quelque chose du Muséum de’la Société
Royale de Tasmanie à Hobart-Town. Nous n’avons malheureusement qu'un inventaire très-sommaire des
pièces anatomiques qu il renferme (4). M. B. Davis cite encore un crâne de Tasmanien qui serait à Berlin ;
un autre existerait à Vienne. Aucun renseignement précis n’a été fourni jusqu’à présent sur ces deux
pièces ; mais M. H. C. L. Barkow a donné dans sa Morphologie comparcUme quelques renseignements sur un
autre crâne de ces insulaires conservé au Musée de Breslau (S). On trouve dans l’explication des planches X
et XI une brève description de la disposition eh carène de la moitié antérieure "äh la voûte, disposition
surtout accusée à droite et l’indication d’une légère asymétrie de l’écaille occipitale quelque peu refoulée
(1) J.-B. Davis. On the Osteology Peculiarilies ofthe Tasmaniars, p. 5.
p « G’ W,LL1“ 'S0S- f i Human Crama conlamcd in lhe Muséum ofthe Arma Medical Department. Dublin, 1857, in-S",
(3) Id. Ibid., p. 53.
(4) Une enquête, exécutée sur la demande de M. J.-B. Davis, a fait savoir qu’il existait dans le Muséum de la Société Royale de
Tasmanie deux squelettes et neuf crânes, sur l’authenticité desquels il ne saurait y avoir aucun doute, et sept autres crânes également
intitulés Tasmaniens, mais dont plusieurs .ont certainement une toute autre origine (J.-B. Davis. Op. oit., p., 5, n° 2).
(5) H.-C.-L. B arkow. Comparative Morphologie des Menschen und der menschenähnlichen Thiere. I, 25- X 5 - XI 4 Breslau 1862
in-folio. ’ ’ ‘ ’ ’ »
vers l'angle mastoïdien du côté droit. M. Barkow donne la longueur et la largeur de cette écaille, qu’il
estime à 3 pouces 8 lignes et 4 pouces 1 ligne, en mesures françaises 0m,104 et 0m,107 (1).
§ 3. — Comparaisons.
La race Tasmanienne, à quelque point de vue qu’on l’examine, se présente avec des caractères tellement
spéciaux qu’il est impossible de lui trouver dès affinités étroites avec aucune autre race humaine actuellement
existante. Intermédiaire, à certains égards,entre les groupes étudiés plus hautetceux dontl’examen
va suivre, elle se détache nettement des uns et des autres, et l’anthropologiste qui l’étudie avec attention
se convainc: bien vite qu’elle forme à elle seule dans Tensemble des races nègres une subdivision tout à
fait à part.
Elle est cependant moins éloignée des races que nous venons d’étudier que de celles qu’il reste à ’dé^
crire. Earl, qui avait saisi le;premier ce rapprochement, s’était seulement donné le tort d’en exagérer la
valeur (2). S’il y a, en effet, certaines analogies entre les Tasmaniens et divers indigènes de la péninsule
Malaise ou du détroit deTorrès dont les portraits ont été dessinés par Logan(3), Dumoutier, etc., on n’est
point autorisé pour cela à dire que la ressemblance est assez étroite entre Négritos'et Tasmaniens « pour
exciter la surprise » et surtout pour ajouter que les deux groupes «se distinguent précisément par les mêmes
caractéristiques» ; caries «caractéristiques communes » relevées par Earl,de nouveau signalées depuis par
bien d’autres auteurs, sont avant tout de l’ordre ethnographique. La lëctüre de nos chapitres III, IY et Y
montre à quoi se bornent des ressemblances que nous ne voulons point négliger, mais qui se réduisent, en
somme, à un petit nombre de traits communs dans la morphologie du front et du haut de la face.
On sait d’ailleurs que Earl confondait dans un seul ensemble toutes les races nègres Océaniennes. Aussi
a-t-il, ailleurs, dans le même mémoire (4), appuyé sur la pureté des caractères Papouans des insulaires de
Van-Diémen.
Des confusions de même nature avaient été commises d’ailleurs par Desmoulins et Bory-Saint-Vincent (5)
qui, tout en séparant des autres Nègres orientaux les Australiens et les Papous de Quoy et de Gaimard, mêlaient
encore ensemble les Négritos, les Tasmaniens et les vrais Papouas;par Prichard (6) qui faisait entrer
ces trois groupes dans sa Keloenonesia, en distinguant à peine le premier des deux autres réunis sous
une désignation commune, par Holman (7), enfin, qui supposait une origine commune aux Tasmaniens'
et aux Néo-Guinéens.
Lesson et Garnot, en juxtaposant les Tasmaniens aux Papouas, avaient cependant admis que les premiers '
forment une variété de ce qu’ils appelaient leur rameau Cafro-Madécasse (8). Latham a aussi reconnu depuis
une branche Tasmanienne dans le stock Keloenonésien (9). On verra plus tard que l’écart est bien plus considérable
entre les Papouas et les insulaires de Van-Diémen que ne le pensaient les auteurs que l’on vient
de nommer, et que la dernière de ces races est profondément distincte de celle que nous venons d’étudier.
’■ ■(1) Morton mentionne dans son catalogne, mais avec doute, sous le n° 1343, ,1^ crâne d’un Tasmanien de trente-cinq ans dont il ne
donne d’ailleurs aucune autre mesure que la capacilé qu’il estime à 76 pouces anglais ou 1,243 centimètres-cubes (Catalogue of Hu-
man Crania in the Collection of the Acad, of Nat. Sc. of Philadelphia, by J. Aitken Meigs. Philadelphia, 1857, in-8°, p. 97).
(2) G.-W. E arl. On the leading Charactenstics ofthe Papuan, Auslralian and Malayu-Polynesian Nations, ch. I l (the Journal of the
Ind. Arch. and East. A sia, vol. IY, p. 9, n., c, 1850). •
(3) Loqan. Journ. cit., 1.1, passim.
(4) G.-W. Earl. Op. cit., p. 4.
(5) Desmoulins. Tableau général physique et géographique des espèces et des races du genre humain (op. cit. in fine). — Bory-St-Vi.\-
cent. L’homme. T. Il, p. 106-113.
(6) Prichard. Op. cit., vol. Y, p. 215 et suiv.
(7) Holman. A Voyage round the World. London; 1835, in-S°, vol. IV, p. 404.
(8) Lesson et Garnot. Mémoire sur les Tasmaniens, sur les Alfourous et sur les Australiens (Ann. Sc. Nat., t. X, p. 149,1827).
(9) Latham. The natural history of the Varieties of Man. London, 1850, in-8°, p. 245.