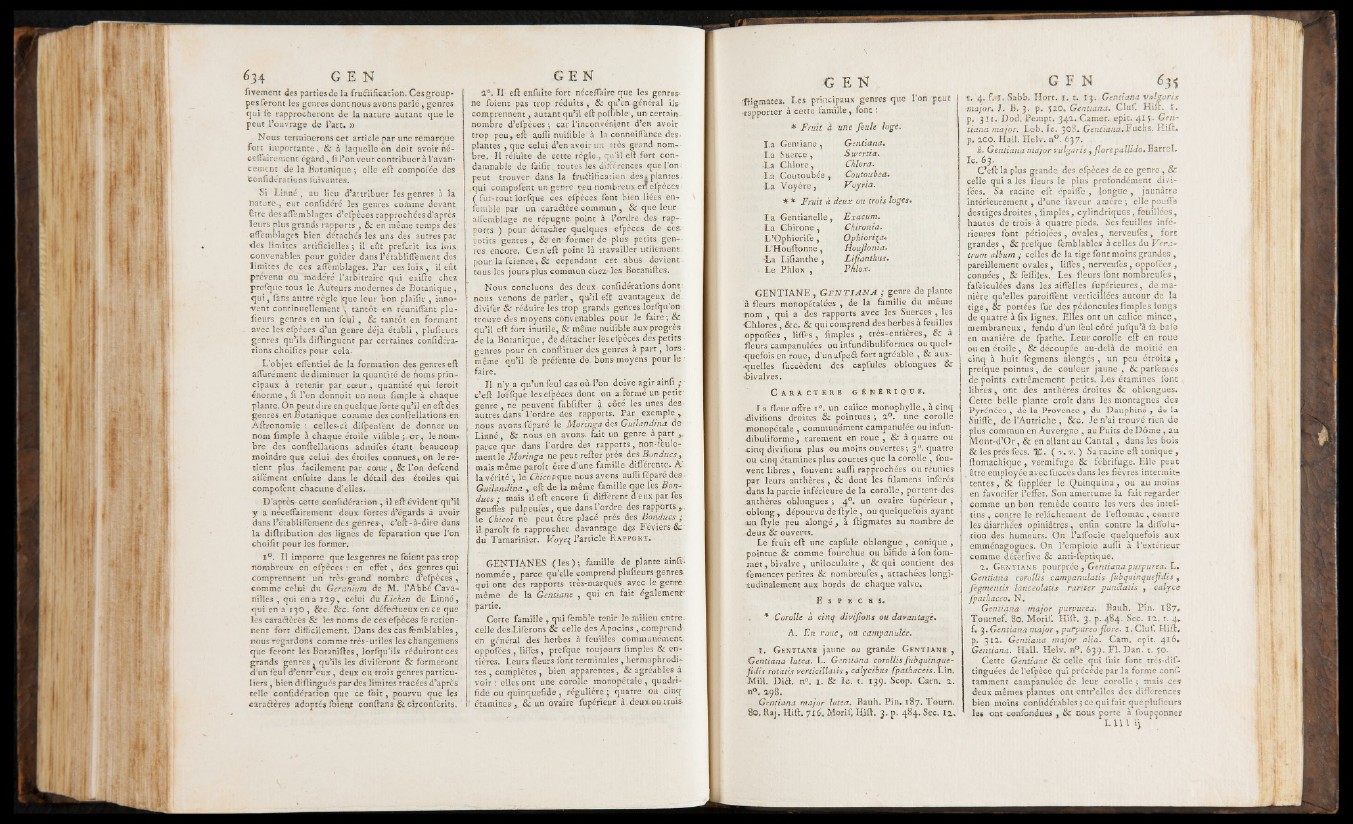
fivement des parties de la fruétifîcation. Cesgroup-
pes feront les genres dont nous avons parlé - genres
qui fe rapprocheront de la nature autant que le
peut l’ouvrage de Part. »
Nous terminerons cet article par une remarque
fort importante, & à laquelle on doit avoir né-
ceffairement égard, fi l’on veut contribuer à l’avancement
de la Botanique ; elle eft compofée des
fconfidérations fuivantes.
Si Linné, au lieu d’attribuer les genres à la
nature-, eut confidéré les genres comme devant
Être desaffemblages d’efpèces rapprochées d’après
leurs plus grands rapports , & en môme temps des
affemblageS bien détachés les uns des autres par
■ des limites artificielles ; il eût prefcrit les loix
convenables pour guider dans l’ établiffement des
limites de ces affemblages. Par ces loix , il eût
prévenu ou'nïodçré l’arbitraire qui exifte chez
prefque tous le Auteurs modernes de Botanique ,
q ui, fans autre règleVjue leur bon.plàifir , innovent
continuellement \ tantôt en réunifiant plu-
fieurs genres en un féiil , 8c tantôt en formant
- avec les efpèces d’un genre déjà établi , plufieurs
genres qu’ils diftinguent par certaines confidéra-
tions choifies pour cela.
L’objet, eflentiel de la formation des genres eft
afiurément de diminuer la quantité de noms principaux
à retenir par coeur:, quantité qui feroit
énorme, fi l’on donnoit un nom fimple à chaque
plante. On peut dire en quelque forte qu’il en eft des
genres en Botanique comme des conftellations en
Aftronomie : celles-ci^ difpenlent de donner un
nom fimple à chaque étoile vifible j.or*, le nombre
des conftellations admifes étant beaucoup
moindre que celui des étoiles connues, on le retient
plus facilement par coeur , & l ’on defcend
aifément enfuite dans le détail des étoiles qui
compofent chacune d’elles..
D ’après- cette confidération , il eft évident'qu’il
y a nécefiairement deux- fortes d’égards- à avoir
dans l’établiffement des genres*, c’èft-à-dire dans
la diftribution des lignes de féparation que Bon
choifit pour les former.
1°. Il importe que les genres ne fôïent pas trop
nombreux en efpèces : en e ffet, des genres qui
comprennent un très-grand nombre d’efpèeés ,
comme celui du Géranium de M. l’Abbé Cava-
nilles , qui en a 12.9* ceJùi du Lichen de Linné,
qui en a iyo , &c. &c. font défeélueoxen ce que
les cara&crês 8c les noms de ces efpèces fé retiennent
fort difficilement. Dans des cas fèmblables,
nous regardons comme très-utiles les changemens
que feront les Botaniftes, lorfqu’ils réduiront ces
grands genres .q u ’ils les dlviferont & formeront
d ’un feul d’entr’eux, deux ou trois genres particuliers
, bien diftingués par des limites tracées d’après
telle confidération que ce fo it , pourvu que les
caraâères adoptés foiei\t conftans & circonfcrits.
a0. Il eft enfuite fort nécefiaire que les genres4
ne foient pas trop réduits , & qu’en, général ils
comprennent, autant qu’il eft pofiible;, un certain-
nombre d’elpèces-, car l’inconvénient d’en avoir
trop peu, eft ^ufli nuifible à la connoiflance des-
plantes , que celui d’en avoir un très grand nombre.
■ Il rélulte de cette règle, qu’il eft fort condamnable
de faifir „ toutes lés différences que l’on ;
peut trouver dans la fructification des» plantes,
.qui compofent un genre p.eu nombreux en efpèces
( fur- tout lorfque ces efpèces font bien liées ensemble
par un cara&ère commun , 8c que leur
aflèmblage ne répugne: point à l’ordre des rapports
) pour détacher quelques efpèces de ces.
petits genres, 8é ew former de plus petits genres
encore. Cetn’eft point là travailler utilement
pour la fcience, & cependant cet abus devient ,
tous les jours plus commun chez- les Botaniftes.
-Nous concluons des deux- confidérations dont
nous venons de parler, qu2il eft avantageux de.
divifer 8c réduire les trop grands genres-lorfqu’on
trouve des moyens convenables pour le faire-, &
qu’il eft fort inutile, & môme nuifible aux progrès
de la Botanique, de détacher lés efpèces. des petits
genres* pour en conftituer des genres à part, lors
même qu’il fe. préfente de. bons moyens pour le •
faire.
Il n’y a qu’un feul cas où. l’on doive agir ainfi ;
c’eft loflque lesefpèces dont on a fôrmé un petit-
genre, ne peuvent fubfifter à côté les unes des-
autres dans l ’ordre des rapports. Par exemple >
nous avons féparé le Moringa des Guilandina de
Linné, & nous en avons, fait un genre, à part
parce que dans l ’ordre des rapports, non:feulement
le Moringa ne peut refter près- des Ronducs,
mais même paroît êtred une famille differente. A
la vérité * le Chicotque nous avons aufii féparédes^
Guilandina , eft de-la même famille qye.les Bon-
ducs ; mais il eft encore fi différent d’eux par fes
goufles pulpeufes, que dansl ordre des rapports , .
le Chicot ne peut être placé près des Bon.ducs ;
il. paroît fe rapprocher davantage d$s Feviers&r"
du Tamarinier. Voye\ l’article R apport. *
GENTIANES ( les ) -, famille de plante ainfi:
nommée , parce qu’elle comprend plufieurs genres
qui ont des rapports très-marqués avec, le genre
même de la Gentiane , qui- en fait également;
partie.
Cette famille , qui femble tenir le- milieu entre-
celle des-Liferons & celle des-Apocins , comprend
en général des herbes à feuilles communément,
oppofées , liïïes, prefque toujours fimples & entières.
Leurs fleurs font terminales, hermaphrodites
, complètes , bien apparentes, & agréable® à
voir: elles ont une corolle monopétale, quadri-
• fide ou quinquefide , régulière ; quatre ou cinq
i étamines 8c un ovaire fupérieur à. deux ou-trois-
•fiigmates. Les principaux genres que l'on peut
'«apporter à cette famille, font :
* Fruit à une feule loge.
I,a Gentiane,
•La S'uerce ,
•La Chlore,
•La Coutoubée,
La Voyère ,
Gentiana•
Swertia.
Chlora.
Coutoubea.
Voyria.
* * Fruit à deux ou trois loges.
Xa Gentianelle,
La Chirone ,
L ’Ophiorife,
L ’Houftonne,
•La I.ifianthe ,
Le Phlox,,
Exacum.
Chironia.
Ophiori{a-
Houflonia.
Lifianthus.
Phlox.
GENTIANE , G É N T I A N A ; genre de plante
à fleurs monopétalées , de la famille du même
Tiom , qui a des rapports avec les Suerces , les
-Chlores, &c. & qui comprend des herbes à feuilles
■ oppofées, lifibs , fimples , tres-entieres, 8c à
fleurs campanulées ou infundibuliformes ou quelquefois
en roue, d’un afpeét fort agréable , & auxquelles
fuccèdent des capfules oblongues 8c
«bivalves.
C A R A C T E R E G É N ÉR I Q U E .
La fleur offre i° . un calice monophylle, à cinq
‘divifions droites 8c pointues j 2°. une corolle
monopétale , communément campanulée ou infun-
dibuliforme, rarement en roue , 8c à quatre ou
cinq divifions plus ou moins ouvertes j 30. quatre
ou cinq étamines plus courtes que la corolle, fou-
vent libres , fouvent aufii rapprochées ou réunies
par leurs anthères , & dont les filamens inférés
dans la partie inférieure de la corolle, portent-des
.anthères oblongues -, 40. un ovaire fupérieur ,
oblong, dépourvu de fty lè , ou quelquefois ayant
mn ftyle peu alongé , à ftigmates au nombre de
deux 8c ouverts.
Le fruit eft une capfule oblongue , conique ,
pointue & comme fourchue ou bifide à fon fom-
met, bivalve , uniloculaire, & qui contient des
femences petites & nombreufes , attachées longitudinalement
aux bords de chaque valve.
E s p e c e s .
* Corolle ci cinq divifions ou davantage•
A. En roue y ou campanulée.
i . G en tiane jaune ou grande G en t ian e ,
Gentiana lutea. L. Gentiana cor.ollis fubquinque-
fidis rotatis verticïllatis , calycibus fpathaceis. Lin.
•Mill. Diâ. n°. 1. & Iç. t. 139. Scop. Carn. 2.
n°. 298.
Gentiana major lutea.. Bauh. Pin. 187. Tourn.
8q. Raj, Hift. 716. Morif, Iiift. 3. p. 484. Sec. 12.
t. 4. f.»I. Sabb. Hort. 1. t. 13. Gentiana vulgaris
major. J. B. 3. p. 520. Gentiana. Cluf. Hift. r.
p. 311. Dod. Pempt. 34a. Camer. epit. 415. Gentiana
major. Lob. Ic. 308. Gentiana.F webs. Hift.
p, 2C0. Hall. Helv, n°. 637. 3. Gentiana major vulgaris, florepallido. Barrel.
Ic. 63.
C’eft la plus grande des efpèces de ce genre , 8c
celle qui a les fleurs le plus profondément divi-
fées. Sa racine eft épaifle , longue, jaunâtre
intérieurement, d’ une faveur amère ; elle pouffe
des tiges droites , fimples, cylindriques, feuillées,
hautes de trois-à quatre pieds. Ses feuilles inférieures
font pétiolées , ovales , nerveufès , fort
grandes , & prefque femblabiés’ à celles du Vera-
trum album ; celles de la tige font moins grandes,
pareillement ovales, lifles, nerveufès, oppofées ,
connées , & fefîiles. Les fleurs font nombreufes ,
fafciculées dans les aiffelles fupérieures, de manière
qu’elles paroifiènt verticillées autour de la
tige, 8c portées fur des pédoncules fimples longs
de quatre à fix lignes. Elles ont un calice mince,
membraneux , fendu d’un feul côté jufqu’à fa baie
en manière de fpathe. Leur corolle eft en roue
ou en étoile , & découpée au-delà de moitié en
cinq à huit fegmens alongés , un peu étroits ,
prefque p oin tu sd e couleur jaune , 8c parfemés
de points extrêmement petits. Les étamines font ,
libres, ont des anthères droites 8c oblongues.
Cette belle plante croît dans les montagnes des
Pyrénées , de la Provence , du Dauphiné , de la
Suiffe, de l ’Autriche , & c . Je n’ai trouvé rien de
plus commun en Auvergne , au Puits de Dôme , au
Mont-d’O r , & en allant au Cantal , dans les bois
& les prés fecs. Tp. ( v. v. ) Sa racine eft tonique ,
ftomachique , vermifuge & fébrifuge. Elle peut
. être employée avecfuccès dans les fièvres imermit->
tentes , & fuppléer le Quinquina , ou au moins
en favorifer l’effet. Son amertume la fait regarder
comme un bon remède contre les vers des intef-
tins , contre le relâchement de l ’eftomac, contre
les diarrhées opiniâtres, enfin contre la diffolu-
tion des humeurs. On, l’affocie quelquefois aux
emménagogues. On l ’emploie aufii à l ’extérieur
comme déterfive & anti-feptique.
2. G entiane pourprée , Gentiana purpurea. L.’
Gentiana corollis campanulatis fubquinquefidis ,
fegmentis lanceolatis rariter pundatis , calyce
fpathaceo. N.
Gentiana major purpurea. Bauh. Pin. 187*
Tournef. 80. Morif. Hift. 3. p. 4^4 - ^ec* I2-- r- 4*
f. 3. Gentiana major, purpureo flore. 1. Cluf. Hift.
p. 312. Gentiana major alia. Cam. epit. 416.
Gentiana. Hall. Helv. n°. 639. Fl. Dan. t. 50.
Cette Gentiane 8c celle qui fuit font très-dif-
tinguées de l’efpèce qui précède par la forme confc
tamment campanulée de leur corolle ; mais ces
deux mêmes plantes ont entr’elles des différences
bien moins confidérables j ce qui fait que plufieurs
les ont confondues , & nous porte à foupçonnefl
L l l l ï\