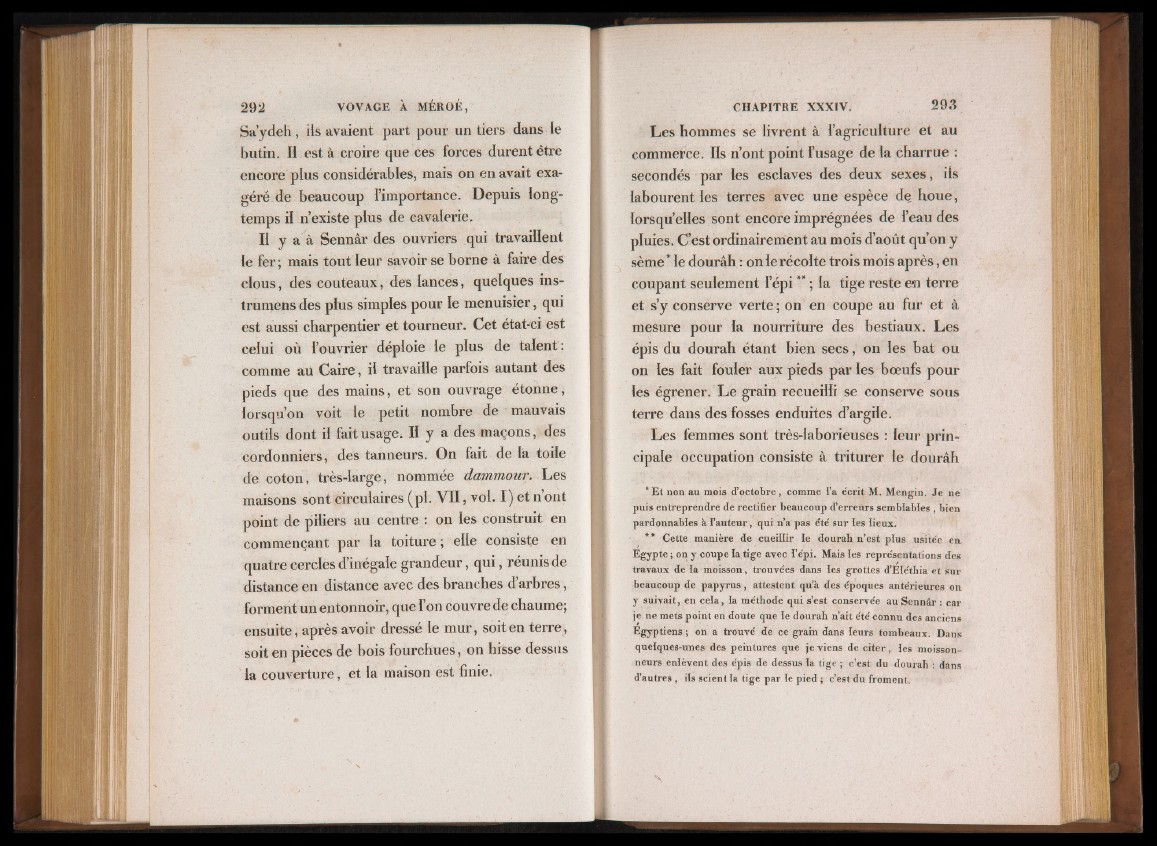
Sa’ydeh , ils avaient part pour un tiers dans le
butin. Il est à croire que ces forces durent être
encore plus considérables, mais on en avait exagéré
de beaucoup l’importance. Depuis longtemps
il n’existe plus de cavalerie.
II y a à Sennâr des ouvriers qui travaillent
le fer; mais tout leur savoir se borne à faire des
clous, des couteaux, des lances, quelques ins-
trunjens des plus simples pour le menuisier, qui
est aussi charpentier et tourneur. Cet état-ci est
celui où l’ouvrier déploie le plus de talent :
comme ail Caire, il travaille parfois autant des
pieds que des mains, et son ouvrage étonne,
lorsqu’on voit le petit nombre de mauvais
outils dont il fait usage, Il y a des maçons, des
cordonniers, des tanneurs. On fait de la toile
de coton, très-large, nommée dammour. Les
maisons sont circulaires (pl. V II, vol. I) et n’ont
point de piliers au centre : on les construit en
commençant par la toiture ; elle consiste en
quatre cercles d’inégale grandeur, qui, réunis de
distance en distance avec des branches d’arbres,
forment un entonnoir, que l’on couvre de chaume;
ensuite, après avoir dressé le mur, soit en terre,
soit en pièces de bois fourchues, on hisse dessus
la couverture, et la maison est finie.
Les hommes se livrent à l’agriculture et au
commerce. Ils n’ont point l’usage de la charrue :
secondés par les esclaves des deux sexes, ils
labourent les terres avec une espèce de houe,
lorsqu’elles sont encore imprégnées de l’eau des
pluies. C’est ordinairement au mois d’août qu’on y
sème* le dourâh : on le récolte trois mois après, en
coupant seulement l’épi ** ; la tige reste en terre
et s’y conserve verte ; on en coupe au fur et à
mesure pour la nourriture des bestiaux. Les
épis du dourah étant bien secs, on les bat ou
on les fait fouler aux pieds par les boeufs pour
les égrener. Le grain recueilli se conserve sous
terre dans des fosses enduites d’argile.
Les femmes sont très-laborieuses : leur principale
occupation consiste à triturer le dourâh
* Et non au mois d’octobre , comme l’a e'crit M. Mengin. Je ne
puis entreprendre de rectifier beaucoup d’erreurs semblables , bien
pardonnables à Fauteur, qui n’a pas été sur les lieux.
* * Cette manière de cueillir le dourab n’est plus usitée en.
Egypte ; on y coupe la tige avec l’épi. Mais les représentations des
travaux de la moisson, trouvées dans les grottes d’Eïéthia et sur
beaucoup de papyrus, attestent qu’à des époques antérieures on
y suivait, en cela, la méthode qui s’est conservée au Sennâr : car
je ne mets point en doute que le dourah n’ait été connu des anciens
Egyptiens ; on a trouvé de ce grain dans leurs tombeaux. Dans
quelques-unes des peintures que je viens de citer, les moissonneurs
enlèvent des épis de dessus la tige ; c’est du dourah : dans
d’autres , ils scient la tige par le pied ; c’est du froment.
%