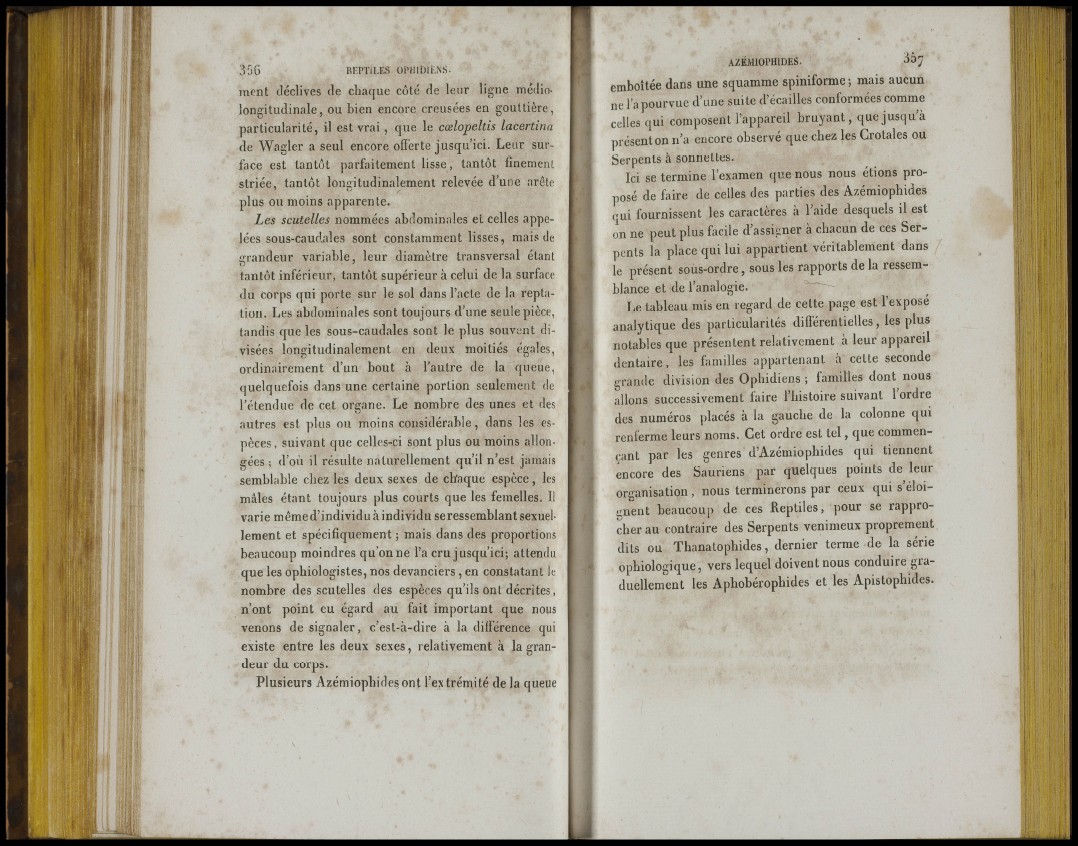
ifiiii.!
i îï
ill
k a
356 REPTILES OPHIDIENS.
ment déclives de chaque côté de leur ligne mediolongitudinale,
ou bien encore creusées en gouttière,
particularité, il est vrai , que le coelopeltis lacertina
de Wagler a seul encore offerte jusqu'ici. Leur surface
est tantôt parfaitement lisse, tantôt finement
striée, tantôt londtudinalement relevée d'une arête
plus ou moins apparente.
Les scutelles nommées abdominales et celles appelées
sous-caudales sont constamment lisses, mais de
izrandeur variable, leur diamètre transversal étant tJ '
tantôt inférieur, tantôt supérieur à celui de la surface
du corps qui porte sur le sol dans l'acte de la reptation.
Les abdominales sont toujours d'une seule pièce,
tandis que les sous-caudales sont le plus souvent divisées
longitudinalement en deux moitiés égales,
ordinairement d'un bout à l'autre de la queue,
quelquefois dans une certaine portion seulement de
rétendue de cet organe. Le nombre des unes et des
autres est plus ou moins considérable, dans les espèces,
suivant que celles-ci sont plus ou moins allongées
; d'où il résulte naturellement qu'il n'est jamais
semblable chez les deux sexes de chaque espèce, les
mâles étant toujours plus courts que les femelles. Il
varie même d'individu à individu se ressemblant sexuellement
et spécifiquement ; mais dans des proportions
beaucoup moindres qu'on ne l'a cru jusqu'ici; attendu
que les ophiologistes, nos devanciers , en constatant le
nombre des scutelles des espèces qu'ils ont décrites,
n'ont point eu égard au fait important que nous
venons de signaler, c'est-à-dire à la différence qui
existe entre les deux sexes, relativement à la grandeur
du corps.
Plusieurs Azémiopbidesont l'extrémité de la queue
m
AZÉMIOPHIDES.
emboîtée dans une squamme spiniforme ; mais aucun
ne l'a pourvue d'une suite d'écaillés conformées comme
celles qui composent l'appareil bruyant, que jusqu'à
présent on n'a encore observé que chez les Crotales ou
Serpents à sonnettes.
Ici se termine l'examen que nous nous étions proposé
de faire de celles des parties des Azémiopbides
cui fournissent les caractères à l'aide desquels il est
on ne peut plus facile d'assigner à chacun de ces Serpents
la place qui lui appartient véritablement dans ï
le présent sous-ordre, sous les rapports de la ressemblance
et de l'analogie.
Le tableau mis en regard de cette page est l'exposé
analytique des particularités différentielles, les plus
notables que présentent relativement à leur appareil
dentaire, les familles appartenant à cette seconde
grande division des Ophidiens ; familles dont nous
allons successivement faire l'histoire suivant l'ordre
des numéros placés à la gauche de la colonne qui
renferme leurs noms. Cet ordre est tel , que commençant
par les genres d'Azémiophides qui tiennent
encore des Sauriens par quelques points de leur
organisation, nous terminerons par ceux qui s'éloignent
beaucoup de ces Heptiles, pour se rapprocher
au contraire des Serpents venimeux proprement
dits ou Thanatophides, dernier terme de la série
ophiologique, vers lequel doivent nous conduire graduellement
les Aphobérophides et les Apistophides.
M
iil '