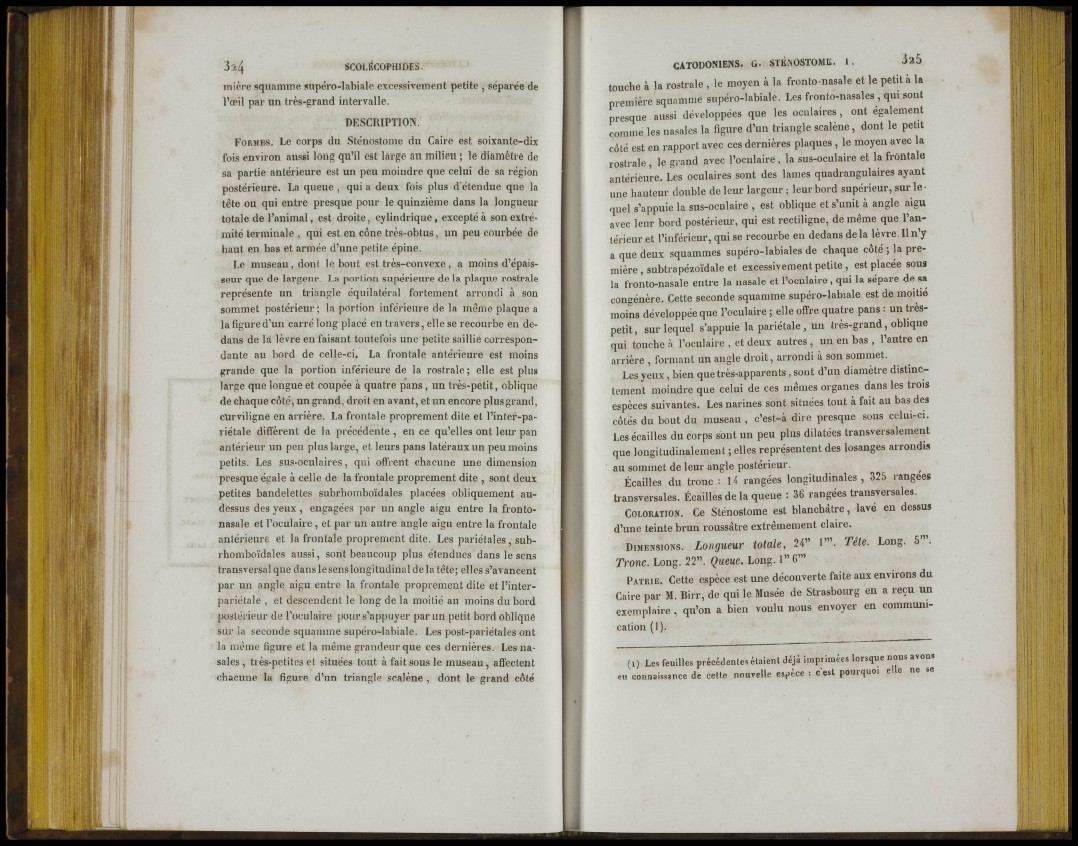
i
I î
lì
m.
Hi
3 ^ 4 SCOLÉCOPHIDES.
inicre squamine supero-labiale excessivement petite , séparée de
l'oeil par un très-grand intervalle.
DESCRIPTION.
FORMES. Le corps du Sténostome du Caire est soixante-dix
fois environ aussi long qu'il est large au milieu ; le diamètre de
sa partie antérieure est un peu moindre que celui de sa région
postérieure. La queue , qui a deux fois plus d'étendue que la
tête ou qui entre presque pour le quinzième dans la longueur
totale de l'animal, est droite, cylindrique, excepté à son extrémité
terminale , qui est en cône très-obtus, un peu courbée de
haut en bas et armée d'une petite épine.
Le museau, doni le bout est très-convexe, a moins d'épaisseur
que de largeur. La portion supérieure de la plaque rostrale
représente un triangle équilatéral fortement arrondi à son
sommet postérieur; la portion inférieure de la même plaque a
la figure d'un carré long placé en travers, elle se recourbe en dedans
de la lèvre en faisant toutefois une petite saillie correspondante
au bord de celle-ci, La frontale antérieure est moins
grande que la portion inférieure de la rostrale ; elle est plus
large que longue et coupée à quatre pans , u n très-petit, oblique
de chaque côté, un grand, droit en avant, et u n encore plus grand,
curviligne en arrière. La frontale proprement dite et l'inter-pariétale
diffèrent de la précédente , en ce qu'elles ont leur pan
antérieur un peu plus large, et leurs pans latéraux u n peu moins
petits. Les sus-oculaires, qui offrent chacune une dimension
presque égale à celle de la frontal e proprement dite , sont deux
petites bandelettes subrhomboïdales placées obliquement audessus
des y eux, engagées par un angle aigu entre la frontonasale
et l'oculaire , et par un autre angle aigu entre la frontale
antérieure et la frontale proprement dite. Les pariétales, subrhomboïdales
aussi, sont beaucoup plus étendues dans le sens
transversal que dans le sens longitudinal delátete; elles s'avancent
par un angle aigu entre la frontale pi'oprement dite et l'interpariétale
, et descendent le long de la moitié au moins du bord
postérieur de l'oculaire pour s'appuyer par u n petit bord oblique
sur îa seconde squauune supéro-labiale. Les post-pariétales ont
la même figure et la même grandeur que ces dernières. Lesnasales
, très-petites et situées tout à fait sous le museau, affectent
«hacune la figure d'un triangle scalène , dont le grand côté
CATODONIENS. G.; SïÉiNOSTOME. I.
touche à la rostrale , le moyen à la fronto-nasale et le petit à la
première squamnie supéro-labiale. Les fronto-nasales , qui sont
presque aussi développées que les oculaires , ont également
comme les nasales la figure d'un triangle scalène, dont le petit
côté est en rapport avec ces dernières plaques , le moyen avec la
rostrale , le grand avec l'oculaire . la sus-oculaire et la frontale
antérieure. Les oculaires sont des lames quadrangulaires ayant
une hauteur double de leur largeur ; leur bord supérieur, sur le •
quel s'appuie la sus-oculaire , est oblique et s'unit à angle aigu
avec leur bord postérieur, qui est rectiligne, de même que l'antérieur
et l'inférieur, qui se recourbe en dedans del à jèvre.Iln' y
a que deux squammes supéro-labiales de chaque côté ; la prem
i è r e , subtrapézoïdale et excessivement pet i te, est placée sous
la fronto-nasale entre la nasale et l'oculaire , qui la sépare de sa
congénère. Cette seconde squamme supéro-labiale est de moitié
moins développée que l'oculaire ; elle offre quat r e pans : u n trèspetit,
sur lequel s'appuie la pariétale, un hès-grand, oblique
qui touche ò l'oculaire , et deux autres , un en bas , l'autre en
arrière , formant un angle droi t , arrondi à son sommet.
Les yeux , bien que très-apparents , sont d'un diamètre distinctement
moindre que celui de ces mêmes organes dans les trois
espèces suivantes. Les narines sont situées tout à fait au bas des
côtés du bout du museau , c'est-à dire presque sous celui-ci.
Les écailles du corps sont un peu plus dilatées transversalement
que longitudinalement ; elles représentent des losanges arrondis
au sommet de leur angle postérieur.
Écailles du tronc : 14 rangées longitudinales, 325 rangées
transversales. Écailles de la queue : 36 rangées transversales.
COLORATION. Ce Sténostome est blanchâtre, lavé en dessus
d'une teinte b run roussâtre extrêmement claire.
DIMENSIONS. Longueur totale, 24" 1'". Tête. Long. 5 .
Tronc. Long. 22". Queue. Long. 1" 6"'
PATRIE. Cette espèce est une découverte faite aux environs du
Caire par M. Birr, de qui le Musée de Strasbourg en a reçu un
exemplaire , qu'on a bien voulu nous envoyer en communication
(1).
(1) Le.s feuilles précédentes étaient déjà imprimées lorsque nous avons
«u connaissance de cette nouvelle espèce : c'est pourquoi elle ne se
liii;
M
• - ' i i Ì
Ml: i)
, fîi