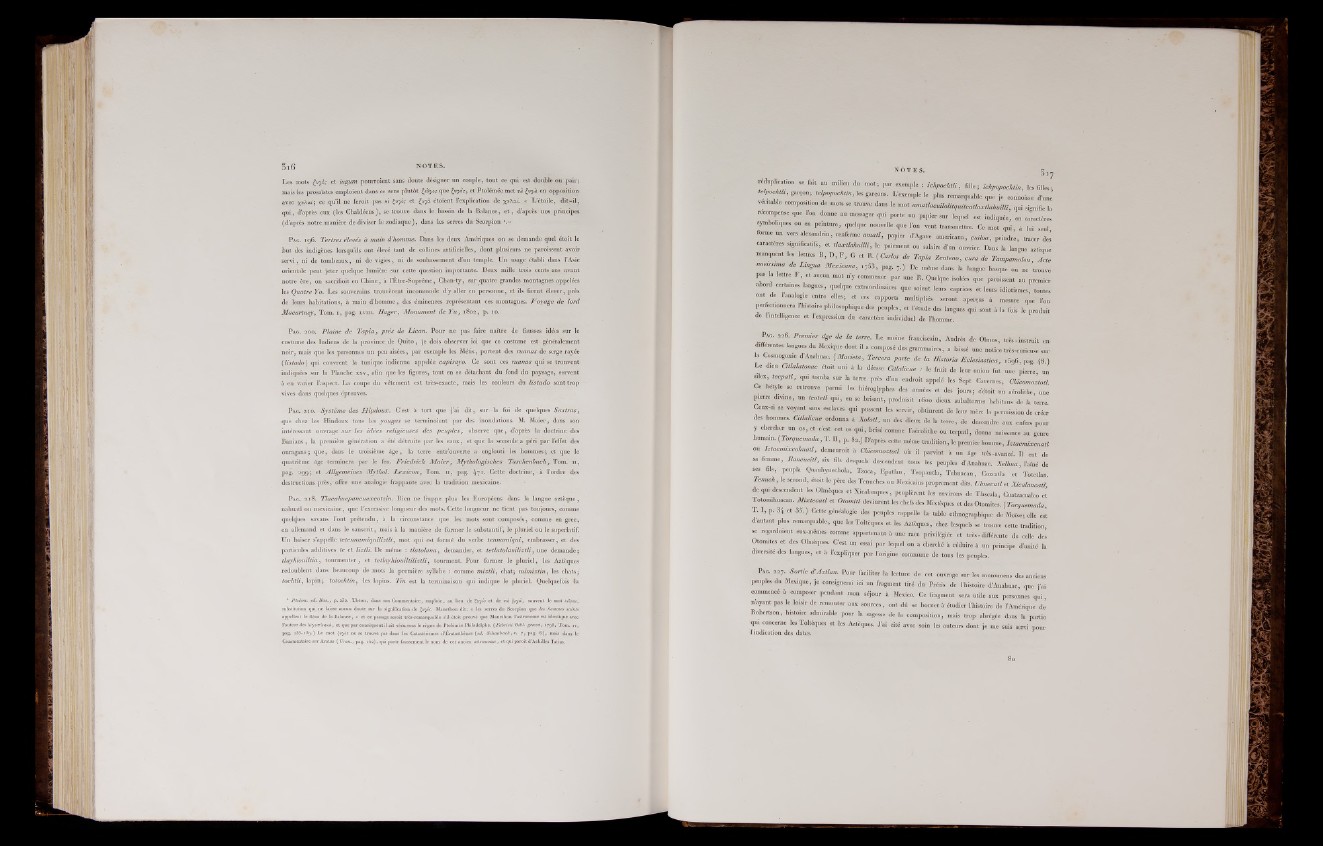
5 l 6 N O T E S .
L e s mots ¿vyoç et iugum pourroient sans doute désigner un couple, tout ce q u i'e s t double ou pair;
mais les prosa'fstcs emploient dans ce .sens plutôt fâyoç que Çyyoç, et Ptolémée met t« Çvyà. en opposition
avec ce qu’il ne feroit pas si Çuyôf et luyk étoient l’explication de %n\cu. " L ’é toile, d i t - i l ,
q u i, d’après eux (les Ghaldéens), se trouve dans le bassin de la Balance, e t , d’après nos principes
(d ’après notre.manière de diviser le zodiaque),, dans les serres du Scorpion '.»
Pag. 196. Tertres élevés à main d’homme. Dans les deux Amériques on se demande quel étoit le
but des indigènes lorsqu’ils ont élevé tant de collines artificielles, dont plusieurs ne paroissent avoir
s e rv i, ni de tombeaux, ni de v ig ie s , ni de soubassement d’un temple. U n usage établi dans l’Asie
orientale peut jeter quelque lumière sur cette question importante. Deux mille trois cents ans avant
notre è re , on sacrifioit en C h in e , à l’Être-Supréme, Chan-ty, sur quatre grandes montagnes appelées
les Quatre Yo. Les souverains trouvèrent incommode d ’y aller en personne, et ils firent éleVer, près
de leurs habitations, à main d’h omme, des éminences représentant ces montagnes. Voyage de lord
Macartney, Tom. 1 , pag. lv iii . Hager, Monument de Yu , 1-802, p . 10.
Pag. 200. Plaine de Tapia, près de Lican. Pour ne pas faire naître de fausses idées sur le
costume des Indiens de la province de Q u ito , je dois observer ici que ce costume est généralement
noir, mais que les personnes un peu aisées, par exemple les Métis, portent des ruanas de serge rayée
(listado) qui couvrent la tunique indienne appelée capisayo. Ce sont ces ruanas qui se trouvent
indiquées sur la Planche x x v , afin que les figures, tout en se détachant du. fond du paysage, servent
à en varier l’aspect. L a coupe du vêtement est très-exacte, mais les couleurs du listado sont trop
vives dans quelques épreuves.
Pag. 2 10. Système des Hipdoux. C ’est à tort que j ’a i d it , sur la foi de quelques Sastras,
que chez les Hindoux tous les yougas se terminoient par des inondations. M. Maier, dans son
intéressant ouvrage sur les idées religieuses des peuples, observe q u e, d’après la doctrine des
Banians, la première génération a été détruite par les eaux, et que la seconde a péri.par l’effet des
ouragans; que, dans le troisième â g e , la terre entrouverte a englouti les h omm es ;.e t que le
quatrième âge terminera par le feu. Friedrich Maier, Mythologisches Taschenbuch, Tom. n ,
pag. 299; et Allgemeines Mythol. L exicon, Tom. 11, pag. 4-71 • Cette doctrine, à l’ordre des
destructions près, offre une analogie frappante avec la tradition mexicaine.
Pag. 218. Tlacahuepancuexcotzin. Bien ne frappe plus les Européens dans la langue aztèque,
nahuatl ou mexicaine, que l ’excessive longueur des mots. Cette longueur ne tient pas toujours, comme
quelques savans l’ont prétendu, à la circonstance que les mots sont composés, comme en grec,
en allemand et dans le sanscrit, mais à la manière de former le substantif, le pluriel ou le superlatif.
Un baiser s’appelle tetennamiquiliztli, mot qui est formé du verbe tennamiqui, embrasser, et des
particules addilives te et liztli. De même : tlatolana, demander, et tetlatolaniliztli, une demande;
tlayhiouiltia, tourmenter, et tetlayhiouiltiliztli, tourment. Pour former le pluriel, les Aztèques
redoublent dans beaucoup de mots la première syllabe : comme miztli, chat; mimiztin,■ les chats;
tochtli, lapin; totochtin, les lapins. Tin est la terminaison qui indique le pluriel. Quelquefois >la
rfdupl,cation se lait an milieu du mo t; par exemple : ichpoçhW f t f c . ichpopechtin, le . filles•
fe f ju r f t f i , garçon; f c /w o c / ilin , les garçons. L'exemple le pin. reméiquable que je commisse dune
vtrtlnble eon.po.mnn, de mots se trouve dans le mo l amatlacuihUtgtdteatlaatlahuilli, nui signifie la
récompense que l'on donne au messager qui porte nn papier sur lequel est Indiquât, en cmctères
symboliques ou en peinture, quelque nouvelle que l'on veut transmette. C e mot q u i; à lui s e u l , .
forme un vers alexandrin, renferme amatl, papier d’Agave amcricaim, çuiloa., peindre, tracer des
caractères significatifs, et tlaxtUhuilli, le paiement ou salaire d'un ouvrier. Dans la langue aztèque
manquent les lettre, B , D , F , G et K (Carlos'de Tapia Zeeteno, cura A Tàmpaalaloa, A n e
nonssuna A Lipgua Mexicapa', i.jS fi, pag. y.) De même dans la langue basque On né irotive
pas-h, lettre F , et aucun mot n 'y cotntnencc par une R. Quelque isolées que paraissent au p r ï in »
0 certaines langues, quelque extraordinaires que soient leurs caprices et leurs idiotismes, toutes
ont de 1 analogie e n t e elles; et ces rapports multipliés seront aperçu, à mesure que l'on
perfectionnera l'b tsto.re philosophique des peuples, et' l'étude des langues qui sont'à la foi, le produii
de 1 intelligence e t l’expression du caractère individuel de l'homme.
Psg. aaG. Premier âge de la terre. L e moine franciscain, Andrès de Olmos, très .instruit en
différentes langues du Mexique dont il a composé des grammaires, a laissé une notice Ifcs-curlcusc sur
la Cosmogonie d'Anahuac. Tercèm pane de la Hi,tarie Ecleriaslica, , 5gG, pag <¡8 )
L e dieu, atlalatoooc étoit uni à la déesse Cülalicuè : le fruit de leur union fut une pierre un
silex tecpatly. qui tomba sur la terra près d’un endroit appelé les Sept Cavernes, Ohhomoetotl.
Ce bétyle se retrouve parmi les hiéroglyphes de, années et dés jours; e'éloit «h aérollthe nue
pierre -divine, un teo re ti qui, en se brisant, praduisit ,600 dieux subalternes habitons de la terre.
Ceux-ci se voyant sans esclaves qui pussent les servir', Obtinrent de leur mère la permission de créer
des hommes. Citlalicue ordonna à Xolatl, on des dieux de 1. terra, de descendre aux èhlers- pour
y chercher nn- o s, et c'est cet os q u i, brisé comme l'aérolithe ou tecpàtl, donna naissance au genre
humain. [Torpuemada, T . H , p. 8a.) D'après cette même tradition, le premier homme, Ietacmiecuati
ou Iztacmixcohuùtl, demeurait à Chicomoelotl où il parvint à un âge''très-avancé. Il eut de
sa femme, IUmcaeitl, six fil, desquels descendent ton, les peuples d'Anahuac. A sTkud, l’alné de
se. fils,- peupla Quauhyueéhola, T zoea, Epatlan, Teopan.la, Tehuacan, Cozca.la et Tolcilnn
Ternich, le second, étoit le père des Tenuches ou Mexicains proprament dits. Olmecatlet Xicalancatl
de qui descendent le , Olmèques et Xicalanques, peuplèrent les environ, de Harnais, C u .tecu a lco et
Totem,huacan. Mixtecatl et Otomitl devinrant le, chcfi, des Mixtèques et des Otomites, (»r jaem ad a ,
T , l , P- 34 e t 35, ) Cette généalogie des peuple, rappelle la table ethnographique de Moïse; elle est
d'autant plus remarquable, que les Toltèque, et les Aztèques, chez lesquels se trouve cette tradition
se régardoient eux-mêmes comme appartenant à une race privilégiée et t e , - différante de celle de,
Otomites et des Olmèques. C'est un essai par lequel on a eheiebé à réduire à un principe d'uhité 1,
diversité des langues, et à l'expliquer par l'origine commune de fous les peuples.
Pac. a a 7, Sonie d'A ztian. Pour fa c ilite la lecture de cet -ouvrage sur les monumens des ancien,
peuples du Mexique, je consignerai ic i un fragment tiré du Précis de l'histoire d'Anahuac, q u e i ÿ
commencé à .composer pendant mon séjour à Mexico. Ce fragment sera u t il, aux personnes q u i,
n’ayant pas le .loisir de «monter a u x sources, ont dû se b o r n e r ! étudier l'h istoire de l'Amérique de
Rohertson-, histoire admirable pour la -sagesse de la composition, mais trop abrégée A n s la partie
'qui concerne les Toltèques et le , .Aztèques. J'ai cité avec soin le , entoura dont je me suis servi pour
l’indication des dates-.