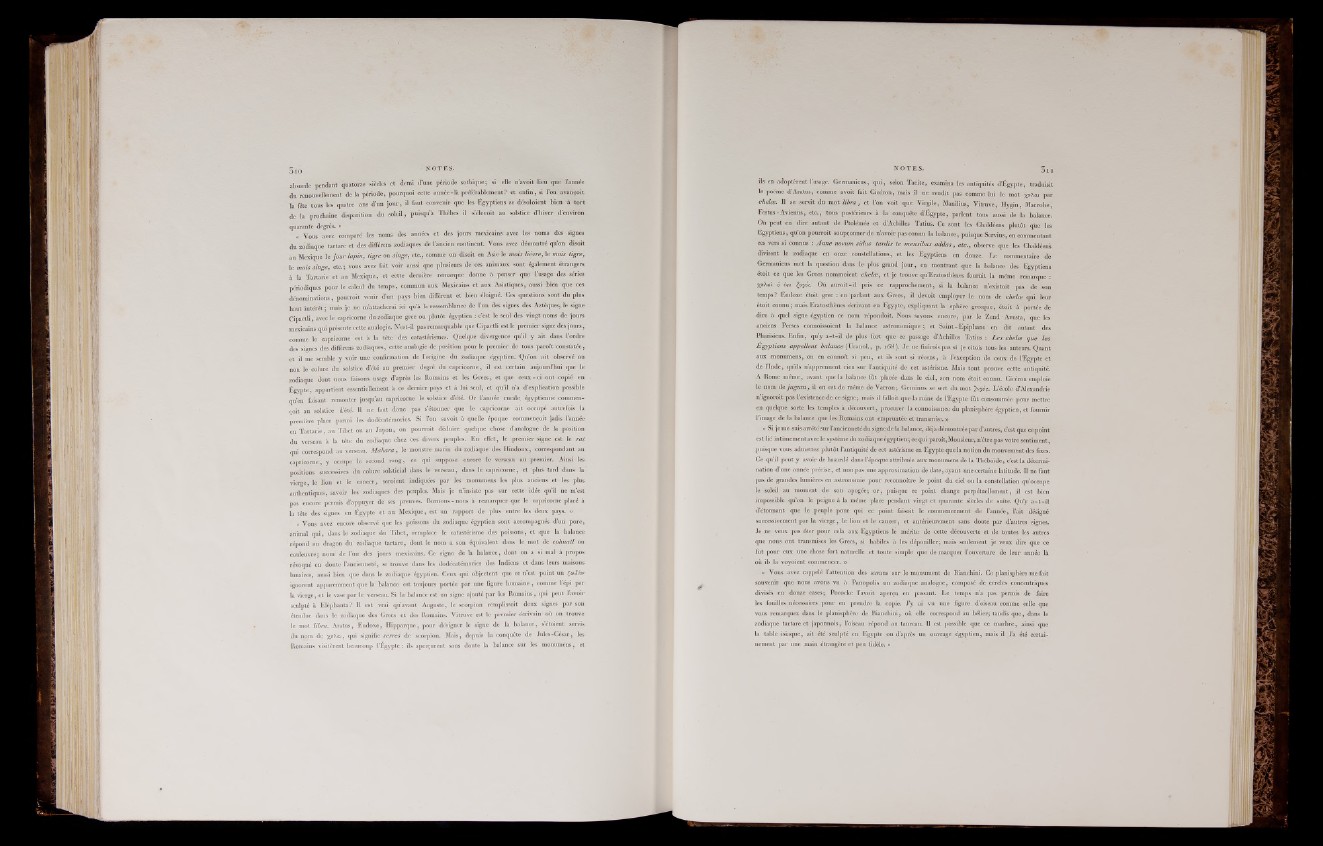
absurde pendant quatorze siècles et demi d’une période sotbique; si elle n’avôit lieu que l'année
du renouvellement de là période, pourquoi cette année-là préférablement? et enfin, si l’on avançoit
la fête tous les quatre ans d’un jo u r, il faut convenir que les Égyptiens se désoloient bien à tort
de la prochaine disparition du so leil, puisqu’à Thèbes il s’élevôit au solstice d’h iver d’environ
quarante degrés. »
« Vous avez comparé les noms des années et des jours mexicàins avec les noms des signes
du zodiaque tartare et des différens zodiaques de l’ancien continent. Vous avez démontré qu’on disoit
au Mexique le jour lapin, tigre ou singe, etc., comme on disoit en Asie le mois lièvre, le mois tigre,
le mois singe etc.- vous avez fait voir aussi que plusieurs de ces animaux sont également étrangers
à la Tartarie et au Mexique, et cette dernière remarque donne à penser que l’usage des séries
périodiques pour le Calcul du temps, commun aux Mexicains et aux Asiatiques, aussi bien que ces
dénominations, pourrait venir d’un pays bien différent et bien éloigné. Ces questions sont du plus
haut intérêt ; mais je né m’attacherai ici qu’à la ressemblance de l’un des signes des Aztèques, le signe
Cipactli, avec le capricorne du zodiaque grec ou plutôt égyptien : c’est le seul des vingt noms de jours
mexicains qui présente celte analogie. N’est-il pas remarquable que Cipactli est le premier signe des jours,
comme le capricorne est à la tête des catastérismes. Quelque divergence qu’il y ait dans l’ordre
des signes des différens zodiaques, cette analogie de position pour le premier de tous paraît constatée,
e t il me semble y vo ir une confirmation de l’o rigine du zodiaque égyptien. Qu’on a it observé ou
non le colure du solstice d’été au premier degré du capricorne, il est certain aujourd’hui que le
zodiaque dont nous faisons usage d’après les Romains et les Grec s, e t que ceux - ci- ont/copié en
É g yp te, appartient essentiellement à ce dernier pays et à lui seul, et qu’il n’a d’explication possible
qu’en faisant rémonter jusqu’au capricorne le solstice d’été. Or l’année rurale, égyptienne commen-
çoit au solstice d’été. I l ne faut donc pas s’étonner que le capricorne a it occupé autrefois la
première place parmi les dodécatémories. Si l’on savoit à quelle époque commençoît jadis l’année
en Tartarie au Tib et ou au Japon, on pourrait déduire quelque chose d’analogue dè la position
du verseau à la tête du zodiaque chez ces divers peuples, E n effet, le premier signe .est le rat
qui correspond au verseau. Maliara, le monstre marin du zodiaque des Hindoux, correspondant-.au
capricorne, y occupe le second rang, ce qui suppose encore le verseau au premier. Ainsi les
positions successives du colure solsticial dans le verseaü, dans le capricorne, et plus tard dans la
vierge, le lion et le cancer, seraient indiquées par les monumens les plus anciens e t les plus
authentiques, savoir les zodiaques des peuples. Mais je n’insiste pas sur cette; idée qu’il ne m’est
pas encore permis d’appuyer d e 'se s preuves. Bornons-nous à remarquer que le capricorne placé à
la tête des signes en Égypte et au Mexique, est un rapport de plus entre les deux pays. »
« Vous avez encore observé que les poissons du zodiaque égyptien sont accompagnés d’un porc,
animal q u i, dans lé zodiaque du T ib e t, remplace le catastérisme des poissons, et .que la balance
répond au dragon du zodiaque tartare, dont le nom a son équivalent dans le mot de cphuatl ou
couleuvre; nom' de l’un des jours mexicains. C e signe de la balance, dont on a si mal à propos
révoqué en doute l’ancienneté, se trouve dans les dodécatémories des Indiens et dans leurs maisons
lunaires, aussi bien que dans le zodiaque égyptien. Ceux qui objectent que ce n’est point un £û>J'/or
ignorent apparemment que la' balance est toujours portée par une figure humaine , comme 1 épi par
la vierge, et le vase par le verseau. Si la-balance est un signe ajouté par les Romains, qui peut lavo ir
sculpté à Eléphanta? I l est Vrai qu’avant Auguste, le scorpion rèmplissoit deux signes p ar son
étendue dans le zodiaque des GreCs et des Romains. V ith iv e est le premier écrivain ■ où on trouve
le mot lïbra. Aratus, Eudoxe, Hipparque, pour désigner le signe de la balance, • s e toi en t servis
du nom de. jyiXtn, qui signifie serres de scorpion. Mais, depuis la conquête de Jules-César, les
Romains visitèrent beaucoup l’Égypte : ils aperçurent sans doute la balance sur les monumens, et
ils en adoptèrent l'usage. Germanicus, q u i, selon Tacite, examina les antiquités d’É g yp te, traduisit
le.poème d’A ratus, comme, avoit fait Gicéron, mais il ne rendit pas comme lu i le mo t f o L , par
cheloe. Il se servit du mot libra, et l’on vo it que V irg ile, Manilius, Vitru v e , Hygin, Macrobé,
F estus-Avienus, e tc ., tous postérieurs à la conquête d’È g yp te , parient tous aussi de la . balance.
On peut en dire autant de Ptolémée et d’Achilles Tatius. Ce sont les Chaldéens plutôt qûe les
Egyptiens, qu’on pourrait soupçonner de n’avoir pas connu la balance, puisque Servius, en commentant
ces. vers si connus : Anne novum sidus tardis te mensibus addas, etc., observe que les Chaldéens
divisent le zodiaque en onze constellations, et les Egyptiens en douze. L e commentaire dè
Germanicus met la question dans le plus grand, jo u r, en montrant que la balance des Egyptiens
étoit ce que les Grecs nommoient cheloe, et je trouve qu’Eratosthènes fournit la même remarque :
ô Içi fyyoc. Où a u r a i t - i l pris rapprochement, si la balance n’existoit pas de son
temps? Eudoxe étoit grec : en parlant aux Grec s, il devoit employer le nom de cheloe qui leur
étoit connu; mais Eratosthènes écrivant en Egypte, expliquant la sphère grecque, étoit à portée de
dire à quel signe égyptien ce nom répondoit. Nous savons encore, par le Zend Avesta, que les
anciens Perses connoissoient la balance astronomique; et Saint - Epiphane ' en dit autant des
Pharisiens. Enfin, qu’y a - t - i l . de plus fort que ce passage d’Achilles Tatius : Les.cheloe que les
Égyptiens appellent balance (Uranol., p . 16 8). Je ne finirais pas si je citois tous les auteurs. Quant
aux monumens, on en connoft si p eu , et ils sont si récens, .à l’exception de ceux de l’E gypte et
de l’Inde, qu’ils n’apprennent rien sur l’antiquité de cet astérisme. Mais tout prouve cette antiquité.
À Rome même, avant que la balance fût placée dans le ciel, son nom étoit connu. Cicéron emploie
le nom de jugum, il en est de même de Varron; Geminus se sert du mot L ’école d’Alexandrie
n’ignoroit pas l’existence de ce signe; mais il fàlloit que la ruine de l’Egypte fût consommée pour mettre
en quelque sorte les temples à découvert, procurer la connoissance du planisphère égyptien, e t fournir
l’image de la balance que les Romains ont empruntée et transmise. »
.« S i je me suis arrêté sur l’ancienneté du signe de la balance, déjà démontrée par d’autres, c’est que ce point
est lié intimement avec le système du zodiaque égyptien; ce qui parait, Monsieur, n’être pas votre sentiment,
puisque vous admettez plutôt l’antiquité de cet astérisme en Egypte que la notion du mouvement des fixes.
Ce qu’i l peut y avoir de hasardé dans l’époque attribuée aux monumens de la Thébàïde, c’est la détermination
d’une année précise, et non pas une approximation de date, ayant une certaine latitude. Il ne faut
pas de grandes, lumières en astronomie pour reconnoitre le point du ciel ou la constellation qu’occupe
le soleil au moment de son. apogée; o r , puisque ce point change .perpétuellement, .il est bien
impossible qu’on le peigne à la même place pendant vingt et quarante siècles de suite. Qu’y a - t - i l
d’étonnant que le peuple pour qui ce point faisoit le commencement de l’année, l’a it désigné
successivement par la vierge, le lion et le cancer, et antérieurement sans douté par d’autres signes.
Je ne veux pas ôter pour cela aux Egyptiens le mérite de cette découverte et de toutes les autres
que nous ont transmises les Grecs, si habiles à les dépouiller; mais seulement je veux dire que ce
fut pour eux une chose fort naturelle et toute simple que de marquer l’ouverture de leur année là
où ils la voyoient commencer. »
« Vous avez rappelé l’attention des savans sur. le monument de Bianchini. Ce planisphère me fait
souvenir que nous avons vu à Panopolis un zodiaque analogue, composé de cercles concentriques
divisés en douze cases;. Pococke l’avoit aperçu en passant. L e temps n’a pas permis de faire
les fouilles nécessaires pour en prendre la copie. J’y ai vu une figure d’oiseau comme celle que
vous remarquez dans le planisphère de Bianchini, où elle correspond au bélier; tandis q u e, dans le
zodiaque tartare et japonnois, l’oiseau répond au taureau. I l est possible que ce marbré, ainsi que
la table isiaque, ait été sculpté en Egypte .ou d’après un ouvrage égyptien, mais il l’a été certainement
par une main étrangère et peu fidèle. »