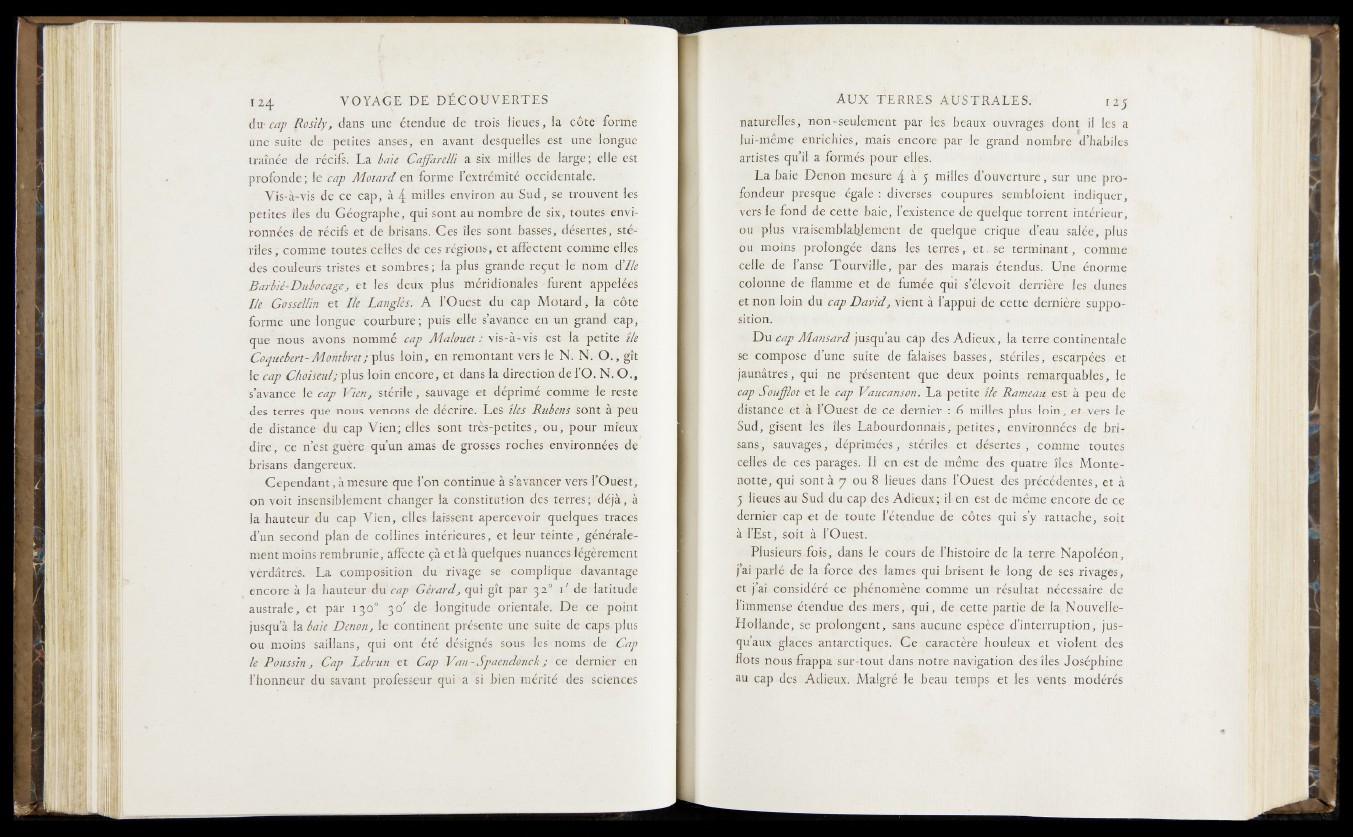
ÛxX'cap ftosily, dans une étendue de- frois?dietiëà,'la doté fortile
ünë suffé' de : petites" anses^-efe avant' desqueiid^te&t une longue
traînée de récifs. La baie Cftffareltf a.- six milles 'de-large ^ eii^est
profonde ; -le cap Motard en Torme-Fextrémité1 occidentale.
Vis-à-vis de1 cè Cap, à 4 milles environ au ;£ud, Se trouvenMés
petites îles du'Géographe, qui sont âû nombre de’ siÉy toutes'* environnées
de récifs et de brisans.-Ges îlessunt.’basses.; tlésertes,f%é-
i i l^ î éomme toutes" celles dê?ées ’«régions, èt affectent cOmme'ètle§
desrcouleurè-tristes et sombres ; la plus "grande reçut le' nom à’Ile
Bafbïé-Ikiboeagey et les'deux plus méridionales -furent appelées
îte Gossdtïn et Ile La n g lh •, A fOuést dudcap Motard -, l^rtsôtë
forme une longue 'courbure', puis elIeVavanee en un grand Cap,
•Ijüfe^übus - ipr'pns •.•aoæàbié-.-f4p Malouèt : visi-àVvfè’‘'*fet4 la p e tite -t/è
Coquebert - Monïbret ; plus : loin > en remontant -vers le -, rgît
le cap* Ohoiseul;p\v& loin encore, et dans la direction d eTO .M O .,
Vavance le5 r%? Vien/wék'Ae, sauvage' e t .déprimé comme te ;rest-e
des terres que noué venons de décrire. LeSufAr Rübenè 'sont''à ïpêil
de distance du cap Vien; elles sont -très-petites,—o u , pour Mieux
dire , ce n est guère qu’un amas de grosses roches environnées :de
brisans dangereux.
Cependant, à mesure que l’on continue à^Ssavaqcifr veîsd’O uest,
on voit insensiblement changer laiCdnstitntion des 'tërr&'S'*;-'déjà, à
la hauteür du -cap Vien, elles laissent apercevoir queiq&erîtMdês
d’un second plan de Collines intérieures, et leur teinte, •généralement
moins rembrunie, affecte çà et-laquelques nuanoes#égèrfement
Verdâtres. La composition du rivage se oompliqle davantage
encore à la hauteur ca p ïG ir ard, qui-gît par
australe, et par 13.00' $0' de longitude orientale. De -ce point
jusquàla baïeDenon, le continent présente-une «suite de càps-'^lus
ou moins'saillans, qui ont été désignés-sous les -noms d'e 'jG'ap
le P o u ssin ,i‘£ ap Lebrun et Cap Van-Spaendonck; ice dernier en
l’honneur du Savant professeur qui a si bien mérité '»deshfetelâ&es
naturel!^ non-ieufjemettt pan ouvrages dont il les a
lui-itflême enrichies,->imai^..'éî€l|Sè’.:p # ^ |g r a n d nombre’ d’habiles
â'rfistèsf''qu# a lff)¥telésVp o ur eljfes-î-
¥ L a haie Jàèlpon îhillm d’oii^twlïè';^sur une prd-
Tdnd#^q|fé s^ub1, - diykriesf - Vo^urbsÆ ^eUikl-oi en t indiquer]
vers-1 le fond* dë%ë%è"?ha-^ quelqtié'èorrên t intérieur y
Ou -plus vrâisemblahlement/^déïJfqhelqil^GritpC d» e aUM Salée,-i p l us
Dul''ihoîhs;,prolë®gée ’ dans ,#s terminant, comme;
ëe'Me, de l’anse To^fMre, pàr ^ dfsVmarais- eféàduls i|W.én‘orme
ihôlëhne de'(flanfféé%èt -/de fumée. qûr>.’4p|^it^4èiærère ;,çfunes
•pt non 16fn \dw;éap é^r'/^'xyfent' à -l’appifïfdtèî jeette derûaèæéijSUppo-
siîi&kj.1^
D'éôap Mansarâ jusqu’au cap 'des.Adieux, 4a* teere-continentale
se^cd.xnÿ'Oie d’ùné tebrtevdp falaise shb4§sfes y *ytéif^^leVesiÿp%s et
jaunâtres, qui -ne?,présentent!"que deux’-points remarquaMes, le
capfSmiffM '&x. le tàp tCtfuc&nMây. Laipptitedz/g Ramedï^esP à pe.u dé
distànee^et? à FOuest dfe'éeWernieroiné miltes*; pim? loin, le v e r s le
Sud, •'gisent tfe's&'îles dbabour donnais^ petites# environnées .-'de bri-,
sansj.^sàuvage^; déprimées } !tstérjlesi,et%fedéseî;tes,, ,cdmnjeî| toutes
celles de ices^pdragèsrdll' en dst > de même desVquatjh^ îfeS;- Monté-i
not-te, qui sont àîy'voud^ieûelfda^l’C^èatÀi^e^^é^dea^e&f ^ 4'
^•lieïtfés'au 'Sudî du. oap^ des Adieux ; iFen-.est.dê .méinie'iencore dd^fC-
dernier .càp set 'dë; toute l’ébendkb de cptés'jquhfs’ÿ rattache^!Soff
à d®sjÉ| .soitiîà-J’Ouest.
: »Blusieur&t-fois ; dans le'cours.dé.l’hist'Oire de la.^erre Napoîébn-,
j’a'i'parlé de la force.des : lames:»quiJA-risenK te* long’ densesÆvag6s>
et j-ai considéré ce& phënoméne^GÔmme un«résultat ns^éess^ire. de
l’immense étendue d é su n is ,, qui, deWbtte partie de la Nouvélle-
HoMandëi ,sé prolongent-, -sans. aulçuné>^^dêf?td;’inferruption, jusqu’aux
glaces kn.t ar cti qu.es. * Ce .caractèÉèl houléuic, et violent des
flots nous frappa^kr-ît-out dans notefeinayîgati00 des^^e^Joséphine
au cap des Adieux..Malgré le heau temps et fervents modérés