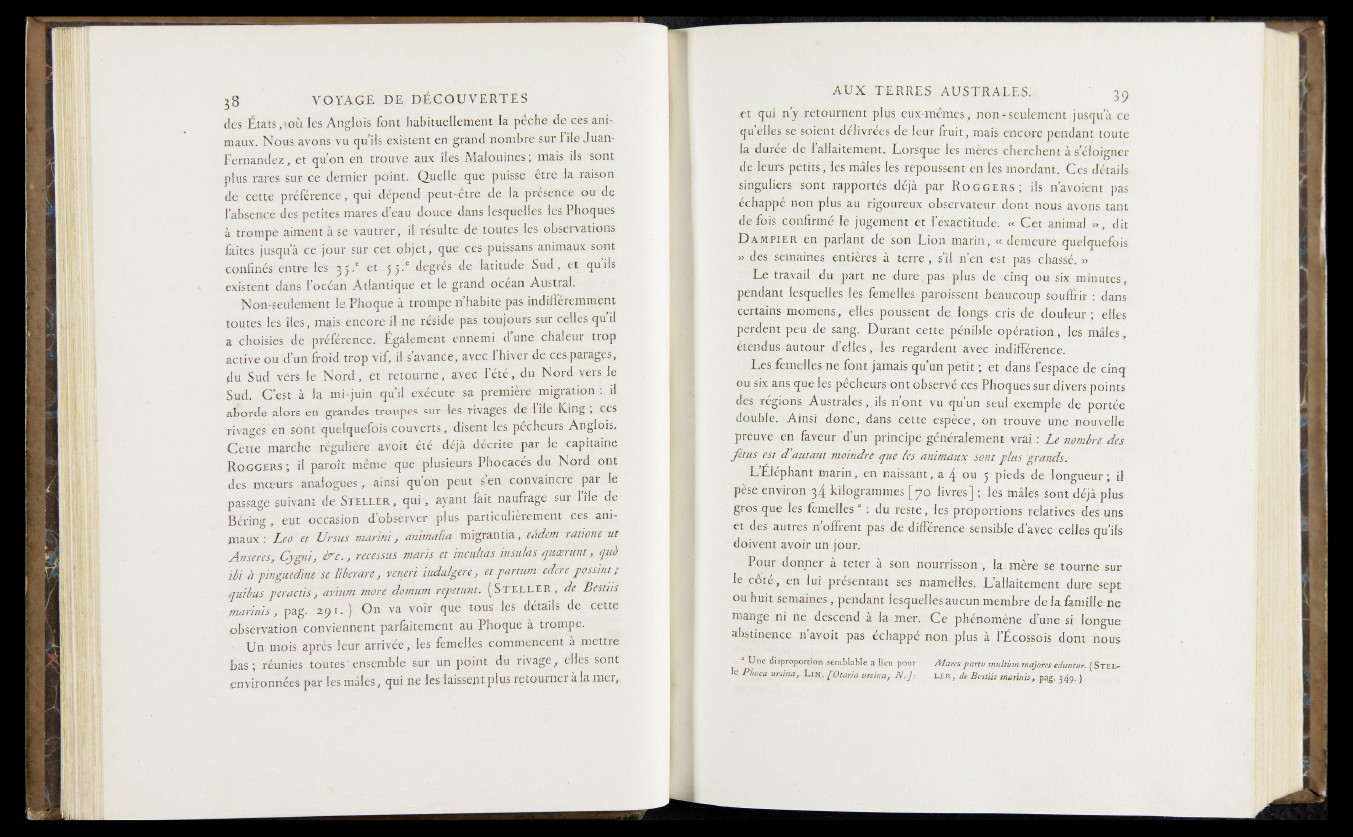
des États ,yoù lesAnglois font, habituellement la pêche de cés animaux.
-Nous avoiis v.u qu’ils, existent en grand nombre sur l’Me Juan-
Fernandez, et qu’on en trouve aux ries Malouities ; mais ils sont
plus rares surr .ee -dernier point. Quelle que pui-asL être la^ iso n
de cette préférence, qui dépend peut-être de la-présence jou de
l’absence des petites mares, d’eau douce dans lesquelles» lés’ Phoques
à trompe aiment à se vautrer, il résulte de toutes les* o.bservâtions
f a i t e s o b j e t , , q u e ces puissans animaux.soint
confinés entredes^ ^ .6 e t -55-° dègrês de latitude.-.Sud, et quils
existent dans l’océan Atlantique et le grand océan. Austral'..
Non-seulement le Phoque à trompe n’habite pas indifféremment
toutes lesrîies . mais encore il ne réside ras toujours-sur celles^u il
a choisies de préférence.- ‘Également ennemi d une. chaleipy trop
active ou d’un froid trop vif, il s’avance, avec l’hiver <fe cè%paflpig££<
du Sud vers-le Nord, et retourne, avec T été, du Nordj^ejÿJe
Sud. C ’est à la nii:juin qu’il exécute sa.première’ migration: il
aborde aldïsr pis grandes troupes sur les* rivages* de 1 île King ; .«es
rivagds en sont quelquefois couverts, d isèn t j esi pe c heurs. An g J o i#7
Cette marche régulière avait été déjà décrite .par le^e&pitâine
Roggers ; il paroît même que plusieurs Phocaces du Nord ont
dés5 moeurs analogues,, ainsi qu’on peut sien -.eonvaincré par le
pasëâge suivant de Stellër, q u i, ayant fait naufrage suY’ M^e ^dç
.^ççâsion d’observer^.plus particulièrement anj-
inaux';'% e o ' e t U r s u s m a r i n i y a i i im a t ï a migrantia, ‘r a t ià n 'e '-u t
A n s e r e s , C y g n i , <zhr., r e c e s s u s m a r i s ' e t i n c u l t a s i n s i i l a s * ^ ioe m n t |p f
i b i à p i n g u e d i n e s e l i b e r a r e , v e r a r U n d i d g e n , e t p a r fu m - * e d è h - p a i - s i n t /
q u i b 'u s p e r a ç t ï s , a v iu m m o r e d o m i m r e p e t u n t . (St e e lER, d e B e s t i i s
m a r i n i s , pag. 291. ), On va Voir que tous les détails def cette
observation conviennent parfaitement au Phoque'jà trompe. ,
Un mois après leur arrivée, les femelles «commenèe-nt a,mettre»
bas ; réunies toutes’ ensemble sur un point du ri.vagé ,;,è,liés sOnt
environnées par les -males, qui ne les laissent plus retourner a la mer,,
et qui n’y retournent plps eux-mêmes, non-seulement jusqu’à ce
qu’ellesjje/soient délivrées .de leur fruit, mais encore pendant toute
la djar^eede l’allaitement. tLor;Sque les mères cherchent à sréfrugner
de leurs-petits, |es mâlesÉègiæpdü.ssent icq les mordant. Ces détails
singuliers-.-sont rapportés|ÿéjà : par R o © ge RS^ed^ n’avoient pas
échappésnon plus.au fr,igoureux;( p^ervatteur dont nous avons tant
d;ç.fois confirmé^lf jugement Ét.î’èxastitude. « .(Set animal » , dit
D ampier en^p^rfant de;Jspp Lion marin, «demeure quelquefois
33 deiSïjsêmairïes entièrççslà^êerre s’il n’en- est pàs^phassé/* É
■ - Le travail du^part .ne - dureras», plus de xinq^ou six minutes.,
pendant ^quelles b^uçoup, souffrir : dans
ceEtains^morniens, ^ttes’ posusk;hV%'ll>pgs cris »dé/doukur ; elles
perdent, peu de sang. Durant Opération- les-mâles,
éténdus;autour d’elles, fteMregardent avec indifférences-
T f^ pÉ emell,êsj l s4fp|l't jamais qu’un K%!i^dans.lfesp^ce.dé,cinq
ou’six ans quelles nêchpurs ont oLser^icp'Rhoqucs $u*r div^points
Austrafes-,yiism’ont vu qp’un. seul-,exempte' ,dè portée-
double. Ainsi donc, dans, .cette s f S ^ É o n trouve yne inm^velle.
p^yesjèn faveur d’un principe généralement vrai : L e
f i t t b s rt â t d ' 'â t t t d n u T n o ,w d n $ q i t e l e s a n tm a u Ê \ $ Q t i t i p l u s *g ^ tm d (s d. ,t
r L ’Éléphant, marin, ^naisga®|, a ou 5 pi-edside5-longueur ; if
pè^d envfeon 3 4' hilogramme^pQ h vrqst] <;^l||tmâles< sont déjà plus-
gr§-s, R m l , kmçM&J^: du reste, les proportion^ relatives.tdes uns
S ÿ p l^ o f f r e n t pas de différcncesensifffe d’avèc ;’G,eliès qu’ils,
doivent avoir un jour.
‘‘ ’’•^^fejdojmerï a teter a ssOp;,) nourrisson , la mère; sel tourne sur
le côté.', en lui p.ré&ntant ses mamefiés^LJalfaifement dure ,sept
ou huit semaines, pendant lesqueffds)atççun.membre|delafaniille ne
r*i ne descend a ia, mer^r^é phénomène d’une, si longue
-n aYpit pas .qcliappé nqn plus, dont .nous
di p r o p o r t i o n M^s^pai^^<i^.tji^ia^ores^cfuî?ttir. {-Ste l-
ie ? Wfflf? I ^ v pag. 349. )