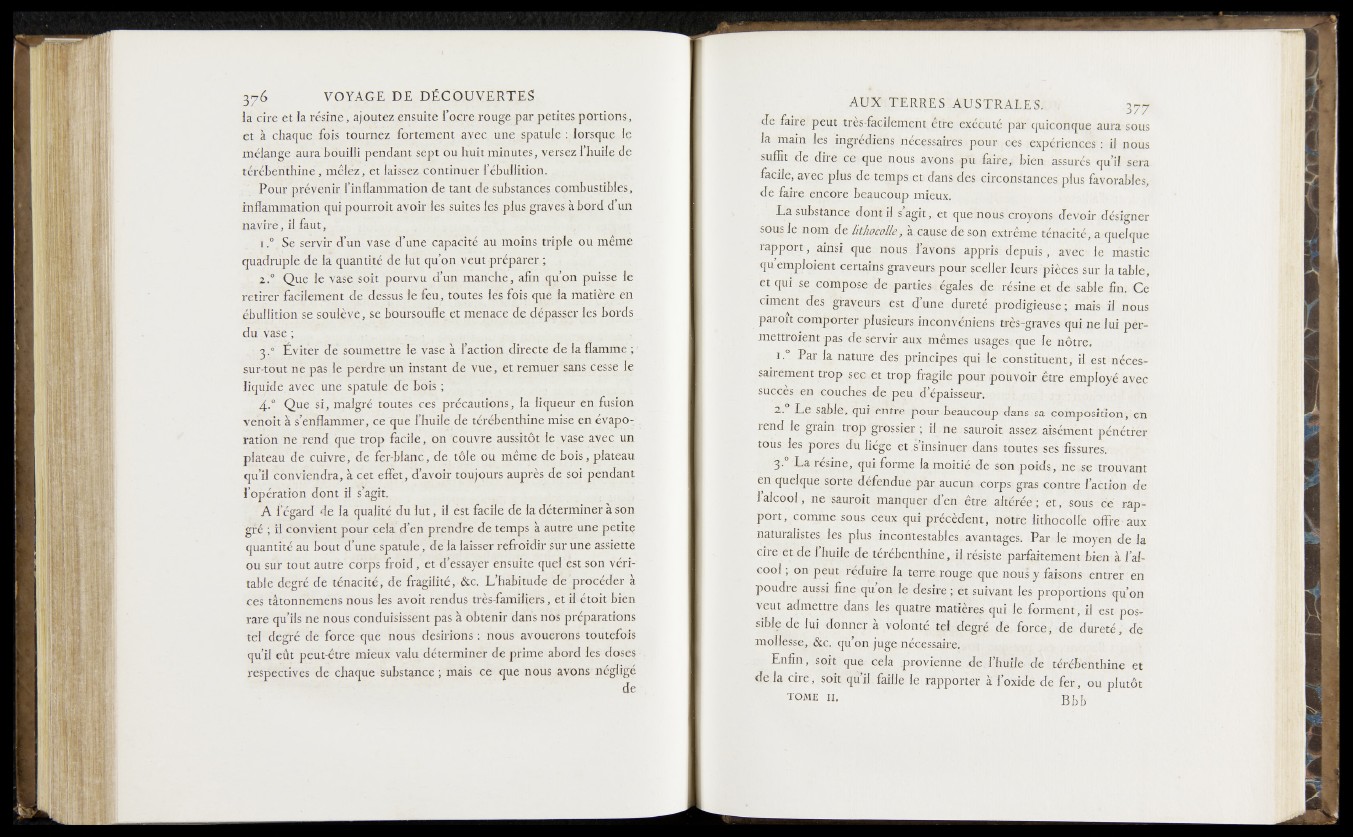
la cire et la résine > ajoutez ensuite l’ocre rougfejpar petite^ portions,
et à chaque fois tournez fortement avec'! unéksnatule ijorsqupje
mélange aura bouilli pendant sept ou huit minutes, verse? l’huile de
têfebeh'ihiné, mêlez,' et laissez.continuer l’ébullitiojn.
Pour prévenir l’inflammation de tant dè substances combustibles.,
rnffammatîon qui pourrdit 'avoir les .suites Iqs plus gravés’ à bord d’un
navire, il faut,
i .°4 Se servir d’un vase d’une capacité au moins trij|[é ou meme
quadruple de la quantité de lut qu’on veut préparer ; *
2.'° Qüê le yasê jsoit pourvu d’un manche, afin gu’pn niasse re
retirer facilement de dessus le feu, toutes lesfois que la matière en
ébullitiorise soulève, se bôursoûfteet menace de ,dép^,erfles bords
du .vase ;
Éviter de soumettre lè vase à factiën directe d é jà flammé;'
sur tout ne pas le perdre un instant de vue^ét remùerlsàns ççssq le
liquide, avec une spatule dè bois ; ,
' 4 .0 Que si^ malgré toutes ces^précautîons, la liqueur en. fusion
venoit à s’enflammer, ce que l’huile de térébenthine misé en élaboration
ne rend que trop facile, on couvre aussitôt le ’^gse avec Un
plateau de cuivre, de fer-blanc, de(tQle ou même;dé bois, plateau
qii’il conviendra,à èèt effet, d’avoir toujours auprès de soi pendant
l’opération dont il s’agit,
A l’egard de la qualité du lu t, il ést facile de la déterminer à son
gré ; il convient pour cela d en prendre de temps à autre une petite
quantité au bout d’une spatule,' dé la laisser refroidir sur une assiette
ou sût tout àiitrè’ cofps froid, et d’eMfêr ensuite quel |st 'son véritable
degré de ténacité, de fragilité,.&c. L ’habitude dé-procéder à
ces tatonnèméns nous les avoit rendus très-famil|efs , et ibétoit bien
rare qu’ils ne nous conduisissent pas à obtenir dans nôs préparations
tel degré de fôrce-que nous desirions : nous avouerons 'toutefois
qu’il eût peut-être mieux valu déterminer de prime abord les doses
j-espectives de chaque substance ; mais ce que nous avons négligé
de
de faire peut très-facilement, être/ e^eôuté pair quiconque aurarsous
la main les dhgBé^iens,,néee|s^^>,pour';Qés rexjpérienê^i | il nous
suffit de dite-, cenque n o^ a v ê g^ fft i faire,t bien- assurés qu’il sera
f a c i le ,.p lu s j jÉ è te^psi?e,udanèjdes. circonstances,plus favorables,
de faire, éncpre b c a u c^ g ^ ïe u ^ ^
Laihbstance dont il slagit,. et ,quéfnous;croyQtïs devoir désigner
sôq| le nom, d'q son extrême ténacité, a-quelqUe
rapport, a|risi q u ^ iç g îs J a ’vonsl appriscdepüis >,, aveCî le mastic-
qu’emploient, certaiks graveuràpour s e e lle c lç^ pièces .sur la table,
et qui ^e compméMlè^arties4égaicsJdei>résï]3e^ét!def sable fin. Ce
cimgnt -^s;,'grayeurs^J^t d’un^^dprété^ prodigieuse majc fi nous
P l^ ^ om pO ïte r plus^ugsuinconvêniens’ tsès-gravês- qui ne lui pëir-
mettroient pas desservir aux mêm,^ .usagestqüe db- nôtre;
I<0 P31- la nature principesj^ui imcqnstttuent, il est nécessairement
trop hée-et trop fragile' pour pouvoir être employé avec
sücqpscen couche^, de peu d’épaisseur.
a. Le sable., quLentré .pour .beaucoup dans sa composition, en
rend le grain, trop’gfôssier ; il ,ne., sauroit 5|.ss.ezi aisément pénétrer
tousses poïés-dù liège, ë t j ’msmuer dans toutesqsès ;fissures/
- 3..'0 La résine, qui forme la moidé^de spn .poi;d^, mevæ trouvant
en quelq-up «sorte dépendue par aucun ,corps.. gras contre i’aqtrph de
lalcooh, rie sauroit manquer dep'. ê&k À ^ é ê : ;e t r a p -
port^compie^us^.ceux qui précèdent, notre Jithoeôlfe offre-aux
naturalistes^ les plus ;incontestable^avantages. -Phrîfc moyen de . la
cire et de l’huile de térébenthine, -^résiste’ parfaitement bien à l’alcool
; on peut; réduire la terre, rouge que nousuy, faisons' entrer en
poudre aussi fine qu’on le desire ; et suivant les proportions qu’on
veut admettre .dafia les quatre matières qui le. forment, il est-pos-
si% dç lui donner a-volonté tel riegyé de, forint de dureté; de
mollesse, &c. qu’on jugeméçessah^k*^
Enfin-, .soit que cela provienne, de d ’huile, de térébenthine et
de la cire, soit qui! faille le rapporter à l’oxide de fer, ou plutôt
tome 11. Rbb