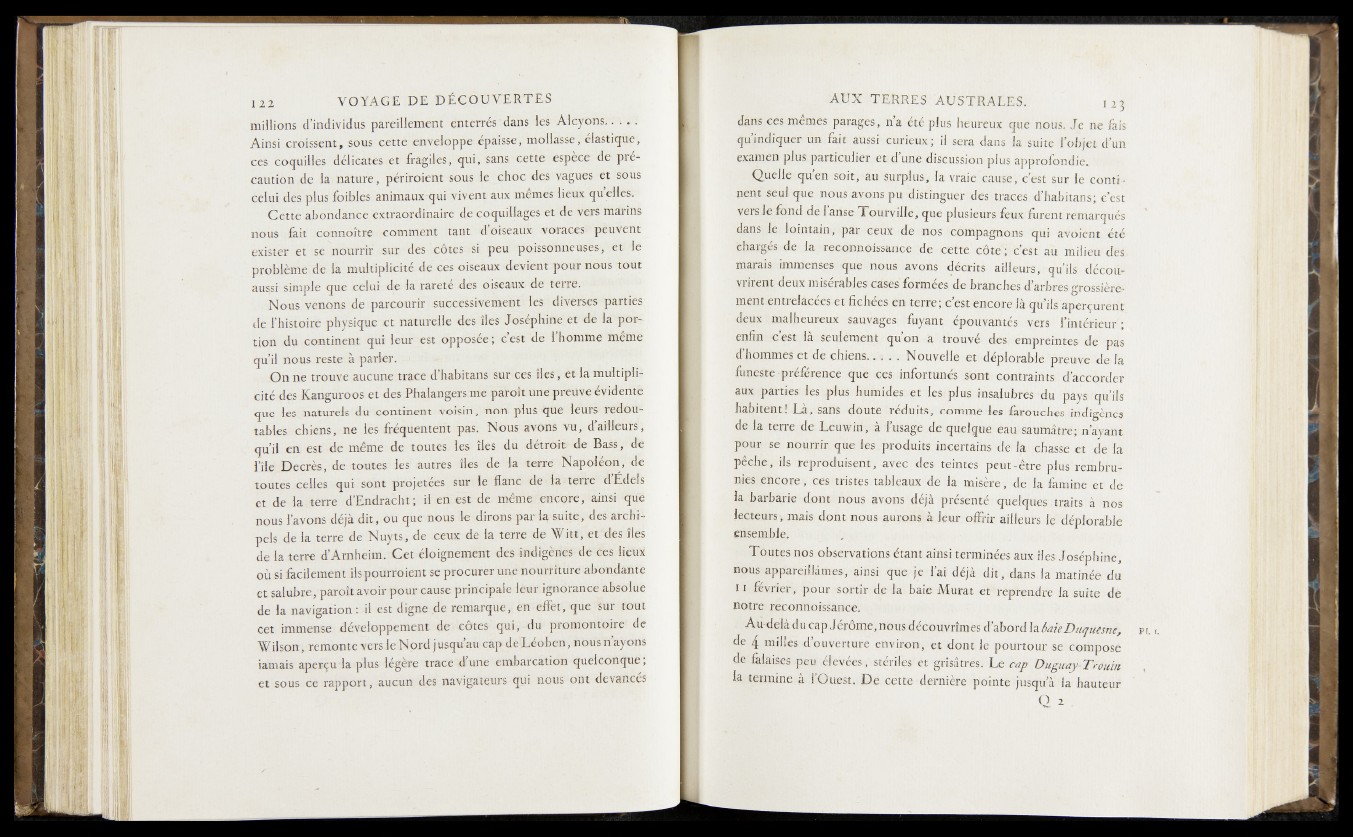
mHIionsj d’individus pareillement Enterrés*dans les -A lc y o n ^ . $?
Ainsi croissent, sous-cette enveloppe épaisse, mollissê^'élastique,
ces coquilles délicates-et fragilfes, qui, sans cette espèce' de- précaution.
de la nature, pérîroient sous le 'ch o c des '-vagues e t ’soUs
celui dés plus foi bles animaux-qui vivent aux mêmes lieux qu elfes*
Cette abondance extraordinaire de coquillages ^èt de vers'matins
nous fait connoître -comment tant d’oiseaux voraces** péiivent
exister et se nourrir sur des côtes tsii peu poi’ssonneu-ses', et le
problème de la multiplicité de ces oiseaux devient po-uT riôüs- ifeut
au^si simple que celui d e là rareté des oiseaux de terre.- -
ISicms venons de parcourir successivement les diverses parties
de l’histoire physique e t naturelle des des J©sephinelèt de la portion
du continent qui leur est opposée ; c’est de 1 homme meme
qulil nous resté a parler. 1
On ne trouve aucune trace d’habitans su r ces îles, et la multiplicité
dçs Kanguroos et des Phalangers.mepàroîtûne preuve évidente
que les n a tu r e ls du ^continent voisin, non- plus tffere fëu$s* redoux-
tables chiens, ne les fréquentent pas. Nous avons vu, d’aMféute,
qu’il en est de mèn e de toutes les îles du détrcwt de Bass , dfe
® e Decrès, de to ^ e s l ^ i autres îles de la te*w> Napoléon', de
tortues fceliel; qui sont projetées sur le flanc de la -teére
et de k ité rre d’Endracht; il en-est de même1 encore, ainsi "què
nous lavons déjà dit, ou que nous le dirons.par U*suH'e^dd#fe3fel&
pels de la terfe de Nuyts,, de ceux de la terre de W i t t ,e t ’tfes'.4tes
de la terre d’Arnheim. C e t éloignement des indigènes de-ée-s lieux
on;si facilement .ibpoürroient se procurer ünenourritureabondante
et salubre^ paroît avoir pour cause principale lëmrugöórancénl^óiue
de la navigation : -il est digne de remarque, en effet, que Àiâr font
cet immpTKe développement de-«ôtes -quiÿAUi promontoire* de
Wilson, remonte versie Nord jusqu’a u cap dê'Léô'benyhousri ayons
iamais aperçu la plus légère trace ffune embarcation quelconque,
et sous ce rap p o rt, aucun des navigateurs qui nous' ont devancés
dans ces,'memes péages, n’a ë£ plus heureux que nous. Je ne fais
qu’indiquer m ffa iifeb ff curieux ; iLsers^dans la suite l ’objet d’un
examen pJu^particulié^et d’un^fejg-u&pn plus approfondie. ' -
QuelleiqUên^soitj' au surplns^fe vraie cause|'$est sur le conti-
psenjtnseul que.mo»s,avonispu distinguera^'traces d’habitans; c’est
verdie fond de l’anse Tourville, que plusieurs feux furent remarqués
dans feî%Mntain5 partjSëüx -de -mbs-tcompagnons qui avoient, été
ehargésnde la teconnoissaiwe^do/jcd-tte-c^o^pst; ^ m i lie u des.
marais-immenses que nous avons décrits a ille u r sq u $ | décoda
vrùent deux misérables cases'formées -de-branfcWfI’arbresÿgrÀferèr^'
ment en tre la cé e^ fiehéès qu’ils aperçurent
deux 'malpeureux sauvages 'fuyant épouvantés,vers l’intérieur';
enfai -c’est là seulement qu’on a trouvé des-empreintes de'pas
d’hommes et de chiem.-. -î ^tNidnvelle et> déplorable ‘preuve--dé fa
funeste -preference q u e -,des. infortunés4 sont contraints d’àocorder
aux parties-les .plus humides, et iestplua insaitfbrëshdu pays-qu’ils
habitent! Là, sans doute reduitsy .pomme les farouches Indigènes
de ia terre dç Leuwin, a dusage de,quelque éauesaiAâare;■ n’afyam
pourse-nourrir que les produis incertains de la châsse ët dè-fa '
ped|e, Ms'reproduisent, a v l^ d # v r f t4's qfeîk^être plus rembru-
nif&érmore', ce.s tristes'.tabiéaux 'dédlà la femme et de
la barbarie don« nous avons‘-déjà- pyésëntér quelques .traitstà mos
le.6tesurs> mais dont nous aurons.^ leur offrir.Wlfeurs J© déplorable
ensemble,
■ Toutes nos observations étant ainsi terminées aux îles Joséphine,
nous’ appareillâmes, ainsi que je l’ai déjà dit, dans la matinée du
11. février, poar^sorrir. de la haie Murat et reprendre la suite dè
notrerecortrioissance, 4
Au-delà du cap Jérôme, nous déc ou vrfrnesff abord la baie Duquesne, pi. ù
de 4 milles d ’ouverture environ, et dont le pourtour se composé
de' falaises peu élevées-*-stériles et grisâtres.- SB cap Dugicay-Trouîn |
fe tèrinine à l’Ouest. De cette dernière pointe jusqufe la hauteur
Q x 'p