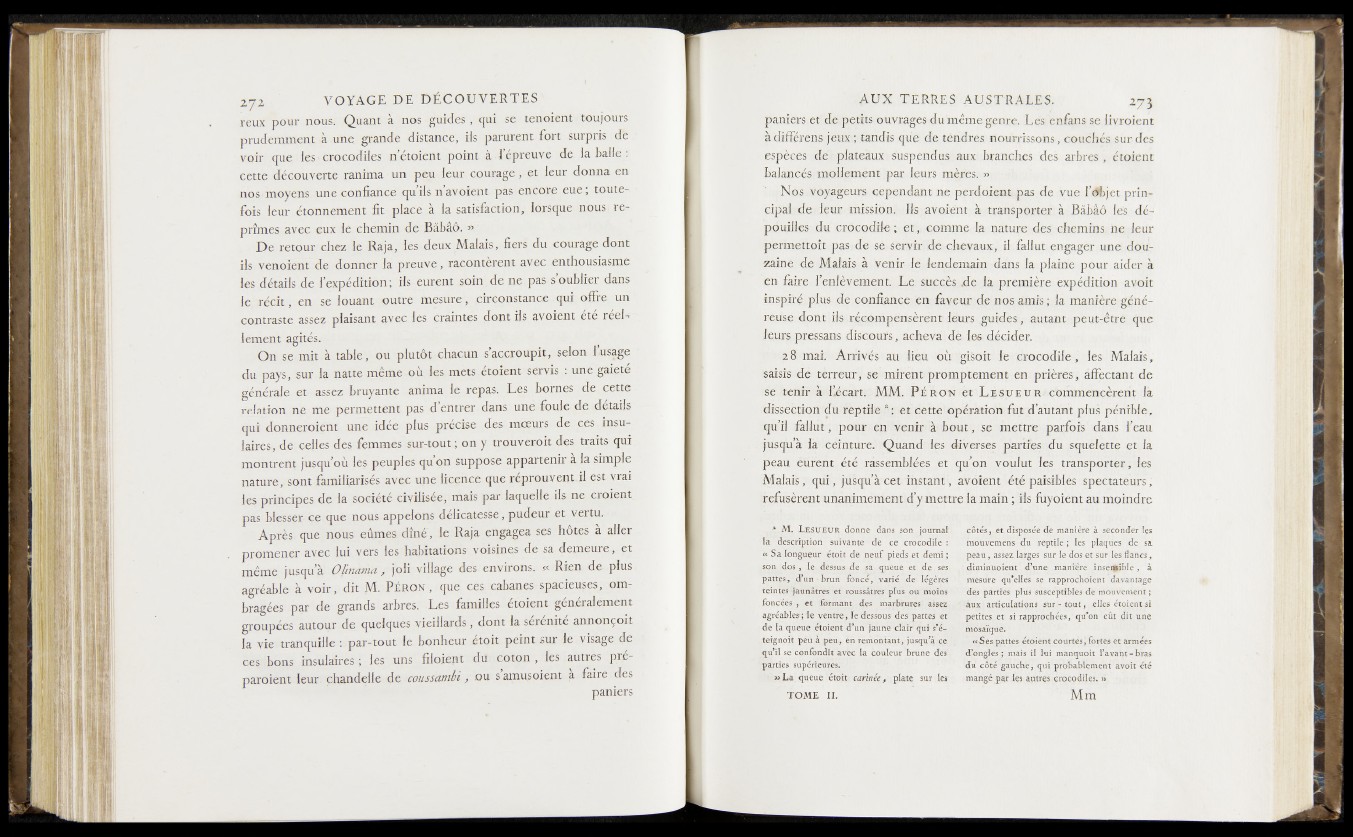
xemffiour nous. Quant à nos guic|«st, qui <se tenoient {.toujours
prodeminent à une grande distance^disuparur^nt fort surpris dit \
voir que les* crocodiles n’étoient point-à l’épreuve de la balle :
cette découverte ranima un peu leur». Gftüfcage», et- leur donna en
nps-' moyens, une/popfiance qu’ils n avoient. pas encoï^ eù&; toutes
fois leur Ytonnerpent fit placera la satisfaction; lorsque nousjReprîmes.
avec eux le; chemin deRâbâô.*.:
De retour chez le Raja, lès-deux Malais, fiers du cqurage dont
ils venoïent de donner la preuve, -ra>copter©pt -avecd,enthousiasme
les détails de l’expédition; ils-eurent ^oin-dene pas^s-oublier dans
ie-préc-it, en louant outre mesure, jcirçoi^tanceîîqpii;Q^g^'un
contraste assez plaisant avec les çràmtes dopt ils avoient e^.reel-^
lement -agités. - *>-_-< - - § 1 , WÉ - - „
On -se-mit. à table, ou plutôt-chacun s accroupi^, 1 selon-dosage
du pays^sur la natte même-où ieslmets .étoient^servis :?une gaieté
générale. et> assez ‘bruyante anima le xepæ. «fcqb, born^ tL y ette .
relation ne me permettent pas d entrer dans une fouIe^ejfLetaîfs
qui donneroient une idée plus -précise des-' m^Curs l4llÉ|^É fnsu'~
laires, de celles des femmes .sur-tout on ^"^yüver|>hjd^4tEait^rqui
montrent jusqu’où les peuples qu’on suppO|p 'appartenir, a la simpje
nature,, sont familiarisés avec unefÎG^nce^que ^éprouventifest vrai
les principes de la société civüsée, -mais par. laque#e_.% ne croient.
pas blés#r^p:que nous appelons déhojttesse, pudggg-et | g | | ^ . f ;
Après, que nous eûmes, dîné", 'Je, Raja- engagea fOS/hqtçîLà aller
promena avëC'lui versées; habitations vo is in e lg e^ lid^ eu re ,,- et
même jusqu’à Oünama. /-"joli village des environs.. Rien îdje^pius.
agréable-à Voir, dit JVL Péron, que. cçs cabanes -spaciqu|es, ;pmr
bragées par de grands, arbres. Les familles étoient généralement
groupées autour de quelq-ués^vieillarçls, dont la sérénité annonçoit
la vie, tranquille : par-tout le bonheur étpit. peint sur lei-visage, de
ce^ibons insulaires ; lqs uns filoiejat dû. coton , dès .autres préparaient
leur. chandelle Awcoussambi, ou s’amusoient à faire des
paniers
paniers-{et'’de petits;ouvrages- du meme genre. Les» enfans se livraient
àd|^iî^^je-Uix ; tandis que'' dé tendres nourrissofas?, couchés sur-des
? espèces, de eplateau^s'uspendasi- aux< branches des arbres, étoient
b'alancëiSÿmoll^mènt'par, Iqjirs mortes. »
dépendant» Be,’perdoienUipas de vue l’dbjet prin-
cipkhdo&i'eur-missipn. Jfs;ja voient à transporter à Bàbâô les dépouilles
du, !cvpf odêle 0;> comme la nature des chemins ne leur
p.ermei’toiupj-s de sAsedviri.de chevaux, il fallut&engager une: doü-
zainè./dé Malais à vepirjë^ end emain dans la plaine pour, aider à
enjkjrp. l-O^^eine-n-t. Le sn(fAès,j»de la-première expédition avoit
inspj|Aép3ù®nde confiance r|8®tîfaveur.;de;^S|l£Ùufe; la manière« géné-
dont iiis'.riepmpénsèrénti leurs,gu-idê^/ autant^peut-etre que
J purs .pressais discours, .acheva|efe lee-décider, -»p
"■ > a. 8«;mai;J«-Arrives {au -iipâ où ^gisOlt; le - drocodile , les Malais,
fsâisfo de- tèrretirv sé ümirents promptement en prières -, affectant de
;sé,ft'eMr. à fiécarti.,;MM. PÉIkxn vènL esieje u R> commencèrent là
vdfsséëtiorîfdu rèptif-^Apet cette»opération fut d’autant plus pénible,
quil fallut;j';pottr» en-Venir»-à-bout, se mettre-parfois dans l’eau
-jusqu’à daifi^feehte^ Quand- les divise s parties du squelette et fa
.peaù euf^nt,^t^'râssémbMëVMt :qu’on-f-voùlùt ies transporter, les
[Md&il>iqui(, jusqu’àncetéinstanti, avoient -été, paisibles "spectateurs,
|rè/ùsèrent-uàâà|imënientid’ymettre la'main fils fuyoiént au moindre
,Î.M. I e&UJ-UR,donne dàns^on journal
la ife3Lrrjjtion fiustyânte'^d-e co ctooodilc •
^.'Sa Iôrf^uei^r ctoit de£nçùQ pied-. et demi ;
(Mgif a ft Je^desejja^jç sa -gjtèuB et dê t ?pf,
pattfs, djun ‘ brun âric de« l'égarés
teînîes^auhâtreÿ'et -pfe xxu''moïns
^ohç’^ I , et formant dç-, marbr.ijre !,a'se/.,
agréail'efl^Ie ventre, {e 'aesstnj.s dë^pattës et
de la q’ eue LdtoiÉnt d’un jaune cr-iirqursîe-
aeignoîi p|ù,-à^peui, ipjr^^^lânt, jusqur’a ce
Idu’il se confondit ^.vtc la cotuctaWnînb cjeS
ÎTOrties supérieuïès.“'
î ffO» La|^ è^ éîët(W>X'^'|n,éç, ttlte®' sur itesr
^ot^vwet d|®psçê cfe manière à seconder tes
imfeuremef^ttm^epçrik'; lis -plaques.-de'sa
pea\i,(a|se^ia'iiggs‘’sur le dos ef'sur-Ies flancs ,
dimimioient pjune manière.}inset||ible , à
mfesuïe qu’elles ise rapp^ochoient davantage
des partfes- pms.susèeptiblês, de mouvement ;
iânx| articnlattianS, stir - tout, ^Iles étaient sî
ne'tttéfejet si rappïaçhées,*qi^on'eut dit une
mosafijdè; - ;
’ tcjSespattes^ étoaeni qourtes ; fortes et armées
«Eongies^ mais ri îüi manquoit l’avatit - bras
au cotp'Aànçm'f'qui-probablement‘avoit été
majigé-par-les aoitre§ tjroqo^iles. » •
TOME II. Mm