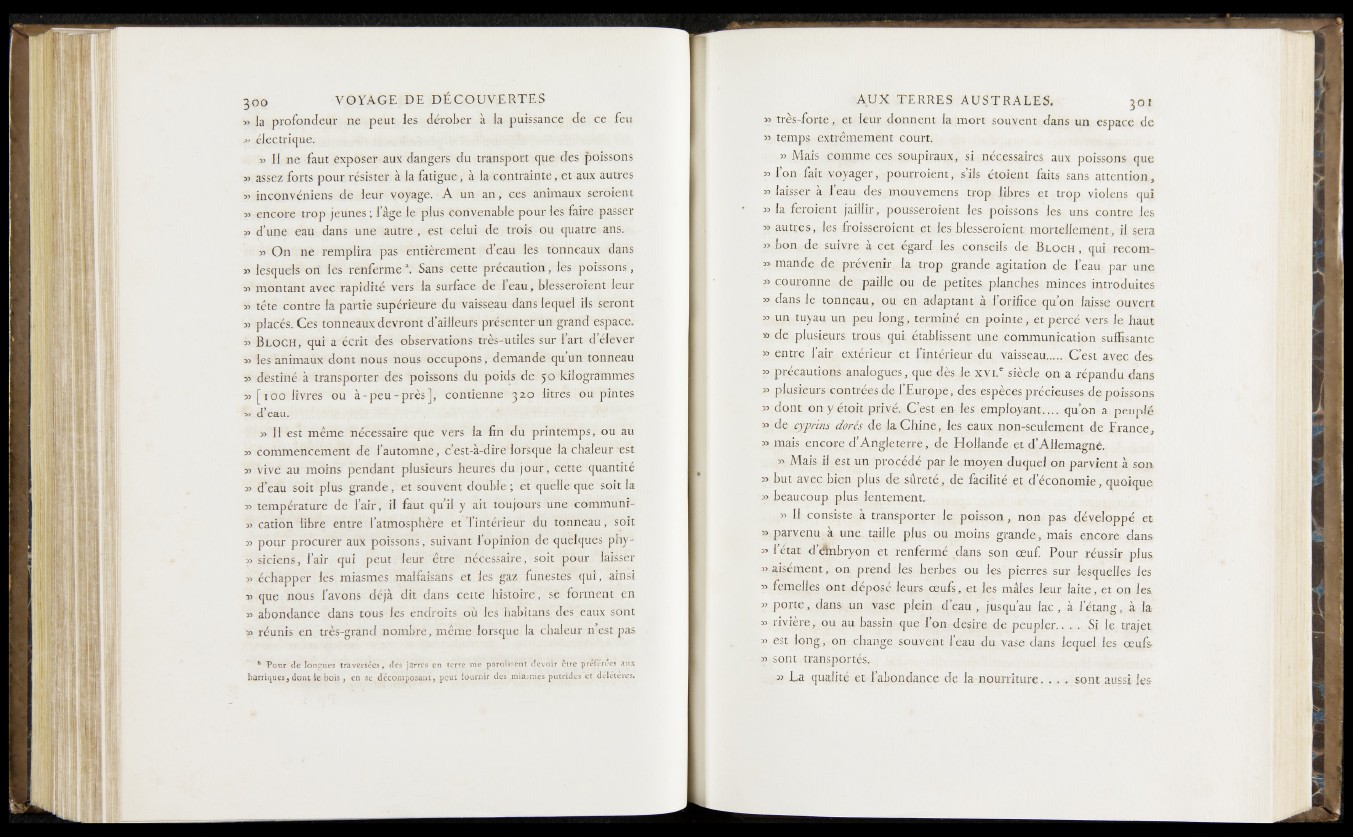
30Q V 0YA&EÜDE DÉC O ETO RT£$
». Ja profondeur ne peut les g dérober à la puissance de ce feu
».électrique, .
i , {$> I f ne • faut .exposer aux danger du transport que des poissons
» assez forts: pour, résister à la fatigue^ à lateontramté^et aux aüttes
» jncon?éniens Mé leur vQfàâge, -A un a®, $0 , animaux seroieni;
»encor© trop jeunes ; l’âge .1© plus èonv.enàble pour les fairejpasser
» d’un© eau dans une autre, est celui de trois ou quatre ans. ,
» On ne remplira pas entièrement cfeau les tonneaux dans
» iesqueüîr ori lès renferme *. Sans cette précaution,
» montant avecVapidité vers, la surfece de feau, bfesseràîent leur
sr tête contre la partie supérieure du vaisseau dans lequel lisseront
» placés. Ces tonneaux devront d’ailleurs présentefmn grand espace.
» Blqch, qur a écrit des observations frès-utiieSrsur fart délêver
» lesanimaùx dont nous nous occupons, demand#'qu’un tonnèâù
» destine à transporter dts^pois&onsdu p oids 'dë^plcïlOpafiimés
ttvres OÉ à-peu-près^],4 contienne*320 * libres ou pintes
» d’eau.
» Il est même nécessaire que vers la fin du printemps; ou à®
» commencement de l’automne, d^est-à-dire'lorsque là'chaleurrest
» Vive au moins pendant plusieurs heures dmjour, cette' quantité
» <Peaù Jsoit plus grande, et.soùvèrit double:; et qütefeqnfe:s©it la
».température de l’air, il faut qu’il y ait toujours une communi-
» catibn libre entre l’atmosphère et "l’intérieur du tonnea&,%bît
» pour procurer aux poissons, suivant l’opinion de quelques -phy--
» isfciens, l’air qui peut leur "être nécessaire ,A?!>i-î ’Ipour p isse r
» échapper les miasmes malfaisàns et les gaz funeste!?* qui, ainsi
» que nôus l’avbns;-déjà dit dans cette histqire/ se forment en
» Abondance j dans tous l,es endroits od les babitans des eaux sont
sp réunis en très-grand nombre, même lorsque la chaleur n est pas
~ h Pour de longues traversées',.- des jarres en terre me pàrqisVehtfJd|ÿGfir^ci.re préférées aux
barriques, dont le bois , en se déc^^osant, peut fournir des miasmes
$ tr^ Jb |^ ^ieÆ;,leur id(»nent lamort souvent dans un espace de
.temps çx-trêmemént court,
* ■ » -Maïs. Jpcipp16-^.?itupirauxy,^ iniéQe,ssaires; aux poissons que
f^o® ^ i t i^ a g e r^ p u î r o ie n t , ^is étaient fait$ sans attention,
?y,lqj^fç Ài^eauj d,çs ;m0apînens trop,, fibres et trop vioLens qui
» la feraient jafijp,., pousseraient les. poissons les uns contre les
S autres« les frois$©ç©ie®t^je^hlps£©ra|pnt, mortellement, il $©ra
>^jbpn d;eh?uivre, égard J#s*$pnseik,dq Blqch > qui recom-
? la trop ^ràpde jagïtation de l’eau par un©
» couronne de paille ou de petit;es? planches minces introduites
».dans Je tonnçau, ou- (en adaptant § l ’ori&ce qu’on laisse ouvert
»^un myaUj UB, p;eu lojig^ termjnéjen p o in t e e t p&rçé vers Je.. haut
* de plusieurs trous* qui établissent une. communication suffisante
£ J?pt-rej J^i|^t<|rieur|et I’intéri&^rvdu .^ s s e a q .... G’pst avec de^
» précaution analogies, qu© .XyL* on a répandu daûs
* piusieurssçpiitréçs.de l’Europe, des^spèce^ préçrçuses,de poissons
a»'dont on y était priyé^Çîgst en les employant* ..,, quon a peuplé
» ^ jy p r im dwés de la Chine, ies,jgaux:n$n^eulement de France*
».mais epgpre d’A n g le te r red e Hollande)et d’AJlemagné.
, Wi Mais- ij^gstun- procédé par le.n^yen duquel on parvient à son
» but .ay^bien plus d&^ureté t de facilité etr-d’économie, quoique;
» beaucoup pjp§Je®tfm©nt.
. consiste à transporter ,1e; ppissori .j non pas développé et
».parvenp.|^ une- taille plus ou moins grande,* mais encore dans
» l’état d’cftibiyon et„ renferm^dans son oeuf. Pour réussfiupln
»gisement, on prend les.hçrfies, ou les pierres sur lesquelierales
» femelles onc*fdépo§é leqcs oe u fs^ tjb s mâles leur laite,;;et on
» porte-, dans,un Va§6- plein d’eau , jusqu’au la c , à l’étang, à la
» rivière pu au bassin, jjüe ;1 on désire de peupler.. . . Si le trajet
.» est long; .on ,changeas,ouyent l’eau du; vaso;dans lequel les. oeufs
é«.sont. transportés.
La qualité et l’abpndançe-de la nourriture. . , . sont aussi- les